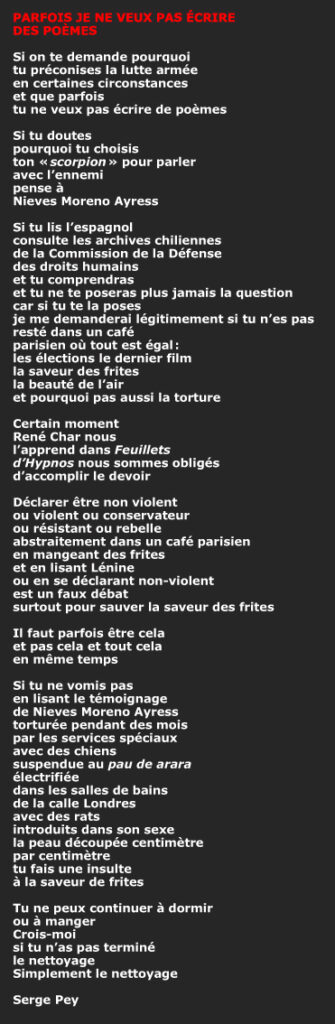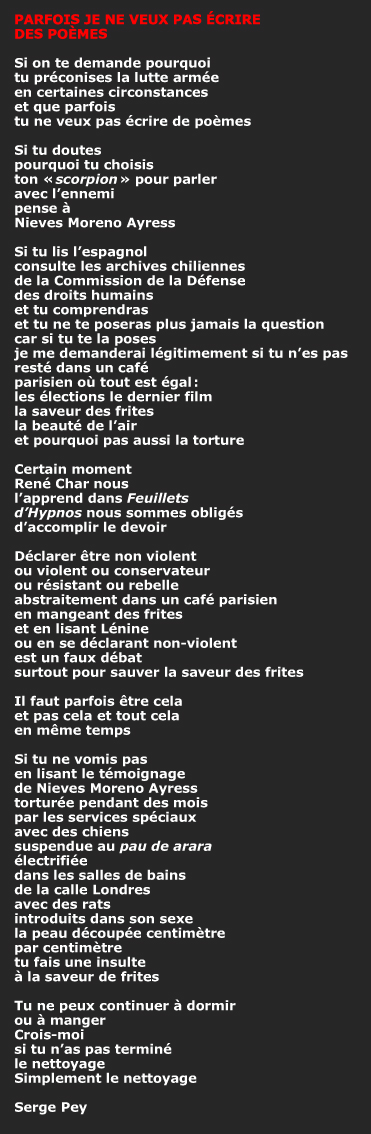
Légitime colère et état d’urgence
Personne ne pouvait prévoir la forme et l’ampleur de l’explosion, mais on savait la poudre sèche à point qui n’attendait que l’étincelle1. Originaires en majorité des immigrations arabes et africaines, les populations ghettoïsées sont victimes d’une quadruple ségrégation : sociale, scolaire, territoriale et raciale. Ces discriminations n’ont cessé d’empirer sous l’effet des contre-réformes libérales, de la montée de la précarité, de la démolition des services publics.
Légitime – ô combien – est donc cette colère des banlieues, dirait la chanson. Elle exige une solidarité sans faille face aux provocations gouvernementales et à l’escalade sécuritaire d’un ministre escomptant déjà les dividendes (électoraux) de la peur. Il aurait fallu, face au couvre-feu et à l’état d’urgence, proclamer l’état de désobéissance et d’insoumission au lieu, comme le fit le Parti socialiste d’en refuser la prorogation à trois mois, pour mieux s’accommoder de quelques jours.
« Céder un peu, c’est capituler beaucoup », disait naguère un slogan bientôt quadragénaire. C’est pourtant plus vrai que jamais en ces temps obscurs de législations qui, sous prétexte d’antiterrorisme, s’attaquent de plus en plus aux libertés civiles. Bien avant les attentats du 11 septembre 2001, l’éditorialiste du New York Times rappelait « que la main invisible du marché doit aller de pair avec son poing visible ». D’où le Patriot Act aux États-Unis et la déclaration de guerre préventive au « terrorisme », dont le sommet de Madrid donnait en mars 2005 une définition fort extensible : « Tout acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à un civil ou un non-combattant, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s’y refuser. » Prise à la lettre, une telle définition devrait conduire devant les tribunaux internationaux les dirigeants étatsuniens, britanniques, israéliens et bien d’autres.
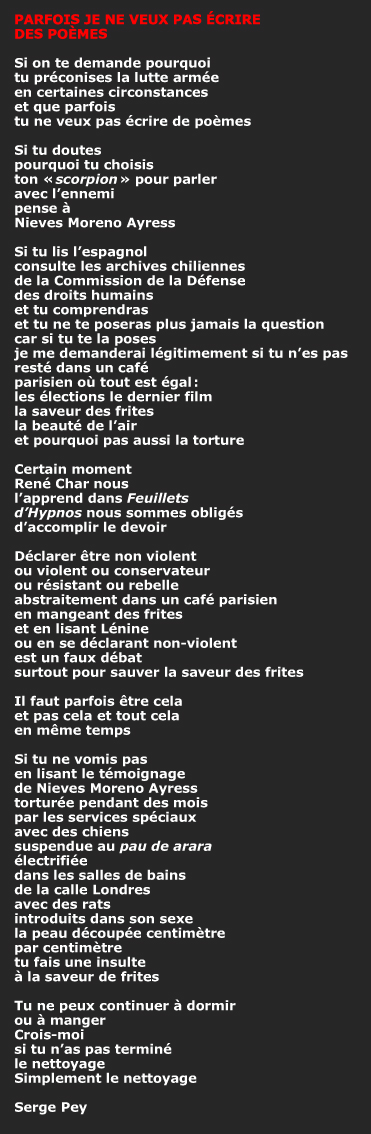 En mai 2005, le rapport d’Amnesty international s’inquiétait de « l’absence de garde-fous en matière de droits humains ». La dérive est nette en effet vers ce que le journaliste britannique John Pilger appelle « un État policier démocratique ». Ainsi, la Grande-Bretagne connaît sa quatrième loi antiterroriste en cinq ans : contrôle renforcé sur les communications, extension de la détention sans jugement (au mépris de la convention européenne des droits de l’homme), multiplication des écoutes téléphoniques, usage des « preuves tenues secrètes », criminalisation de « l’apologie du terrorisme », extension à 28 jours de la garde à vue. La réforme du code pénal espagnol limite les droits de la défense et allonge les délais de détention préventive. L’Italie renforce les pouvoirs de la police et lui octroie des garanties d’impunité. En France, la loi antiterroriste présentée au Parlement est dénoncée comme liberticide par le Syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l’homme.
En mai 2005, le rapport d’Amnesty international s’inquiétait de « l’absence de garde-fous en matière de droits humains ». La dérive est nette en effet vers ce que le journaliste britannique John Pilger appelle « un État policier démocratique ». Ainsi, la Grande-Bretagne connaît sa quatrième loi antiterroriste en cinq ans : contrôle renforcé sur les communications, extension de la détention sans jugement (au mépris de la convention européenne des droits de l’homme), multiplication des écoutes téléphoniques, usage des « preuves tenues secrètes », criminalisation de « l’apologie du terrorisme », extension à 28 jours de la garde à vue. La réforme du code pénal espagnol limite les droits de la défense et allonge les délais de détention préventive. L’Italie renforce les pouvoirs de la police et lui octroie des garanties d’impunité. En France, la loi antiterroriste présentée au Parlement est dénoncée comme liberticide par le Syndicat de la magistrature et la Ligue des droits de l’homme.
Illimitée dans le temps et dans l’espace, la croisade du Bien décrétée par Georges Bush dès le lendemain du 11-Septembre fournit le cadre de cette banalisation de l’État d’exception et d’une sorte de loi des suspects généralisée à l’échelle planétaire. Cette logique va jusqu’à nier à l’ennemi, présenté comme l’incarnation du Mal absolu, son appartenance à l’espèce humaine. Commandant en chef du camp de Guantanamo, le général Geoffrey Miller déclarait ainsi : « Nous avons appris à Guantanamo que les prisonniers doivent mériter chaque chose qu’ils obtiennent car ils sont comme des chiens et si on leur laisse croire qu’ils sont autre chose, on ne peut plus les contrôler. » Il a pu transférer à Abou Ghraïb son expérience des « techniques d’interrogatoires applicables à un ennemi non conventionnel ».
La guerre globale introduit une nouvelle conception du « droit », qu’illustrent la réhabilitation de la torture et la délocalisation de prisons clandestines échappant à toute juridiction. Dès novembre 2001, un article de Newsweek appelait à « réfléchir à la torture », car, dans le monde qui vient, « la survie pourrait bien nécessiter le retour à d’anciennes techniques qui semblaient révolues ». Un rapport destiné à Donald Rumsfeld sur « les interrogatoires dans la guerre globale au terrorisme » reconnaissait en 2002 que les techniques utilisées pourraient enfreindre la législation en vigueur et « justifier leur définition comme torture ». D’où l’idée toute simple d’adapter la loi à la réalité en légalisant le recours à la torture « pour prévenir de futures attaques d’un réseau terroriste » : ces actes pourraient « être couverts par l’autorité exécutive constitutionnelle afin de protéger la nation » : de la guerre préventive à la torture préventive !
Les autorités israéliennes avaient déjà banalisé la notion « d’exécutions extrajudiciaires » contre les résistants palestiniens. La guerre au terrorisme banalise les enlèvements et détentions tout aussi « extrajudiciaires », dans les « sites noirs » et les « prisons fantômes » de la CIA. Cette « délocalisation de la torture », qui émeut la presse internationale en octobre 2005, n’est pourtant pas nouvelle. Il y a belle lurette qu’ont été publiées les photos du Boeing 737 spécial chargé des déportations discrètes2. Il aurait effectué depuis 2001 plus de 600 vols vers des zones de non-droit, dont certaines seraient « hébergées » par des pays membres de l’Union européenne. Ceux qui se montrent intransigeants sur le respect des droits de l’homme en Turquie ne devraient pas manquer de s’en soucier.
Resitué dans ce contexte, le recours à l’état d’urgence (avatar contemporain des anciens états de siège et autres lois martiales) n’est plus un épisode imputable à un ministre maniaque de l’ordre, mais une nouvelle étape dans l’accoutumance à l’exception transformée en règle3.
Contretemps n° 15, février 2006
www.danielbensaid.org