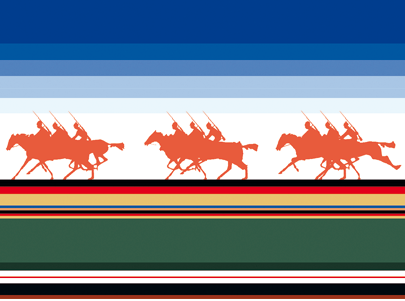
Rédigé en septembre 1993 pour Europe de l’Est, la fin du « socialisme », un collectif dirigé par Richard Poulin aux éditions Vents d’Ouest du Québec, ce texte a été repris par Daniel Bensaïd dans la Discordance des temps, essai sur les crises, les classes, l’histoire, publié aux éditions de la Passion en 1995.
Morbide fin de siècle. Qui s’éteint lentement, dans une voluptueuse atmosphère de mise à mort : mort des utopies, mort du communisme, mort des mondes meilleurs. Dressés sur leurs ergots, les « postismes » célèbrent la gloire d’un présent condamné pour l’éternité à piaffer sur place.
Le mur de Berlin est tombé. Le pays des soviets s’est disloqué. Le « socialisme réellement existant » disparaît dans le fracas d’un continent englouti. Pourtant, aucun chant libérateur ne s’élève des ruines. Ces événements se consument sans rayonner.
Pas de « magnifique lever de soleil ».
Mais un cruel coucher de soleil, aux couleurs de sang séché.
Nul élan de renaissance ou de recommencement.
Mais l’amère besogne de la routine désenchantée.
Nul choc résurrecteur, nulle fête, nulle jubilation.
Mais la morne répétition des conquêtes sans amour.
En 1989, préludant au renversement du mur, les trompettes du Bicentenaire sonnaient l’achèvement de la Révolution française et l’heure des grandes réconciliations. Elles annonçaient aussi la fin des révolutions orientales, qui furent sa résurgence et son prolongement, son épilogue et son rebondissement.
Fin de partie truquée.
 [|•••|]
[|•••|]
Le grand Karl est mort ? Un magazine américain l’annonçait naguère sur le ton du défi et de l’exorcisme. En 1991, un hebdomadaire français s’interrogeait à son tour sur la vacuité « d’un monde sans Marx3 ».
Il ne viendrait à l’idée d’aucun communicateur avisé de titrer sur la mort de Kant ou sur un monde sans Descartes, Plus qu’un constat de décès ou de disparition, « un monde sans Marx » porte l’aveu d’un manque. Faut-il tirer argument des rêves déchus pour renoncer aux grandes transcendances, aux perfections inaccessibles, aux absolus tyranniques ? L’horizon indépassable du communisme s’est-il simplement effondré sans laisser de traces et peut-on « être sans horizon » d’attente, sans projet, sans ailleurs que ce cercle vicieux tyrannique de la marchandise ?
Peut-on se résigner à la répétition du capital et à son infernale éternité ?
Nous sommes nés à la politique avec la grande espérance des années soixante, dans un moment que nous avons cru privilégié. La génération précédente, celle de l’après-guerre, avait eu maille à partir avec la morale : comment échapper au sentiment de culpabilité générale quand « le temps du mépris » annoncé par Rousseau devient aussi celui de la démesure ? Puis était venue l’ère des apaisements structuraux, de l’effacement du sujet et de ses dilemmes : l’heure était alors aux grands équilibres, aux stabilités de la langue et des rapports de parenté4.
Grisé par les indices des années d’expansion, le capitalisme recommençait à se croire éternel. Fermant la parenthèse de la catastrophe, le progrès reprenait sa marche en avant. On « lisait » Le Capital pour y déchiffrer la loi d’enchaînement majestueux des modes de production.
L’Histoire devenait un « procès sans sujet ni fin ». Sa connaissance n’était pas plus historique que n’était sucrée la connaissance du sucre. Piégée par le mouvement perpétuel, la révolution devenait impensable.
Ce despotisme systémique s’est alors désagrégé sous nos yeux émerveillés, laissant échapper une espérance de justice et de liberté réconciliées, donnant soudain à voir une gerbe foisonnante de possibles jaillie du tronc rigide du réel. C’était comme si nous venions au monde dans l’instant précaire qui sépare la création du péché originel. Science, morale et politique marchaient soudain en harmonie, bras dessus bras dessous, du même bord : celui des Vietnamiens napalmés, des foules en liesse du Printemps de Prague, des barricades bon enfant de Mai 68.
Nous avions rendez-vous avec l’Histoire rusée sous le chêne où elle rendrait sa justice impatiente. Nous serions la génération des grandes réhabilitations et des promesses enfin tenues.
[|•••|]
Dans une Europe de Yalta, mutilée mais en pleine croissance, la révolution était peut-être moins urgente qu’en des temps autrement impitoyables. Elle en semblait presque facile, avec l’abondance à portée de la main et le communisme tout de suite.
Puis vint le temps des doutes et du désenchantement.
Avec la crise économique et les présages de nouvelles barbaries, la révolution redevenait sans doute nécessaire. Mais était-elle toujours possible dans notre univers administré ? Invoquant Soljénitsyne, les plus pressés ou les plus versatiles commencèrent à se demander si elle était encore souhaitable. Ce fut un déferlement de mauvaise conscience, de reniements et de repentirs. On s’excusa d’avoir été communiste. Les déçus du Petit livre rouge se muèrent en fanatiques renifleurs de goulags. Les blasés du tiers-mondisme demandèrent leurs comptes avec usure : les luttes de libération ne méritaient bravos et solidarité qu’à la stricte condition de demeurer vaincues et misérables.
Le flux de la marée rouge les avait portés.
Le reflux de la vague rose les remporta.
Ils eurent pour la déesse modernité les yeux de Chimène qu’ils avaient eu jadis pour le petit père des peuples ou pour le président Mao. Les plus fervents utopistes (« tout et tout de suite ! ») se métamorphosèrent en libéraux convaincus (sans voir que l’utopie du moindre mal n’est pas la moindre des utopies !). Les Broyelle se convertissaient à la religion naturelle du marché. Jambet et Lardreau s’évadaient de l’enfer sur les ailes de leur ange mythé. Ruisselant de ressentiment, Glucksmann s’abandonnait au vertige de la force. Ex-prédicateur de la guerre civile, July se recyclait dans le commerce d’opinion.
L’homme blanc ravalait son sanglot long.
Ces petites scènes de la vie parisienne n’étaient jamais que l’écume des jours. La crise redistribuait le jeu, élisait des gagnants, condamnait les perdants. Quelque chose d’essentiel s’était bien détraqué au tournant des années soixante-dix. Il fallait du temps pour déchiffrer les cartes de la nouvelle donne. Excluant les uns, achetant les autres, les pays riches amélioraient leur productivité et creusaient l’écart par rapport aux pays du tiers-monde et aux économies de commandement bureaucratique. La crise frappait au cœur les rentes de l’intelligentsia traditionnelle. Disponibles pour une révolution culturelle au service d’une nouvelle méritocratie médiatisée, les nouvelles têtes d’œuf ne prenaient pas les idées suffisamment au sérieux pour souffrir la moindre traversée désertique.
Ce fut le sauve-qui-peut.
La renégation générale. Ou presque.
Une débâcle très fin de siècle.
[|•••|]
D’un siècle né avec une foi intacte dans le progrès. Il s’était cru voué avec certitude à réaliser les idéaux d’émancipation universelle et de paix perpétuelle. Science et technique, raison et sujet, vision unifiée du monde constituaient son horizon de réconciliation.
Et ce fut l’époque des guerres et des révolutions.
Un double mouvement s’amorçait.
D’un côté, l’optimisme de la Raison classique déclinait au bénéfice d’une méditation sur la solitude individuelle face à la mort, d’une revendication de la subjectivité absolue contre l’abstraction du système. À bout de souffle, la critique du rationalisme abstrait tournait à la guerre sans merci de l’être contre le cogito. Elle renonçait à une vérité qui, pour être partagée et communiquée, supposait encore un référent commun. Comment penser désormais l’individualité radicale, unique et irréductible, avec des mots et des idées appartenant à tous ? Et comment dévoiler la vérité subjective par les moyens illusoires de l’objectivité ? La seule solution semblait résider dans l’esthétique, dans la séduction pour la séduction, dans le narcissisme qui n’est plus rapport de soi aux autres, socialisation, mais retour du moi à lui-même par la médiation de l’autre : boucle parfaite qui replie l’être sur son néant intime.
De l’autre, un marxisme saisi par la pétrification stalinienne ne pouvait offrir qu’une dérisoire ligne Maginot philosophique : celle de la Raison universelle classique. Le monde du tiers exclu s’ordonnait selon l’implacable logique binaire des camps : démocratie contre fascisme, raison contre obscurantisme, État national contre État racial, Renan contre Rosenberg, l’URSS de Staline contre l’Allemagne nazie… D’Histoire et conscience de classe (1921) à la Destruction de la Raison, la trajectoire de Lukacs témoigne de cette régression. De même qu’en témoignent les combats d’arrière-garde d’un Politzer : Le Tricentenaire du Discours de la méthode, La Philosophie des Lumières et la pensée moderne, Qu’est-ce que le rationalisme5… Ce fut l’heure du front populaire en philosophie, arc-bouté sur Descartes face à la marée montante de la folie et des mythes : « Pour la célébration du tricentenaire du Discours, c’est la France et l’Humanité affirmant leur volonté de défendre résolument la raison contre l’obscurantisme, la civilisation contre la Barbarie. »
À l’heure des périls, Descartes, c’était déjà la France6 !
Jusque dans son style, Politzer cédait alors à la logomachie de la raison d’État ventriloque : « Pour le socialisme scientifique, le marxisme apporte à l’homme les lumières de la science, non plus seulement sur la nature, mais aussi sur ses propres destinées… La Raison cesse d’être l’auréole d’une société qui ne peut encore s’y conformer. » À l’heure des procès de Moscou, la patrie du socialisme (dont on n’avait point encore besoin de préciser la réalité) était le nouveau « foyer des lumières ». La « raison militante » dominait désormais la conscience de classe : « Le Parti communiste, parti des forces d’avant-garde est le parti de la raison militante. » Au moment précis où la contre-révolution bureaucratique enterrait une fois pour toutes le dépérissement de l’État, le parti n’était plus en réalité que le délégataire de la raison d’État !
[|•••|]
Avec ce divorce entre subjectivité et Raison, cette séparation entre éthique et politique, le fil d’un fragile possible s’est rompu. On ne saurait prétendre a posteriori qu’un marxisme chaud et dynamique aurait suffi à garantir l’unité du savoir. Du moins aurait-il permis circulation et dialogue entre des régions vouées à s’enfermer dans leur rigueur de disciplines. Les années vingt témoignent de ce fascinant potentiel.
Le cas Politzer illustre ce contraste.
En 1925, là où certains ne voudraient voir qu’un signe de transition inaccomplie entre philosophie et révolution, éclate au contraire le message d’une pensée révolutionnaire juvénile. Rejetant les tentations d’un Marx « imbu du scientisme qui caractérise son époque » (« ses disciples et Marx lui-même appuient souvent leur enthousiasme sur un optimisme qui fait fond sur la nécessité de la dialectique »), Politzer réclamait encore une philosophie nouvelle : « Dans la méthode cartésienne, Dieu vient achever la certitude ; c’est la croyance en Dieu dans sa beauté qui donne l’exhaustivité à la certitude. Pour un athée, il n’y a pas de certitude exhaustive, même en mathématiques. » Persévérer dans cette voie eut conduit à constater à quel point les certitudes staliniennes relevaient toujours des mêmes procédures de croyance.
On trouvait également chez lui une profession de foi philosophique prémonitoire :
« Quant à nous, nous n’attendons rien de la révolution. Nous venons trop tôt. Il serait étonnant que les révolutionnaires nous comprennent. Car, en un sens, nous ne sommes que des postrévolutionnaires. Pour nous, la révolution est déjà un fait accompli. Nous ne savons pas ce qu’elle apportera ; nous ne prévoyons rien ; nous y assistons cependant comme ceux qui prennent part au déchiffrement de l’énigme dont ils connaissent déjà la solution. Notre philosophie ne sera certainement pas adoptée par les révolutionnaires, car au moment de la révolution, c’est le mythe héroïque qui devient la philosophie d’État. Nous ne serons compris qu’ensuite. Notre situation est singulière, elle n’est pas tragique. Nous avons rompu avec les uns et les autres rompent avec nous… Et s’il est fort possible que, grâce à cette époque maudite, aucune de nos formules ne soit définitive, il sera toujours que d’une part nous avons dénoncé la scolastique et que d’autre part nous avons reconnu la révolution… Philosopher sera à nouveau une occupation dangereuse comme dans les temps héroïques. Les philosophes seront de nouveau les amis de la vérité, mais par là même les ennemis des Dieux, ennemis de l’État, corrupteurs de la jeunesse. »
Politzer pouvait-il entrevoir déjà à quel point le mythe héroïque deviendrait la philosophie impitoyable de l’État bureaucratique ? Et pouvait-il en conclure que transformer le monde signifierait encore, interminablement, sans dernier mot, au risque donc de se perdre, l’interpréter ?
C’est-à-dire philosopher au-delà de la philosophie.
En 1928, sa Critique des fondements de la psychologie jetait encore une passerelle vers le continent de la psychanalyse. La même année, Le marxisme et la philosophie du langage, de M. Bakhtine (qui avait publié dès 1925 un livre sur le freudisme) mettaient l’accent sur le caractère social de la parole dans l’horizon structural de la langue. Mais un an plus tard, en avril 1929, devant la deuxième conférence des Institutions marxistes-léninistes de recherche scientifique, Déborine prononçait son exposé sur Les Problèmes actuels de la philosophie marxiste. La résolution de la conférence consacrait « le marxisme-léninisme, le diamat, comme seule théorie scientifique ». Déborine reçut la responsabilité de la grande Encyclopédie soviétique. Le marxisme officialisé virait au positivisme. La Dialectique de la Nature, dont Politzer entreprit la traduction, en devint le bréviaire.
En 1933 commenceraient à paraître les manuels de « marxisme-léninisme ».
Une « philosophie d’État » se mettait en place.
Et « une étatisation de la philosophie7 ».
À laquelle réplique le « philosopher » dangereusement en des temps redevenus sombrement héroïques.
[|•••|]
Depuis la Première Guerre mondiale, l’unité postulée du savoir est irrémédiablement brisée. La figure du philosophe pèlerin, en marche vers la terre promise de l’Être et de la Vérité, s’est évanouie8. Avec la disparition de cet honnête homme introuvable, la division galopante du travail intellectuel fait de chaque savoir parcellaire une prison : « On y est reconnu, mais on ne peut en sortir. » Marx, Rosa Luxemburg, Trotski, Gramsci sont sans doute parmi les derniers « honnêtes hommes » (ou femmes) de la politique révolutionnaire. Avec eux s’achèverait la grande ambition révolutionnaire humaniste et son échec rejaillirait de la philosophie à la politique.
Dans la grande stabilité confiante de l’après Seconde Guerre, dans l’expansion éternisée de l’État-providence, Levi-Strauss renvoyait Sartre et son humanisme existentialiste au « musée de la morale et du sujet ». S’efforçant d’arracher la science de Marx à sa gangue idéologique, Althusser découvrait un Marx péniblement né à lui-même après la sanglante « coupure épistémologique ».
L’Histoire s’alourdissait au point de s’immobiliser dans les nappes stagnantes de la longue durée. Dilatée à la dimension d’une anthropologie universelle, la nouvelle Histoire avait réponse à tout, sauf au changement, aux passages, et aux transitions qui gardaient jalousement leurs énigmes. Dans la majesté architecturale des structures et des modes de production, le mystère de la diachronie ne cessait de s’épaissir.
Bien que réelle, la révolution devenait impensable.
Pourtant, quand le savoir doit s’ouvrir sur l’urgence d’une décision, « en dernière instance…, tout se décide dans l’événement ». Dans son autobiographie philosophique, Jean-Toussaint Desanti s’est carrément demandé si le structuralisme avait vraiment existé, ou s’il ne fut, tout compte fait, qu’un fantasme idéologique passager. De cette mode fantomatique, le vieux sujet n’est pourtant pas sorti indemne. Malmené depuis un certain temps, dynamité par l’inconscient, dépouillé de sa raison raisonnante, récusé dans sa morale privée, et finalement dissout dans le grand bain structural, pouvait-il encore ressusciter ? Sous quelle forme et dans quel état ?
On a invoqué « une idée neuve du sujet » liée au retour de l’amour, du religieux, aux retrouvailles avec la nature et ses valeurs. Après les recensements austères de l’Histoire quantitative, biographies héroïques et autres « mémoires du peuple » revinrent en force, vibrations d’atomes originaux et irréductibles. Mais, loin de promouvoir l’ego, le freudisme l’avait irrémédiablement déconstruit, réduit à une géométrie des passions, à un jeu de cubes et de formes ventriloques. S’exprimant en son nom, le ça « structuré comme un langage » escamotait le moi dans la langue qui le parle.
De ces décombres et de ces éboulis, le sujet classique ne pouvait dès lors renaître à l’identique.
Tout au plus une gerbe de désirs et de pulsions libérés par la désintégration de l’atome individuel, la multiplicité proliférante et obstinée du rhizome. Or, le parti de Lénine fut conçu et décrit sur le modèle de ce sujet perdu, « radical, universel et pédagogue9 ». Au terme d’une dialectique de la conscience, le parti selon Lukacs n’était-il pas l’accomplissement d’une dialectique de la conscience, où la classe en-soi devenait pour-soi le parti supposé l’incarner ?
Desanti s’est efforcé d’imaginer, sans trop y croire, une « bonne préhistoire », un « âge d’or » dépourvu de tout fétichisme. Dressé dans toute la puissance institutionnelle de l’État, ce sévère sujet d’un autre âge était déjà celui du tout ou rien :
« Ce sujet collectif qui était le Parti te renvoyait comme une image de tes actes politiques, de ta vie militante. Dans cette image, tu te reconnaissais. Mais voilà que se montre une faille, une cassure. Pour moi, ce fut le XXe congrès et ses suites. Le Sujet n’était pas tel qu’il se montrait. Celle double conscience que, parfois, on avait acceptée, voilà qu’elle apparaissait comme consubstantielle au Sujet lui-même. Tout cela n’était donc que décor et faux-semblant ? L’Histoire se passait sur une scène truquée ? Dès ce moment, le lieu manque où se reconnaître. Le champ historique est libéré. Il n’y a plus de sujet. Ce que tu as appelé le Parti n’est plus alors qu’un corps étrange, un poids que tu subis. On peut bien sûr continuer à le porter comme une croix, mais à quoi bon… »
Desanti parle encore de « ce moment où vient à manquer le sol de l’Histoire, où le monde éthique semble s’écrouler, où ce que tu tenais pour vrai devient formel et vide ».
Alors, « tu mènes une vie d’ombre ».
Quand le cœur n’y est plus, l’identité d’emprunt devient fardeau et cachot. Rejetée, elle pèse encore comme un cauchemar qui fait frissonner les âmes mortes.
La manière dont Desanti évoque ce Sujet aboli porte encore la marque d’une religiosité négative, d’une foi inversée, reportée d’une communauté et d’un communisme illusoires à une solitude autarcique et désenchantée. Penser le Parti majuscule sous la métaphore du Sujet collectif, c’est lui accorder malgré tout un plus de raison et de conscience, lui incorporer les petits sujets minuscules au risque de les lui assujettir. Ce Sujet tutélaire est encore une possession et une hypostase de la Raison10.
[|•••|]
L’implosion du sujet révèle seulement l’éclatement étoile de l’Histoire, dont les branches s’étirent vers un horizon écartelé. Morale et politique se chamaillent. La science même n’ose plus prononcer ses sentences.
La crise du sujet renvoie immanquablement à la crise de la théorie.
La crise de la théorie à celle de la pratique.
En crise, le marxisme ?
Et quand donc ne l’a-t-il pas été ? On n’a commencé, à la fin du siècle dernier, à parler de marxisme que pour constater aussitôt sa crise et sa « décomposition ». L’insistance sur la crise actuelle présuppose un âge d’or introuvable : celui de la dénaturation positiviste et social-démocrate ? Celui de l’idéologie triomphante dans la Raison d’État stalinisée ? Celui des honneurs académiques des années soixante ? Braudel avait encore la prudence d’admettre qu’il faudrait, pour se débarrasser du marxisme, entreprendre « une inquisition contre le vocabulaire11 ».
Et puis, crise singulière d’un marxisme au singulier ?
Cette unité du « marxisme » postule une impensable orthodoxie. Si marxisme il y a, celui des bourreaux ne peut être celui des victimes. Il faut bien admettre, par-delà des facteurs communs, des crises plurielles, fatales pour les uns, résurrectrices pour les autres.
Henri Lefebvre avançait l’idée d’une crise qui serait celle du marxisme européen ou occidental, d’une doctrine de nantis, au moment paradoxal où l’état de la planète tendait au contraire à valider le noyau dur de la théorie. Faute de démêler la part d’universalité et la part de relativité géopolitique dans le « marxisme » de Marx, une telle hypothèse ne résiste pas aux conséquences de la débâcle du socialisme « réel ».
Pour Colletti, la crise était un effet différé du XXe congrès, de l’intervention de Prague, de celle de Kaboul, et des déchirements de Phnom-Penh : « Le marxisme prenait désormais acte du fait qu’il n’était même pas en mesure d’expliquer ce qui s’était produit et réalisé en son nom12. » Pourtant, les mystères du phénomène bureaucratique sont moins opaques pour la critique marxiste que pour toute autre théorie. Les avatars des prophéties émises au nom de l’antitotalitarisme en témoignent. Il y a décidément plus dans la crise du marxisme qu’aucun antimarxiste ne pourrait jamais l’imaginer.
Pour André Gorz enfin, la crise du marxisme serait celle de son rapport au sujet supposé. L’espérance de l’émancipation dans et par le travail s’évanouirait. Le capitalisme engendrerait une classe exploitée de moins en moins capable de maîtriser les moyens de production. Avec l’ouvrier professionnel, sujet possible de la transformation révolutionnaire, disparaîtrait la classe susceptible de mener à bien un projet émancipateur. Avec la possibilité de s’identifier à son travail, s’effacerait le sentiment d’appartenance de classe : « La classe elle-même est entrée en crise. » Cette crise ne serait, en fin de compte, rien d’autre que la crise du prolétariat. Philosophiquement, la triple inspiration eschatologique du marxisme (hégélienne, chrétienne et positiviste) serait ainsi tenue en échec.
Jusqu’où peut aller la désillusion ?
Jusqu’au « désabusement » libérateur ?
Jusqu’au cynisme qui fait le malin ? Et au relativisme absolu ?
Quand la distinction du vrai et du faux s’obscurcit, quand la différence entre le bien et le mal s’amenuise, il n’y a plus que des points de vue, tous également respectables et défendables dans la morne peinture du gris de l’indifférence sur le gris de la modernité. Il n’y a plus que des vérités en miettes, privatisées, des opinions dont les sondages étalonnent la hiérarchie. Entre le règne de l’opinion et l’effet de croyance, il n’y a qu’un pas. L’une et l’autre se fortifient mutuellement. La croyance est une opinion devenue contagieuse, en ce lieu où « l’incroyable peut être cru » : « Je ne crois que ce que je pense pouvoir faire croire13. »
On pensait naïvement être définitivement sortis du religieux par la bonne porte, par l’arche triomphale de la science. Puis on a vu, avec étonnement, des intellectuels voués à la prêtrise du savoir renouer avec le culte. Ce fut un étrange ressaisissement du politique par le religieux. Non par la mystique, mais par cette bigoterie fourbue, vidée de la foi. Tant il est vrai qu’un peu de science éloigne de la croyance mais que beaucoup risque toujours d’y ramener. Pascalien, Péguy sut bien déceler cette étrange connivence des religiosités. Celle, transcendante du salut, et celle, immanente, du progrès. Pour le petit homme prétentieux expulsé des majestueuses structures, il ne restait plus cependant que le regard glacé d’un Dieu méprisant sur le silence éternel de sa machinerie muette.
Qu’opposer à la croyance ? La persuasion ?
Dans les champs magnétiques de la communication de masse, elle tourne aussitôt à la domination. Plus de révélation lumineuse, plus de grâce soudaine, plus de patient apprentissage solitaire. L’étincelle fugitive de la vérité qui fait événement procède d’un frottement, d’une rencontre, d’une interprétation sans cesse remaniée.
[|•••|]
« Quand le présent déçoit, l’Histoire réconforte. » Gorz, au moins, ne se contente pas de rejeter. Il cherche une réponse à la perte du sujet, dès lors que « le travail est tombé en dehors du travailleur ». L’ouvrier ne fait plus son travail. Il assiste au travail qui se fait. L’abolition du métier par l’organisation scientifique du travail inverse la capacité de gestion naguère investie dans la démocratie des conseils, à l’époque où les lieux de production étaient encore conçus comme les lieux privilégiés du pouvoir.
Dans l’usine géante, les conseils ouvriers chers à Gramsci seraient devenus anachroniques. Le seul pouvoir encore concevable serait celui, négatif, du contrôle qui limite le pouvoir patronal sans pour autant imposer le pouvoir ouvrier : d’où l’engloutissement récurrent des conseils, comités, coordinations, dans les structures syndicales de négociation générale. Une fois le travail dépossédé de sa matière, vidé de substance et de sens, la classe elle-même tomberait en poussière, carcasse disloquée, amas purement contingent d’une force de travail pulvérisée.
De même, l’État ne serait plus l’émanation plus ou moins légitime de la société. Pouvoir technocratique à souveraineté fonctionnelle, il ne gouverne pas. Il se contente de gérer, pendant que le Capital dicte sa loi. Gorz va au bout de sa logique :
« L’idée de prise du pouvoir est à revoir fondamentalement. Le pouvoir ne peut être pris que par une classe déjà dominante dans les faits. La seule chance d’abolir les rapports de domination, c’est de reconnaître que le pouvoir fonctionnel est inévitable (et non à abolir) et de lui faire une place circonscrite, déterminée d’avance, de manière à dissocier pouvoir et domination, et à protéger les autonomies respectives de la société civile, de la société politique et de l’État14. »
Sa démarche implique une franche rupture envers un marxisme perçu comme irrémédiablement religieux. Jusqu’à l’apothéose incertaine du Grand Soir, il n’y a pas de preuve pratique de la Révolution : sa légitimité n’a d’autre lieu que le livre. D’où l’esprit tenace d’orthodoxie et le goût du dogme. Loin d’être imputables au seul stalinisme, ils n’auraient rien d’accidentel. Simple membre, le prolétaire vivant serait aliéné par le corps du prolétariat, comme jadis les sujets l’étaient au corps du roi. Mieux vaudrait se résoudre à l’idée iconoclaste que la classe n’existe pas. Et admettre que l’économie planifiée ne saurait constituer qu’une médiocre moyenne de préférences hétérogènes, « le résultat autonomisé que tous rencontrent comme un ensemble de contraintes extérieures ».
Pour Gorz, la solution se tiendrait donc du côté de la non-classe des non-producteurs, seule susceptible d’incarner la subjectivité absolue, sans histoire prédéterminée, « à la fois l’au-delà du productivisme, le rejet de l’éthique d’accumulation, et la dissolution de toutes les classes ». Dans une cette perspective, l’égalité dans le travail revendiquée par le mouvement des femmes ne ferait que conforter la rationalité capitaliste, alors que leur potentiel de libération tiendrait au contraire à leurs activités sans but économique.
Simple « nébuleuse d’individus », qui ne veulent pas bâtir un monde mais ressaisir leur propre vie, la non-classe n’a pas besoin de grand projet totalisateur : « Le silence de l’Histoire rend les individus à eux-mêmes. » Ils ne visent qu’à libérer un espace de souveraineté arraché au monde régi par le principe de rendement. Autrement dit, à restaurer un espace authentiquement privé, en aménageant « hors travail, une sphère apparemment croissante de liberté individuelle ».
À ceci près que cette sphère est toujours le reflet fidèlement aliéné du travail aliéné, dans laquelle s’étendent tentaculairement les rapports marchands. On n’en sort pas.
Cette quête désespérée du sujet perdu n’est que l’envers du désenchantement structural. La redécouverte individuelle de l’espace privé conduit inéluctablement à la réhabilitation de l’État libéral, à la distinction entre le règne de la nécessité économique et celui de la liberté politique, entre le droit et l’usage, entre l’État et la société civile, à une disjonction radicale des sphères de l’autonomie et de l’hétéronomie.
Suivant la même logique, Gorz rejette, par-delà la « morale socialiste », toute idée de morale politique, car il n’y aurait de morale qu’enracinée dans l’irréductibilité individuelle du sujet et non dans un universel illusoire. La morale commence toujours par une rébellion contre l’État et le réalisme de la « morale objective ». Mais où trouver l’enracinement propre de ce sujet individuel, atome premier de ce libéralisme de gauche, et le fondement de sa morale ?
Un mythe chasse l’autre !
Derrière le refus de l’horizon universalisant du marxisme, se profile une remise en cause de toute universalité de la raison. Sous la forme de mouvements populaires, la résistance légitime à l’universalité abstraite bouscule les dogmes pétrifiés de la raison dominante. Quand la contestation se replie sur le noyau d’une subjectivité tout aussi abstraite, elle ne fait jamais que libérer une particularité arbitraire et sans médiations. Recouverte par les conflits entre États, camps, blocs, nations, la lutte des classes n’est sans doute pas la seule ligne de partage intelligible et déchiffrable.
Elle n’en continue pas moins à indiquer le Nord.
[|•••|]
« Marxiste, dites-vous ? Évidemment non, je ne suis pas marxiste. Je ne vois pas pourquoi je le serais, puisque je ne suis ni homme d’État, ni aspirant gardien de camp. Je ne vois pas ce que j’en ferais, attendu que ce qui m’intéresse touche davantage au droit, à l’éthique, à la réflexion sur la démocratie ou à la résistance antitotalitaire15. »
Vents d’Est, vents d’Ouest…
Vents tourbillonnants pour intellectuels moulins à vent.
Alain Badiou n’appartient pas à la confrérie des girouettes. Comme Gorz, il sait rapporter la crise de la théorie à celle de son référent16. Pour lui, cette crise est complète en ce qu’elle marque l’effondrement d’une vision du monde et de l’Histoire, de son sens, de ses sujets sociaux et politiques. La seule possibilité d’une crise dans la crise, résiderait dans « la capacité à déterminer à partir du marxisme lui-même le centre de gravité et la source de propagation de la crise ». Il s’agirait donc « de subjectiviser la crise », pour en faire le point de départ d’une régénérescence ou une seconde fondation.
La force apparente du marxisme aurait résidé dans le droit (auto-attribué) à tirer des traites sur l’Histoire, à disposer d’un crédit historique, à se présenter comme la seule doctrine révolutionnaire dont le destin soit de « s’incarner en doctrine d’État ». Conscient de l’impossibilité, pour une théorie critique, de se figer en raison d’État, Marx voyait cependant ce passage obligé par l’État comme une simple transition, amorçant dans un même mouvement son propre dépérissement.
Ce que Badiou omet de rappeler.
La fortune du marxisme en tant qu’idéologie planétaire n’en restait pas moins liée à l’idée d’une victoire. D’une libération et de l’avènement d’un pouvoir, dont Octobre fut, tout au long du siècle « l’image fastueuse ». Hier encore « philosophie indépassable de notre temps », ce marxisme s’enracinait dans une triple référence : celle des États issus de révolutions victorieuses, celle des luttes de libération nationale, celle du mouvement ouvrier proprement dit.
Le premier référent, celui de la victoire et de l’incarnation dans l’État « qui organise un sujet politique autour du thème de la victoire », s’est effondré sous les yeux, rongé par une lente négation, miné par son travail de deuil. Il en résulte une débâcle du « marxisme-léninisme », qui n’était rien d’autre que ce marxisme doctrinal des vainqueurs provisoires.
Du point de vue du second référent, la victoire instituait la nation en tant que dictature de classe. Scellant la convergence spontanée de la libération nationale et de l’émancipation sociale (représentée par le pouvoir rouge en Chine, la résistance cubaine de la baie des Cochons et la prise vietnamienne de Saïgon), elle accréditait la transparence de l’Histoire et confortait le crédit du marxisme auprès des générations intellectuelles des années soixante.
Le troisième référent enfin, celui du mouvement ouvrier porteur d’une subversion essentielle et d’une culture dissidente envers tout ordre établi, attirait et fascinait : il a fait la force d’attraction d’un Parti communiste, investi malgré lui de cette dissidence radicale17. Ainsi dominait la conviction que l’Histoire œuvrait patiemment à la crédibilité du marxisme.
Les trois référents se liaient dans le Parti dont ils assuraient la vérité souterraine, creusant sa voie dans l’anonymat et prêtant voix à un sujet ventriloque en qui parlait la puissance de l’Histoire. La crise est la manifestation de leur ébranlement combiné.
Les années soixante-dix furent celles de multiples déchirures. La spéculation effrénée sur d’hypothétiques dividendes avait ruiné le système.
Le crédit était épuisé.
[|•••|]
Il y a bien longtemps que le référent étatique est entré dans l’ère du doute. Dès les procès de Moscou pour les plus lucides. Avec le XXe congrès et l’intervention à Budapest pour beaucoup. Avec l’intervention à Prague et la révolution culturelle pour les plus obstinés. Dès lors qu’il se renforçait au lieu de dépérir et devenait à lui-même sa propre fin, l’État bureaucratique ne pouvait plus être conçu comme « État de transition ». Après le conflit sino-soviétique, celui entre la Chine et le Vietnam portait un coup fatal au spectre de l’internationalisme bureaucratisé. L’invasion de l’Afghanistan finit de brouiller les repères de légitimité qui alliaient le socialisme réel au droit des peuples.
Il peut sembler surprenant que l’affrontement de deux despotismes bureaucratiques soit plus traumatisant que le massacre des spartakistes sur ordre de ministres socialistes, que les grandes trahisons des guerres civiles grecque ou espagnole, ou que la farce tragique des procès de Moscou. Il en va de la finalité de la victoire. Ni plus ni moins.
Qu’est-ce que vaincre, si la victoire même est à son tour frappée « d’errance » ?
Cet « orphelinat du réel » frappe plus impitoyablement ceux qui avaient cru pouvoir préserver l’alliance magique, en troquant une victoire pour une autre, et sauvegarder un marxisme triomphant en célébrant à nouveau, avec le rayonnement du soleil rouge maoïste, sa force de conviction étatique. Mais nul n’en sort indemne.
Deuxième référent, le mouvement de libération nationale paraissait cheminer dans le même sens que l’émancipation prolétarienne. Les figures emblématiques de Ho Chi Minh, de Che Guevara, d’Amilcar Cabral furent dans les années soixante les symboles universels de cette grande alliance de la justice et de la libération, de la morale et de l’Histoire. L’idylle fut de courte durée. Le départ du Che de Cuba et sa mort solitaire ont semé le doute sur la possibilité de concilier la pureté intentionnelle d’une révolte et les contraintes prosaïques de l’édification étatique. Quant à l’intervention vietnamienne au Cambodge, quelles qu’en soient les raisons, elle a ruiné l’idée d’une harmonie naturelle entre un nationalisme libérateur et un internationalisme solidaire. Les guerres entre l’Éthiopie et l’Érythrée, entre l’Iran et l’Irak ont fini de brouiller les cartes d’un tiers-mondisme à courte vue. Libérateurs et libérés se muaient en nouveaux maîtres.
Qu’est-ce que vaincre ?
Qui sont les vainqueurs et que valent les causes gagnantes ?
La victoire n’est-elle qu’un travail de Sysiphe, éternellement recommencé, une dialectique épuisante des défaites et des résistances ?
La crise du troisième référent, enfin, est d’un autre ordre, car il ne s’inscrit pas dans la figure douteuse de la victoire. En lui réside le sauvetage possible d’un marxisme émancipé de l’État et de sa propre incarnation étatique : par le rétablissement « du lien du marxisme au seul mouvement ouvrier précisément débarrassé de ses fallacieuses illustrations d’État ». Or, la pensée politique issue de la renaissance d’une classe ouvrière « presque chimiquement pure », dans la Pologne de 1981, ne pouvait se définir qu’en opposition au marxisme-léninisme officiel : « Le mouvement ouvrier politiquement constitué au travers d’événements de masse organise sa propre pensée dans une radicale étrangeté au marxisme-léninisme. »
Nous avons cru alors comprendre à bon compte cette nouvelle ruse de la raison dialectique. On avait si souvent vu combattre le drapeau rouge au nom du drapeau rouge ! Pourquoi ne pas concevoir que l’on puisse désormais combattre le drapeau blanc au nom du drapeau blanc ? Puisque les mots avaient été confisqués et dénaturés, puisqu’ils étaient devenus « menteurs », il fallait s’attendre à de nouveaux codes, à des effets de langage inattendus. C’était compter pour peu que l’on pense avec des mots. Quand ils se dérobent, quand ils ne disent plus ce qu’ils veulent dire, la pensée déraille. Pour guérir la langue, dictionnaires, lexiques et bonnes traductions ne suffisent pas. Le sens prend son essor dans des expériences fondatrices qui en déterminent durablement le cap.
Nous avons espéré que ce serait une question de temps, d’apprentissages et de balbutiements nécessaires, avant que la vieille taupe ne retrouve sa galerie. Nous en sommes à constater que cette maladie des mots n’est pas propre aux pays du « socialisme réellement existant ». Elle est universelle.
Il en résulte une difficulté à penser.
Comme si les idées pesaient soudain infiniment plus lourd, comme s’il en coûtait de les soulever et de les faire bouger. Les catastrophes politiques du siècle se prolongent dans les infirmités de la parole.
[|•••|]
Il n’y a plus de signification partagée et univoque des faits.
Il n’y a plus d’unité du monde : l’intelligibilité se disperse dans le temps et dans l’espace. L’effacement des lignes de classe sous les frontières non superposables des États, des nations, des tribus, ruine l’idée hier lumineuse de l’Internationale. C’est « universellement que se défait sous nos yeux le lien organique du marxisme et de la référence sociale ouvrière […]. Ainsi aujourd’hui, ni les États socialistes, ni les luttes de libération nationale, ni le mouvement ouvrier ne constituent des référents historiques capables de garantir l’universalité concrète du marxisme18 ».
Deux voies s’ouvrent alors.
Celle consistant à déclarer le marxisme jugé et condamné par l’Histoire selon ses propres critères : emporté par la chute du socialisme « réellement existant ».
Cette idée purement réactive a la force trompeuse et la stérilité d’une évidence. Elle revient à décréter vain et nuisible tout espoir de transformation sociale. Il ne resterait qu’à « conserver » des libertés sans cesse menacées, à veiller sur le salut de la pensée occidentale, à monter la garde sur l’archipel du monde libre. D’où l’apologie complaisante de la démocratie parlementaire en tant que forme perfectible mais indépassable de l’État. D’où le retour à la philosophie politique libérale classique et aux variations sur le thème du contrat, dans l’oubli périlleux que la force fondatrice de l’État précède et prime toujours la civilité du contrat. Il s’agit là d’un pur « désastre de la pensée » : les choses sont en effet « certainement plus graves que ne l’imagine l’antimarxisme vulgaire19 ».
Celle d’une nouvelle articulation entre la théorie et la pratique. À partir d’un retour sur soi du marxisme, il s’agirait de « subjectiviser la destruction du marxisme ». La pensée radicale de sa crise ne peut lui être qu’immanente. Nous serions emportés dans le mouvement émancipateur de délocalisation d’un marxisme laissé, par l’effondrement de ses référents illusoires, sans patrie historique : « Il ne nous reste plus en vérité que le lieu inhabitable d’une hétérodoxie marxiste à venir. » Un cycle de marxisation a été parcouru, qui a produit du bon et beaucoup de mauvais. Il faudrait être capable de tourner la page et de « refaire Le Manifeste ».
Badiou s’obstine ainsi à traiter le marxisme comme un universel abstrait sans s’interroger sur ce qu’il est dans la diversité et la pluralité même de ses crises. Il réduit un embranchement de possibles à une alternative simple entre la critique destructive externe et l’autocritique refondatrice. N’ayant pas distingué la crise dans la théorie de la crise du « marxisme » en tant qu’idéologie planétaire, il demeure sous le poids de l’identification assumée de la théorie à l’État. Non seulement à l’État né d’Octobre, mais encore au « camp socialiste » avant sa désintégration.
« Refaire Le Manifeste » sonne fier.
Mais l’aspiration à la page blanche du grand recommencement est toujours illusoire. Elle butte sur la question inhérente à tout bilan : qu’en est-il des acquis ? Faut-il seulement les biffer à tour de bras, ou faut-il les conserver comme un héritage qui doit être dépassé pour être refondé ? Les « trois sources » classiques de la philosophie allemande, de l’économie politique anglaise et du mouvement révolutionnaire français sont sans doute taries. Pour Badiou, nous partons d’une pensée marxiste, ni plus ni moins détruite que ne l’était la pensée hégélienne aux yeux du jeune Marx, et d’événements fondateurs, qui sont ceux de la révolution culturelle ou du soulèvement des peuples contre le despotisme bureaucratique. Il reste à rétablir le lien entre les pièces dispersées de ce puzzle et le défi de ces événements à se laisser saisir dans ses vides.
Il reste, autrement dit, à guetter une nouvelle apparition messianique chargée de significations inédites : « Nous avons à trouver l’énoncé vrai erratique, où, sous l’empire de la marxisation, s’énonce à la (vie) ce qu’elle occulte et oublie de la politique marxiste. Cette politique, quant à ses sources, a moins besoin d’une doctrine que d’un poème, c’est-à-dire l’interprétation d’un événement. » Telle est bien la question. Celle du lien d’intelligibilité entre un passé qui n’est déjà plus et un avenir qui n’est pas encore. Mais l’événement fondateur, qui permettrait de remanier et de restituer la lisibilité de notre champ historique, ne saurait être arbitrairement décrété et reconnu.
Que faire en attendant ?
Ou, plus exactement, de quoi est faite notre attente ?
Sans la résistance de la première heure au stalinisme triomphant, l’obscurité de l’Histoire serait totale et rigoureusement désespérante. La bataille du jour consiste à dégager des décombres les matériaux de toute reconstruction future, matériaux conceptuels, mais aussi pratiques, c’est-à-dire politiques, sans lesquels l’intelligibilité serait depuis et pour longtemps brisée.
[|•••|]
Originalement, Badiou épargne la catégorie blessée du sujet : « Le marxisme est la consistance d’un sujet politique. » Ou encore : « Etre sujet de la crise du marxisme s’oppose à l’idée d’en être l’objet. » Être l’objet, c’est défendre la doctrine, la cristallisation étatique, ou l’appareillage des grands partis, dont le marxisme révolutionnaire doit, précisément, se détacher. C’est bien là que réside l’équation de ce qu’on a désigné comme « trotskisme » : la défense de l’URSS (autrement dit de l’héritage d’une lointaine victoire) en même temps que la résistance à l’expansion totalitaire de l’État, la compatibilité incertaine entre la conservation d’un initial libérateur et le basculement résolu dans la dissidence et le travail du négatif.
Bien que Trotski ne lui ait pas donné ce sens, on peut encore voir dans ce recommencement non linéaire une figure dialectique de « la révolution permanente ». Dans sa triple dimension entraient, en effet, son extension internationale et son approfondissement culturel, seuls recours contre une pétrification bureaucratique dont le mécanisme profond ne serait pourtant élucidé que quelques années plus tard. La « révolution permanente » selon Trotski rejoint ici « la révolution en permanence » selon Marx. Mais, au lieu d’oser s’épandre dans la multiplicité de ses voies, cette révolution, permanente ou en permanence, se rassemble encore dans la majuscule unifiante d’un Sujet, garant de l’unité d’un processus par-delà sa diversité apparente.
Le « trotskisme » ne représenterait donc encore qu’une demi-rupture envers la rationalité hégélienne de l’Histoire, une rupture chargée de mauvaise conscience, une troisième voie qui s’abrège en impasse et un rameau de la tradition qui tombe avec la tradition. Des rédacteurs de Socialisme ou Barbarie à Régis Debray, en passant par Georges Bataille, on lui a souvent reproché d’être incurablement une pensée minoritaire. Incapable de devenir alternative, partageant l’idée de l’État comme expression d’un contenu social univoque, ignorant par conséquent la question de la légitimation politique, il serait resté rivé à son statut subordonné d’opposition « fractionnelle », au détriment d’une claire conceptualisation du totalitarisme.
Passons sur les inexactitudes et les approximations d’un jugement aussi hâtif que mal informé. S’il y a dans ces jugements un grain de vérité, il renvoie à une donnée historique compréhensible et respectable : la lutte contre un despotisme bureaucratique inédit nourrit davantage la méfiance du pouvoir que la volonté de puissance. Ce qui n’est pas sans inconvénients dans la politique réelle. Plus fondamentalement, Trotski a pourtant établi les justifications principielles du pluralisme politique dans l’hétérogénéité même d’une classe qui n’a plus rien à voir avec un grand sujet automate :
« Parce que la conscience de classe ne correspond pas exactement à sa place dans la société […], parce qu’une classe est déchirée d’antagonismes internes […] et, devrait-on ajouter, parce que les autres classes et fractions de classes ne sont pas abolies, parce qu’il existe des conflits entre sexes et générations, entre nationalités et régions, non mécaniquement réductibles à l’intérêt de classe, elle peut former plusieurs partis. »
C’est d’ailleurs pourquoi, Trotski fut capable de saisir à la source l’esprit même du totalitarisme : « L’État, c’est moi ! est une formule presque libérale en comparaison avec les réalités du régime totalitaire de Staline […]. À la différence du roi Soleil, Staline peut dire à bon droit : la société, c’est moi20 ! »
[|•••|]
Malgré les limites et les apories de sa vision de l’Histoire, Trotski énonce peut-être la condition de possibilité du recommencement que Badiou espère sans pouvoir le définir. Sous des angles différents, souvent contradictoires, Adler, Martov, Bauer, Kautsky, Pannekœk, Rosa Luxemburg, Korsch, Rakovsky, V. Serge, Gramsci et tant d’autres furent des critiques précieux de l’imposture naissante. Il ne suffit pas de le constater. Force est d’en conclure que « le marxisme », loin de constituer un espace théorique homogène, est fracturé de multiples lignes conflictuelles.
Dans ce champ miné, on ne peut éviter d’avoir à prendre parti.
Concernant le référent étatique et le « camp socialiste », Trotski apporte plus un cheminement qu’une réponse. En 1921, il écrivait dans Terrorisme et communisme :
« Dans cette substitution du pouvoir du parti au pouvoir de la classe ouvrière, il n’y a rien de fortuit, et même, au fond, il n’y a là aucune substitution. Les communistes expriment les intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. Il est tout à fait naturel qu’à une époque où l’Histoire met à l’ordre du jour la discussion de ces intérêts dans toute leur étendue, les communistes deviennent les représentants avoués de la classe ouvrière en sa totalité. »
C’était le Trotski de la militarisation des syndicats et du principe nominatif étendu au détriment du principe électif, qui ne distingue plus entre l’état d’exception de la guerre civile et la démocratie révolutionnaire. Qui garantit que le parti soit bien l’expression adéquate des intérêts dont il se prétend le porte-parole ? Non ! Ces masses composites sont de nouveau condamnées au silence à cause du sens supposé de l’Histoire. « Le parti dirigeant a pour vérifier sa ligne de conduite assez de matériaux en main et de critériums indépendants du tirage des journaux mencheviques […]. Nous avons écrasé les mencheviques et les socialistes révolutionnaires et il n’en reste rien. Le critérium nous suffit. »
La force et la victoire tenaient alors lieu de preuves.
Terrible logique de la raison historique.
Quinze ans plus tard, dans La Révolution trahie comme dans Staline, le point de vue avait radicalement changé. C’était l’aboutissement théorique d’une expérience nouvelle, celle de la bureaucratie triomphante et d’une forme inédite de pouvoir, même si les prémisses en avaient été entrevues chez Marx, Michels, Weber, Ostrogorsky… Posant la question de la légitimité d’un pouvoir révolutionnaire, non garantie indéfiniment par le coup de force de sa naissance ou par l’adéquation supposée entre classe, Parti et État, Trotski fondait alors la nécessité principielle du pluralisme et d’un État de droit. Ce changement radical permet de penser, dans les termes mêmes de la théorie de Marx, l’évolution et la crise des États que l’on disait socialistes. Il permet aussi de saisir la possibilité de conflits interbureaucratiques. La théorie de la révolution permanente souligne enfin la non-coïncidence automatique de la libération nationale et de l’émancipation sociale, dans l’horizon de rapports mondiaux hiérarchiques de domination et de dépendance, Structurés par l’impérialisme et la bureaucratie, médiés par des États, qui deviennent à leur tour les points de cristallisation de nouvelles classes à la fois dépendantes (internationalement) et dominantes (nationalement).
Reste l’énigme théorique et pratique du mouvement ouvrier lui-même. Plutôt que de spéculer sur la portée d’une catégorie si souvent investie d’une mission mythique, il convient de laïciser la conception des classes, de repartir de leurs luttes et de la diversité des « révoltes logiques », de prêter attention aux formes d’organisation mouvantes et aux paroles éphémères.
L’époque est constellée de déflagrations et d’éclats, d’événements fragmentaires et émiettés, qui ne revêtent pas la forme de l’événement majuscule souhaité par Badiou, mais plutôt celle de « désastres obscurs »21. La métamorphose du paysage, le déplacement des grands équilibres issus de la Seconde Guerre, la libération d’énergies sociales colossales hier encore emprisonnées dans le gel des rapports entre camps et États, ne tracent pas encore les signes déchiffrables d’une nouvelle intelligibilité globale.
[|•••|]
C’est le temps des événementialités froides et des noces de cendre.
En 1991, l’Union soviétique a disparu dans la banalité et l’indifférence. Et pour cause. Si mort du communisme il y a, pourquoi les journalistes nécrophages ont-ils attendu si longtemps pour la proclamer ? Le qui perd gagne entre Gorbatchev et Eltsine s’est réduit à la fastidieuse chronique d’une mort annoncée. Certains ont parlé de mort d’un cadavre. Mort presque discrète, silencieuse, dernier avatar d’une blessure mortelle qui avait, depuis longtemps, fait son œuvre.
Mais quel est donc ce cadavre, s’il est vrai que « l’initial communiste » a été « détruit par le communisme lui-même22 » ? Et quel vide laisse-t-il, s’il y a du sens « à se demander maintenant ce que nous pouvons encore avoir à faire avec le vide ou avec l’ombre que laisse derrière lui le mot de communisme » ? C’est toute l’ambiguïté d’une mort à double détente, où le parasite bureaucratique disparaît après avoir rongé jusqu’à l’os le corps sur lequel il s’était posé. En ce siècle de cruauté, aussi loin qu’en se retournant porte le regard, il n’aperçoit guère de « bon vieux temps ».
Nous nous sommes pourtant crus adossés à une indestructible montagne magique. Ce qui était fait ne serait plus à refaire. Nous avions à notre actif généalogique l’héroïsme définitif des soldats de l’An II et de la Cavalerie rouge. Quels que soient les détours et les retards du parcours, on ne reviendrait pas sur ces actes fondateurs. C’était sous-estimer encore « la puissance d’effacement et de dévastation du système de contrôle et d’oppression dont le stalinisme constitue la forme achevée ».
Puissante au point d’effacer non seulement Octobre.
Mais encore l’événement Marx.
Sartre affirmait pourtant que « notre époque ne se laisse pas penser si on ne la pense pas comme l’époque d’une question communiste ». C’est bien cette question qui, depuis la Révolution française et les journées de juin 1848, éclaire l’horizon de l’attente philosophique et politique23. C’est elle qui propulse le présent vers un avenir concevable. Et voici que notre époque se laisserait soudain penser indépendamment de cette inquiète question ?
À moins qu’elle ne se contente de mener son existence morose d’époque, sans plus se laisser penser du tout ?
À moins qu’elle ne s’enfonce doucement dans le degré zéro de la pensée ?
Impossible de faire comme si de rien n’était. Comme s’il s’agissait d’une simple éclipse de rationalité historique, comme si tout allait bientôt redevenir comme avant. La cassure est profonde. Et « rien ne se fera tant qu’on en restera à l’imputation de l’erreur et de la faute ». Rien ne se fera sans l’opiniâtre travail de deuil « d’une pensée qui fit comme aucun autre événement, à la fois de la philosophie et de la politique24 ».
[|•••|]
La débâcle ne nous a pas surpris. Nous prophétisions depuis trop longtemps les étranglements et les asphyxies de l’économie de commandement bureaucratique. Nous annoncions depuis trop longtemps les rendements déclinants de la planification extensive et l’inéluctable régression. Nous avons sous-estimé les conséquences sociales de cette régression, au point de croire dur comme fer, que la chute des dictatures sonnerait l’heure du grand renouveau socialiste, et que l’Histoire, enfin lavée des falsifications et des truquages, rendrait justice aux premiers opposants au stalinisme.
Cet espoir n’était pas sans fondement.
Il se nourrissait des expériences passées, des soulèvements de Hongrie et de Pologne, du printemps de Prague, des élans de Solidarité en Pologne. Budapest avait parlé de conseils ouvriers et Varsovie de république autogérée. Peut-être nos désirs avaient-ils grossi ces balbutiements. Les virtualités étaient bien là.
Et quelque chose s’est brisé. Sûrement pas en une seule fois. Il a fallu la répétition des mouvements réprimés et décapités, la rupture de la continuité des générations, l’usure d’un système social au dynamisme épuisé, la comparaison avec la modernisation occidentale…
Toutes ces mutations imperceptibles qui se précipitent et se condensent soudain.
Plus question désormais de révolution antibureaucratique, de parenthèse refermée, de retour à Octobre. Demain fait irruption sous des traits inattendus. Plus qu’une annulation ou un recommencement, c’est d’une Restauration qu’il s’agit. Nous avions oublié ce qu’est une Restauration. Il faudra relire Hegel et Chateaubriand. Réapprendre à vivre une Histoire qui ne promet plus rien, qui laisse échapper de ses plaies une hémorragie de sens.
« Pensons par exemple à l’effondrement, en 1815, de l’Empire napoléonien. N’était-ce pas justice que les peuples et les États de l’Europe coalisée détruisent cette construction militariste aberrante, qui avait mis le monde à feu et à sang pour que la famille d’un despote corse soit casée dans des royautés de pacotille ? Mais n’était-ce pas en même temps le retour des Bourbons, la terreur blanche, la Sainte Alliance, le déni obtus de la révolution, et Robespierre et Saint-Just – ce que la pensée politique avait de plus intense, de plus inventé – traités par des canailles que ramenaient les fourgons de l’étranger comme des fous criminels ? Nous allons voir, nous voyons déjà que l’Empire stalinien et bureaucratique, dont la dissolution est une justice rendue aux peuples, servira par sa mort le dessein obstiné des réactionnaires : pouvoir, enfin, faire dire sur la place publique que Lénine aussi, et Mao, et derechef (car les inventions politiques émancipatrices sont à la fois irréductibles, totalement singulières, et entièrement solidaires), Robespierre et Saint-Just étaient des fous criminels25. »
Lorsque les usurpateurs et les hommes providentiels sont renversés, « ce n’est pas la révolution qu’ils ont trahie qui vient les juger dans son droit. Au contraire, les hommes, effrayés par la tension de l’avenir, cherchent alors avec ardeur à restaurer l’ordre ancien qui les tenait en lice. Nous vivons actuellement une telle restauration, que la papauté ne peut que bénir. Mais pas plus que la Restauration qui a suivi la Révolution française n’a pu effacer de la mémoire l’hypothèse du citoyen et l’assemblement du peuple, la restauration présente ne saura évincer, quel qu’en soit son désir, l’hypothèse du partage que le communisme réel a trahie26. »
Restent donc cette béance, cette trouée et ce manque.
Aux prises avec une autre Restauration, Hegel se rassurait à l’idée que la réaction ne peut « arriver qu’aux cordons des chaussures du colosse et les enduire d’un peu de cire ou de fange, mais qu’elle est hors d’état de les délier, encore moins de lui ôter les chaussures divines aux semelles ailées, et moins encore ses bottes de sept lieues lorsqu’il les chausse ». La marche de l’Histoire était lente en somme, mais non moins irrésistible. Notre siècle balafré ne permet plus ces subterfuges téléologiques.
Sur quel « après-communisme » ouvre donc cet éboulement abrupt ? Sur quel « après-à-penser », au lieu de rester sur l’arrêt de la pensée, qui n’est pas le dernier mot de l’Histoire ? La politique avait hier un sol et un enjeu. Si le marxisme fut « un cap vers la réalité », et à supposer qu’il ait cessé de l’être, « encore faut-il en tirer toutes les conséquences et projeter la pensée dans ce nouvel espace largement inconnu qu’est l’après du communisme » : « Ce qui est à penser en effet, c’est donc l’après du communisme, c’est l’au-delà de l’indépassable horizon dépassé27. »
Il n’y a plus d’après.
Voilà l’incroyable leçon.
Seulement un présent, une pointe acérée sur laquelle passé et avenir se tiennent en équilibre précaire. Pris dans les mailles de l’horizon indépassable, l’après se révèle un leurre. L’horizon ne s’est pas déchiré sur un nouveau monde. Il nous a seulement ramenés sur nos pas. Au bercail d’un vieux monde, resté désespérément le même, derrière le triste spectacle de ses métamorphoses.
Fin de l’Histoire, ou, plus simplement, fin de ses grandes illusions ?
[|•••|]
C’est pourquoi la lecture n’est pas épuisée. Le dépassement de l’indépassable reste inscrit dans son horizon. Et « rien ne repère mieux le postmoderne que la constellation polymorphe de toutes les fins du communisme28 ». Devant ces discours, « un moment de colère » est requis, un moment de sainte colère, un sursaut de l’inextinguible colère péguyenne, qui est le sentiment politique par excellence, le jaillissement sans lequel la politique se réduit au trafic d’influences médiatiques ou parlementaires.
« Colère donc devant la croyance ridicule qui nous baigne de toutes parts : on en aurait fini, tout simplement fini avec le marxisme et avec le communisme […]. Comme si l’erreur, la pure et simple et bête erreur pouvait être à ce point rectrice, régulatrice, mobilisatrice […]. »
Les crédules ont peut-être été trompés. Sans doute se sont-ils trompés.
Mais à voir la misère et l’injustice qui règnent au royaume de ce monde, ils n’ont pas pu avoir tout à fait tort. Le seul constat du manque nous prend forcément par la nuque pour nous courber humblement vers l’énigme irrésolue : « Le spectacle anarchique, confus, déplorable, mais nécessaire et légitime – car ce qui est mort doit mourir – de cette ruine atteste non la mort du communisme mais les redoutables effets de son manque29. »
Tout tourne autour de cette mort étrange, de cette « mort seconde » qui fait événement par défaut, négativement, par le manque abyssal qu’elle atteste. On n’échappe pas à ce paradoxe. L’équilibre du monde change de fond en comble. Et pourtant ni le coup d’État aux mains tremblantes de Ianaïev, ni le départ de Gorbatchev, ni même la mort clinique de l’URSS ne font événement. Car « […] tout événement est une proposition infinie, dans la forme radicale d’une singularité et d’un supplément. Tout un chacun éprouve, non sans angoisse, que les dislocations en cours ne nous proposent rien. Il y a eu un événement polonais, entre les grèves de Gdansk (ou même plus tôt, lors de la formation du Kor, invention d’un trajet novateur entre intellectuels et ouvriers) et le coup d’État de Jaruzelski. Il y a eu l’esquisse d’un événement allemand, lors des manifestations de Leipzig. Il y a eu, en Russie même, la tentative incertaine des mineurs de Vorkouta. Mais de vérité fidèle à ces surgissements, point, en sorte que tout reste indécidable. Viennent ensuite Walesa, le pape, Helmut Kohl, Eltsine… Qui osera interpréter ces noms propres dans l’éclat ou l’éclair d’une proposition événementielle ? Qui peut citer un seul énoncé inouï, une seule nomination sans précédent, dans l’érosion, à la fois soudaine et molle, indivise et confuse, de la forme despotique du Parti-État30 ? »
Étonnante disproportion des effets et des causes.
À moins que les causes apparemment premières ne soient ici que les effets secondaires de causes brûlantes plus lointaines, dont ces péripéties inactuelles ne seraient que les braises mourantes.
À cette « mort seconde » s’oppose la fidélité du deuil et de son travail créatif. Le manque n’est pas dans les affaissements de l’Histoire, mais dans l’effacement bien antérieur du nous agissant, et dans l’enlèvement du décor qui masquait son absence. Le « nous communistes », le « nous fidèles à l’événement d’Octobre 17 ». Car il ne saurait y avoir de fidélité révolutionnaire envers la structure pétrifiée de l’État, mais seulement envers l’initial de l’événement « où les victimes se prononcent ». Une fidélité non au repos des victoires aux hanches lourdes, mais à l’élan incertain des commencements dont le grondement se répercute de 1793 en 1848, de 1871 en 1917, « Choc historial fondateur, la révolution d’Octobre est venue un temps donner chance à un tel accomplissement31. »
En revenant à ce nous initial, il s’agit de séparer ce qui – dans Peut-on penser la politique ? – restait confondu. De démêler l’idéologie de la théorie, les référents étatiques des référents populaires, la conscience du nous de la Raison d’État. C’est la première condition pour penser, à partir de Marx, la dite crise « du » marxisme.
[|•••|]
Impératif imprescriptible pour survivre à l’effacement du « choc historial fondateur », ce « superbe lever de soleil » dont « tous les êtres pensants ont célébré l’époque » : « Une sublime émotion a régné en ce temps-là, l’enthousiasme de l’esprit a fait frissonner le monde, comme si la réconciliation réelle de l’esprit et du monde venait d’arriver32. »
Du pôle magnétique de notre histoire, un reflux de mémoire se propage, balayant sur son passage des mots trop de fois détournés et confisqués. Au point que le langage se met à flotter dans l’indétermination des « on », des « ils », des « ça ».
« À l’époque, ça allait mal et on décida de détruire ce qui allait mal pour faire quelque chose de bien. Mais il se trouva des gens pour dire : non, mais vous ne voyez pas, vous trouvez que c’est bien, ça ? C’est tout simplement atroce. C’étaient des gens bien – mais ce n’est qu’après qu’on nous l’a dit –, alors, tous pensaient que c’était des gens pas bien. Mais les gens pas bien, dont on pensait alors qu’ils étaient des gens bien, s’en sont pris aux gens bien, qui étaient alors considérés comme pas bien et ont commencé à leur faire du mal, pour qu’ils ne disent pas du mal de ce qui était bien. Et tout se mit à aller de plus en plus mal, mais on pensait que c’était bien, justement, même très bien, et que c’était ce qu’il y avait de mieux. C’est après qu’on nous a expliqué qu’en fait ça allait mal. Et quand on nous a expliqué, nous avons compris que c’était maintenant en fait que c’était bien et que c’était avant que ce n’était pas bien. Et nous étions contents de savoir que c’était maintenant que c’était bien, et nous croyions que ça allait être encore mieux, mais, au bout du compte, ç’a été le contraire. Ç’a été de plus en plus mal, même si ce n’était pas aussi mal qu’avant ! Puis sont venus d’autres gens pour nous dire, nous expliquer que tout cela n’était pas bien, mais qu’à partir de maintenant… Et nous avons commencé à attendre, mais, résultat, tout a été encore plus mal qu’avant, bien que pas aussi mal qu’avant, quand ça allait carrément mal. Mais après, on nous a expliqué que ça allait encore plus mal qu’on ne le pensait, et que cela pouvait même aller encore plus mal, parce que quand on pensait que ça allait bien, et qu’en fait ça allait mal, il aurait fallu faire mieux. Mais maintenant, nous avons enfin toute la vérité. C’est avant, à l’époque, il y a longtemps – mais là vraiment – qu’en fait ça allait bien33. »
Quels mots, donc, pour dire « ça » ?
Pour dire ce chaos dans la ligne brisée du progrès ?
Quand tout est sens dessus dessous, quand il n’y a plus d’enchaînement logique, plus d’ordre gradué entre hier, aujourd’hui et demain, quand on marche à rebrousse-temps, quand le présent fonce tête baissée sur le passé, quand le sens de l’humour historique définit le socialisme comme le plus long chemin vers le capitalisme ? Indéfinissable, innommable, impossible, écartelée aux quatre points cardinaux, disloquée et dispersée aux quatre vents, cette Histoire qui ne ressemble plus à rien ne peut plus s’écrire.
Cette névrose historique sonne le glas du déterminisme et de la téléologie qui tendaient la corde du temps. Elle annonce un bouleversement des temporalités. Elle exige une pensée nouvelle de notre espace-temps une révolution de nos représentations de l’Histoire.
« Il y a eu l’homme préhistorique. Un homme qui vivait dans le mythe, dans un monde où le temps était étale. Puis, relativement récemment, est apparu l’homme historique, l’homo historicus. Cet homme, lui, sait que les événements, les hommes, les époques qui sont derrière lui sont irréversibles, irrémédiables. Tout en le sachant, il n’en continue pas moins de revenir à cet irréversible et cet irrémédiable – croyance ou gage de ce qu’il pourra construire quelque chose qui n’existe pas encore, qui n’a jamais existé. Autrement dit, le futur. Que le futur soit toujours devant semble tomber sous le sens. Une page de calendrier qui s’arrache, et le voilà. Selon moi, il s’agit d’une méprise. Car le futur n’est pas la prolongation du présent. Nous sommes en droit de parler du futur tant qu’existe le passé. Nous devrions même fondre ces deux notions en une seule : le futur passé34. »
Le temps replie ses ailes sur un présent insaisissable.
L’idée même de l’Histoire est à revoir.
En tant qu’Histoire du présent toujours recommencé35.
[|•••|]
En résultera-t-il un bouleversement de la pensée comparable à celui qui en est résulté de l’explosion du monde clos, de la désintégration des harmonies cosmiques et de l’effrayant divorce du vrai, du bien ? Les prémisses d’une telle révolution ne datent pas d’aujourd’hui. Blanqui, Sorel, Benjamin, sentinelles postées aux moments critiques de l’Histoire en ont posé les jalons36. Quand l’écrasement de la Commune, quand les préparatifs de la guerre, quand les connivences entre Hitler et Staline ont fait hurler les lendemains sous les roues des défaites toujours recommencées, comment trouver le sommeil du juste en écoutant les berceuses du progrès ?
La rationalisation et l’universalisation ne marchent plus alors sur la voie tracée du mieux, d’un pas régulier, mesuré au métronome du temps chronologique. Le sens de l’Histoire ne remplace plus la puissance divine pour garantir l’harmonie finale des buts et des moyens, de l’éthique et du politique, de l’être et du devoir-être. Dès lors, on n’est plus jamais quitte avec son passé. Il ne se tient pas tranquille, derrière soi, comme un fait accompli et établi, une fois pour toutes. Il ne tient pas en place. Il nous tire en arrière, nous rattrape et nous dépasse, pour nous attendre au tournant. Il pose des questions gênantes.
Gorgé de possibles étouffés par l’historiographie sélective des vainqueurs, de virtualités qui attendent toujours d’être sauvées de l’oubli, de défaites qui n’ont pas dit leur dernier mot, il demeure indéfiniment un enjeu. Tout ne cesse de se rejouer au présent, qui n’est pas la catégorie spécifique de l’Histoire, mais de la politique en tant que pensée stratégique des embranchements et des bifurcations. C’est pourquoi, la politique, responsable à part entière, sans alibis ni faux-fuyants, de ses interprétations et de ses actes « prime désormais l’Histoire ». C’est pourquoi, il n’est plus d’Histoire concevable qui ne soit en même temps mise en doute méthodique de ses récits et de ses croyances, qui ne soit aussi philosophie de l’Histoire37.
Voué au ressassement des catastrophes, le siècle qui s’achève ne sera pas celui de la mort du marxisme ou du communisme, mais celui de l’effondrement de la croyance historique et des fétiches du progrès. Gigantesque séisme, qui vient de loin, mais dont on n’a pas fini de mesurer les conséquences. La secousse est trop rude et nous en sommes à peine à nous réveiller, tâtonnant dans les décombres, au milieu des gravats, des fumées, et des poussières encore en suspens. Car le naufrage du continent soviétique parachève ce retournement, du sens historique.
À force de ruse, la Raison s’est prise à son propre piège et bafouille sous les sarcasmes des gradins.
Pour prendre la mesure du choc et du basculement d’un horizon en trompe l’œil, il suffit de relire quelques-uns des esprits considérés comme forts du dernier demi-siècle.
De relire Bataille :
« À la vérité, les bourgeois ne peuvent réellement oublier que la liberté de leur monde est celle de la confusion. Ils ne sont à la fin que désemparés. Les résultats immenses de la politique ouvrière, la servitude provisoire généralisée, qui en est la seule conséquence assurée, les effraie, mais ils ne savent que gémir. Ils n’ont plus le sentiment de leur mission historique : le fait est qu’en réponse au mouvement ascendant des communistes, ils ne peuvent susciter le moindre espoir […]. Aujourd’hui la crainte de l’URSS obsède et prive d’espoir tout ce qui n’est pas communiste. Rien n’est résolu, sûr de soi, doué d’une intraitable volonté d’organiser, sinon l’URSS. Essentiellement, le reste du monde s’en remet contre elle à la force de l’inertie : il s’abandonne sans réaction aux contradictions qu’il porte en lui, il vit au jour le jour, aveugle, riche ou pauvre,
déprimé […]38. »
Bientôt, les spoutniks danseraient la farandole, les athlètes CCCP moissonneraient les médailles olympiques, Khrouchtchev promettrait de « rattraper et dépasser » les États-Unis avant la fin du siècle.
De relire Castoriadis, constatant doctement que l’État totalitaire à l’Est avait englouti jusqu’à la dernière miette de société civile, au point d’interdire tout autre avenir que l’éternité de sa sieste rassasiée : « Il est certain qu’on peut revenir de Franco, de Salazar, de Papadopoulos, des généraux brésiliens, probablement de Pinochet, pas d’un régime communiste une fois établi39. »
De relire Morin, empêtré dans les nœuds d’une impitoyable complexité, révélant au monde terrorisé que « l’URSS bénéficiait d’une supériorité stratégique irrémédiable » et qu’elle seule « pouvait avoir volonté et liberté de déclencher une attaque nucléaire surprise ». Envisageant le pire, il allait jusqu’à rêver d’une dictature militaire à Moscou comme d’un moindre mal : « Une dictature militaire à Moscou correspondrait non seulement à une relative libéralisation intérieure, mais aussi à une relative modération extérieure40. » C’était en 1983. La stagnation brejnévienne avait déjà fait son œuvre.
L’événement a giflé ces prophètes à la volée.
Sans qu’ils aient eu seulement la dignité d’en rougir ou de s’expliquer.
Les leurres de la puissance se sont effondrés comme un décor de carton-pâte, laissant deviner dans des coulisses obscures un bric-à-brac de vieux outils, de poulies mal graissées, de costumes abandonnés. Un changement si soudain de paysage politique et intellectuel ne peut laisser intactes les architectures de pensée de la période antérieure. Sans doute faudra-t-il bâtir une pensée d’après le déluge. Mais l’heure de l’urgence et du sauvetage est d’abord celle des bricoleurs de génie.
[|•••|]
Sans même le savoir, comme d’instinct face à de nouveaux périls, un Guefter trouve à tâtons les mêmes pauvres outils dont Benjamin faisait l’inventaire au seuil de la catastrophe. Étrange affinité de vaincus qui refusent de se rendre. Au moment où l’avenir s’affaisse comme une falaise minée, tous deux nous rappellent à nos dettes messianiques : on est toujours le messie de quelqu’un.
« Nous sommes attendus », disait Benjamin.
Nous sommes « les commissionnaires des morts », répond Guefter.Car, disait déjà Péguy, c’est une mauvaise déformation de l’esprit pédagogique, « que cette tendance invincible, que nous avons, que cette tentation de faire servir, de faire compter notre compte aussi pour nos enfants, pour les générations suivantes41». C’est encore un vice de l’esprit de confort, de l’esprit de descendance, de continuité et de postérité. Un effet domestique de l’angoisse historique. Laissons donc « nos enfants s’installer pour eux, compter pour eux, commencer pour eux. Ils ont sept ans. Ils ont douze ans. Laissons les faire leurs comptes, qu’ils nous chassent ». Ceux par qui nous sommes attendus, ceux qui n’ont plus que nous sur qui compter, ce sont en revanche les vaincus d’hier et de toujours, que Guefter appelle « les morts toujours vivants ».
Leur attente impérieuse ne laisse pas reposer la mémoire.
La mémoire, « c’est toujours de la guerre », disait Benjamin.
« À l’histoire comme à la guerre », répond Guefter.
Car il y avait dans la haine de Staline, cette haine étrangère à toute compassion, « l’exigence que toute action se fît oubli, attrapant dans ses filets la vanité de ceux qui se réjouissaient de ce que chaque jour amène des changements, des changements, des changements42 ». La ruine des idoles du lendemain provoque inversement un puissant retour de mémoire : « Il nous revient en mémoire tout ce qui a été perdu43. » Cela ne suffit pas encore à retrouver ce qui a été perdu, à le sauver de l’invasion de nouvelles broussailles mythologiques. Il faut se frayer un chemin. Il faut un travail. « Nous voilà au seuil du travail de la non-coïncidence [des peuples, des civilisations, des mondes], auxquels sont appelés à participer avec les mêmes droits que les vivants les morts toujours vivants. »
Au seuil donc d’une besogne de détotalisation.
À défaut d’un Dieu garant de l’unité cosmique, on a voulu croire que les fins de l’Histoire assureraient la rationalité de son parcours. Qu’au bout d’un chemin indéchiffrable, la transparence retrouvée en révélerait le sens ultime. Que le vrai, le bien, et le beau communieraient à nouveau dans la réconciliation générale. On a voulu restaurer dans le plan horizontal de l’Histoire et du temps, le monde clos enfui du cosmos et de l’espace. Et ça ne tient pas. Après le plafond céleste constellé d’étoiles fixes, l’arche terrestre du progrès cède à son tour.
[|•••|]
Les portes d’une Histoire ouverte battent sur des lendemains en friche.
Cuisante leçon d’humilité : « Notre avenir n’est ni une Commune universelle, ni une superpuissance, mais seulement un monde dans le Monde… Rien qu’un parmi les mondes… existe-t-il un but plus humain et plus concret, plus nouveau et plus accessible ? » L’effacement de la fin de l’Histoire sape l’ordonnancement de la temporalité historique. Le simple écoulement à sens unique de la durée ne peut plus tenir lieu de cause suffisante et de lien nécessaire entre ce qui précède et ce qui suit. L’ordre de succession n’est plus un ordre suffisant de rationalité et d’intelligibilité : « …le déroulement dans le temps devient simultanéité, les époques ne sont plus dans un rapport de succession, mais côté à côte, et les vivants administrent en toute liberté les morts. Il s’agit peut-être d’une généralisation abusive de notre propre syndrome, incompréhensible pour toute personne extérieure : qui de la christianisation de la Russie et de la révolution d’Octobre précède l’autre ? Qui de Staline, de Jean IV, de Gorbatchev et d’Alexandre II est venu le premier ? »
De sorte « qu’avancer aujourd’hui, c’est aussi repartir en arrière ».
Le déroulement causal de l’Histoire universelle ne produit plus un sens unique, dont le dernier mot viendrait couronner une totalisation absolue. Le sens jaillit au contraire dans les intermittences et les discontinuités de la durée, dans les rencontres et les chocs résurrecteurs entre un présent indécis et les virtualités d’un passé défait, auquel il donne une nouvelle chance. Pour Guefter, comme pour Benjamin, « le dialogue des généalogies est le chemin d’une nouvelle compréhension planétaire. Un chemin qui ramène à l’arythmie de l’évolution de l’être au monde de l’homme. Et tant pis si le mur intérieur ne s’écroule pas, ensevelissant sous lui les hommes à qui est offert le XXIe siècle. Il suffit de chercher une porte dans ce mur, une porte qui soit ouverte à chacun44 ».
Il retrouve ainsi la porte étroite par laquelle peut, à chaque seconde, entrer le Messie. Il cherche lui aussi les voies d’une Histoire non plus linéaire, mais cosmique et gravitationnelle, régie par les affinités et les correspondances, où l’écho répercute à travers les siècles le tonnerre des expériences fondatrices ; une Histoire où esthétique et théologie, loin de s’abolir, s’imbriquent dans le politique, qui est la Catégorie ouverte du présent.
Ainsi, la tâche nouvelle de l’historien n’est plus de reconstituer la vérité l’actuelle d’un passé irréversiblement accompli, mais de lancer la flèche du présent au cœur de l’événement pour en délivrer les possibles inaccomplis. Elle n’est plus de remonter et descendre la chaîne des effets et des causes, mais de braquer la torche du présent sur ces moments cruciaux, embranchements et bifurcations, où l’ordre temporel est remis en jeu et où se décident les rapports du réel et du virtuel.
Les révolutions sont de tels moments où s’interrompt le morne écoulement du temps profane.
Octobre comme embranchement…
Guefter écarte pourtant l’idée que 1917, la révolution d’Octobre, fût le moment d’un choix : « Y avait-il un choix en 1917 ? – la question est cardinale. Ayant beaucoup réfléchi à ce problème, je peux me permettre une réponse catégorique : il n’y avait pas de choix. Ce qui a été accompli alors était l’unique solution s’opposant à un remaniement infiniment plus sanglant, à une débâcle privée de sens. Le choix s’est posé après. Un choix ne portant pas sur le régime social, sur la voie historique à emprunter, mais devant être effectué à l’intérieur de cette voie. Ni variantes (le problème était plus vaste), ni marches à gravir pour atteindre le sommet (le problème se posait différemment), mais un embranchement. Des embranchements […]. Ici je m’oppose à ces conceptions schématiques posant Octobre en termes de “une fois pour toutes”45. »
Curieusement, la bifurcation se détache ici de l’événement, qui devient, au contraire, l’absolument nécessaire, l’instant du non-choix, comme si Guefter reculait devant le précipice ouvert de l’aléatoire de l’événement. Le choix n’intervient donc qu’après, « à l’intérieur de cette voie », un choix dont le champ est déterminé par l’inconditionné de l’événement.
Les véritables embranchements seraient alors ceux de la nouvelle politique économique, de la collectivisation forcée, et surtout « les plus énigmatiques de nos embranchements historiques – celui qui a donné la Constitution de 1936 et la terreur de l’année 1937 ». Position de compromis, qui récuse la rationalité linéaire de l’Histoire sans vouloir renoncer au point fixe et stable de l’origine ? Guefter affirme bien, sans la moindre ambiguïté, une conception non positiviste d’où découlent une méthode et un programme de recherche : « Le passé, pour moi, n’est pas une belle ligne droite à laquelle s’ajouteraient quelques déviations, quelques erreurs, c’est un tableau au mouvement infiniment plus complexe – l’Histoire tout simplement46. »
Par quelle élection et quel privilège alors, ou au prix de quelle invraisemblable contradiction, Octobre 1917 peut-il encore se tenir hors choix ? La peur des conséquences, la demi-mesure théorique, l’entêtement à ne pas tout remettre en cause ne fournissent guère d’explication satisfaisante. Peut-être faudrait-il s’interroger sur l’ambiguïté même de l’idée de choix. N’y a-t-il pas différents ordres de possibles impliqués dans cette douloureuse liberté de choisir, des ordres qui se contredisent, de sorte que pourraient exister des choix historiques qui ne soient pas des choix politiques ?
Des choix devant lesquels on n’a plus vraiment le choix ?
[|•••|]
À la fois événement politique et message symbolique, Octobre se dédouble. Hors d’une rationalité historique linéaire, il peut perdre la force de l’un tout en gardant la puissance de l’autre. S’effacer comme fait sans se renier comme promesse.
Car la mémoire est truffée d’explosifs à mèches lentes.
À moins de se lancer hardiment à la recherche d’un nouveau rapport à l’Histoire, ordre et désordre, nécessaire et contingent, rédemption et apocalypse continueraient à se défier comme d’inconciliables chiens de faïence. Toujours prête à passer dans le camp du vainqueur et à s’accommoder des restaurations, la raison historique reprendrait le dessus. « Si l’Histoire, comme le chœur, a raison envers et contre tout, son contenu vivant ne peut plus être un présent qui a vocation à se faire avenir, mais un présent qui hérite de tout passé ! Le règne des forces de la restauration, qui est aussi celui de la conception historique du monde peut commencer47. »
C’est aussi l’occasion de construire, avec les décombres d’un paysage dévasté, des figures encore inimaginables. Pouvons-nous concevoir ce que fut le vertige des hommes de la Renaissance, qui voyaient s’écrouler les voûtes du monde clos et se déchirer les coutures de l’horizon ? Pouvons-nous partager leur effroi devant l’unité brisée de la politique, de la morale, de la science, de l’esthétique ? Ce bouleversement a pourtant duré plus de deux siècles, des audaces de Colomb aux mécaniques de Newton, en passant par les prudences de Copernic, les passions de Kepler, les angoisses de Pascal.
« L’infini ouvrait sa gueule immense48. »
L’esprit religieux n’a pas renoncé pour autant. La transcendance n’est seulement couchée dans le lit de l’Histoire. La fin des temps a pris le relais du cosmos pour rétablir l’harmonie perdue. Le jugement dernier est descendu du trône céleste pour s’installer au bout du chemin terrestre.
Et voici que cet ordre horizontal cède à son tour. Hier, la découverte d’un univers soudain excentrique bousculait les hiérarchies de puissance et de valeur. Plus de haut, ni de bas. Aujourd’hui, la chaîne brisée des servitudes temporelles libère des fragments historiques flottant comme les pièces d’un puzzle dispersées.
Le Dieu de sinistre mémoire est à nouveau blessé.
Une nouvelle chance nous est offerte d’en finir avec Lui. Encore faut-il résister aux vertiges sceptiques qui suivent ces éclipses de la foi et poussent vers la terre ferme de nouvelles certitudes. Encore faut-il se cramponner dans le vide, à ce moment de doute, sans l’ériger lui-même en nouveau dogme. Quand on ne sait plus très bien ce que l’on cherche, il importe de savoir encore ce que l’on fuit. Avoir des ennemis communs est plus important qu’avoir des amis ordinairement communs. Nul besoin de causes premières ni de causes finales pour garder des convictions. Le critère du progrès, s’il garde un sens, n’est plus dans l’avancement gradué vers une terre promise, mais dans l’effacement des traces du péché originel (selon Benjamin), dans la réduction de l’espace du meurtre (selon Guefter) : progrès négatif conforme à la théologie négative qui sape avec abnégation le trône arrogant de la Raison historique.
[|•••|]
Peut-être touchons-nous au terme de cette obscure besogne.
La Première Guerre mondiale a porté un coup décisif aux illusions du progrès. Il en est résulté une première rébellion contre les diktats de l’Histoire universelle et la recherche tâtonnante d’une autre temporalité. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, furent parmi les pionniers somnambules de ces voies49. Les catastrophes de l’entre-deux-guerres et l’Holocauste ont donné une nouvelle impulsion à la théologie négative pour s’élever contre les lois tyranniques de l’Histoire. Toujours aussi rusée, la Raison historique a cependant obtenu un nouveau sursis. L’essor économique de l’après-guerre, les prouesses technologiques, le mouvement de décolonisation, ont laissé croire que le progrès avait repris sa marche victorieuse : dérapages et déviations ne seraient bientôt plus qu’un mauvais souvenir, une parenthèse refermée. Les crimes du nazisme et du stalinisme seraient imputables à un moment d’égarement, de déraison, dont la Raison rétablie ne saurait être tenue responsable. Parallèlement, la mécanique newtonienne subissait les assauts de causalités aléatoires et d’ordres chaotiques.
Il a fallu du recul pour mieux percevoir les rapports d’attraction mutuelle qui organisent un univers de pensée, pour comprendre les ramifications souterraines qui relient Copernic, Galilée et Bruno, Bacon, Kepler et Bodin, Grotius, Pascal et Spinoza… Il en faudra aussi pour comprendre le mouvement qui nous rattache aux pionniers d’une rationalité nouvelle, résolus à ce que les déceptions de la Raison historique ne nourrissent pas de nouveaux délires mythologiques.
Devant l’effondrement des dictatures bureaucratiques, nous sommes menacés de la même hébétude qui frappa Hegel lorsque Napoléon fut défait par l’Europe coalisée. Il savait bien, selon sa propre philosophie, que le tyran devait disparaître une fois son œuvre accomplie. Il avait même annoncé la victoire de l’Allemagne sur la France comme un passage obligé pour le triomphe de l’Esprit sur la puissance.
Mais « lorsque ceci advint », il fut « frappé de cécité devant l’accomplissement de ses propres paroles ». Il ne vit plus que « des Cosaques, Bachkirs, et autres excellents libérateurs ». Car il avait conçu l’anéantissement de l’ordre impérial du dedans, par l’Esprit, et voici qu’il se produisait « sous le poids de la médiocrité et de sa masse plombée ».
[|•••|]
Nous aussi, nous avons imaginé le renversement de l’empire bureaucratique sous l’élan intérieur d’une émancipation renaissante. Et revoici le poids de la médiocrité et de sa masse plombée ; revoici les Cosaques, Bachkirs, Baltes, Arméniens, Azéris, Tchétchènes, Croates, Serbes, Slovènes, Slovaques… et autres excellents libérateurs. L’événement attendu se consume sans rayonner comme une fusée humide. Nul n’en sortira indemne. « Quand l’édifice d’un monde s’écroule, les pensées qui l’inventèrent, les rêves qui l’entourèrent disparaissent sous les décombres. Qui pourrait se hasarder à prédire ce qu’apportera l’avenir éloigné, quel nouveau, quel insoupçonné, quel renouvellement de ce qui fut perdu50 ? »
Saura-t-on renoncer à transformer l’Histoire tragique de l’opprimé en une épopée victorieuse, à ériger le passé vaincu en monument d’un nouveau culte ? Saura-t-on échapper à l’éternité infernale des défaites sans passer du côté des victoires aux hanches lourdes ? Faudra-t-il aller jusqu’à remettre en question l’angoisse des origines, l’identification à l’événement fondateur, le retour à l’ordre primordial, qui sont encore des manifestations de l’esprit de croyance ? Faudra-t-il renoncer à guetter l’irruption, sur la ligne tremblante d’horizon, de ce par quoi le passé peut encore être sauvé ?
Peut-on être sans horizon ?
Peut-on rester en proie à ce manque ?
Manque de quoi, au juste ?
De l’impossible universalisation vers l’avant, sans laquelle scission et dispersion n’ont plus de fin, qui mobilisent leurs spectres guerriers ? De « l’impossible dégagement du terrain d’entente », de « l’impossible effectuation du commun qui assemblerait les hommes51 » ? Abolie l’hypothèse même de la vie en commun, il ne resterait que le destin génétique, que la solitude craintive et minérale des êtres, que des nations et des croyances hostiles, à jamais incapables de « rassembler ce qui est divisé ».
À cette fragmentation indéfinie, la raison communicationnelle n’apporte qu’une réponse illusoire52. Le contraire du partage raté, l’inaptitude au partage, c’est la scission partout aiguisée, jusque dans les mots, et le repli sur les valeurs locales ; c’est le déchaînement des « prophètes de la scission ». L’identification entre l’État, la classe et l’humanité est brisée. Mais, dans la fente de l’un en deux, la classe ne devient pas pour autant le principe d’un partage qui universalise contre celui de la scission qui particularise sans singulariser.
On annonce « le marxisme » moribond, si ce n’est déjà mort. La théorie de Marx résiste pourtant et se perpétue dans le non-dépassement de son objet. Ni le marché, ni la démocratie parlementaire ne triomphent. « C’est davantage dans la mémoire de ce qu’elle a eu à subir que dans l’ordre de ce qu’elle réalise que la démocratie trouve sa ressource la plus puissante. Ici, les pertes sont toujours plus parlantes que les profits. » Proclamée victorieuse par forfait, la démocratie reste « un mot litigieux » sous lequel le parlementarisme est le véritable bénéficiaire, qui subordonne toute politique à l’unique lieu étatique et exige comme conditions régulatrices des propriétaires et un « libre marché ».
Il suffit que l’ordre du monde demeure intolérable, pour que subsiste cette tension vitale de l’attente, de l’attente inquiète et affamée, jamais rassasiée par la certitude du lendemain, jamais assouvie par l’observation aveuglante d’un horizon désespérément vide. Ramassée sur elle-même, prête à bondir, elle scrute le présent qui fuit éperdument.
Le passement du temps n’a pas pouvoir d’abolir le pouvoir prophétique de l’événement. Rien ne peut faire que ce qui a un jour retenti soit étouffé à jamais.
« En effet, un tel phénomène dans l’histoire de l’humanité ne s’oublie plus, parce qu’il a révélé dans la nature humaine une disposition, une faculté de progresser telle qu’une politique n’aurait pu, à force de subtilité la dégager du cours antérieur des événements : seules la nature et la liberté réunies dans l’espèce humaine suivant les principes internes du droit étaient en mesure de l’annoncer, encore que, quant au temps, d’une manière indéterminée et comme événement contingent. Mais, même si le but visé par cet événement n’était pas encore aujourd’hui atteint, quand bien même la révolution ou la réforme de la constitution d’un peuple aurait finalement échoué, ou bien si, passé un laps de temps, tout retombait dans l’ornière précédente (comme le prédisent maintenant certains politiques), cette prophétie philosophique n’en perd rien pour autant de sa force. Car cet événement est trop important, trop mêlé aux intérêts de l’humanité et d’une influence trop vaste sur toutes les parties du monde pour ne pas devoir être remis en mémoire aux peuples à l’occasion de circonstances favorables et rappelé lors de la reprise de nouvelles tentatives de ce genre53. »
Kant écrivait ces lignes en 1785, à l’ombre de Thermidor.
Y voir un credo progressiste, un acte de foi dans la reptation obstinée de l’Histoire et dans l’avancement horizontal inéluctable serait un contresens. Si progrès il y a, il est de l’ordre, vertical, du jaillissement et de l’approfondissement, de la remémoration et de la fidélité.
Entre l’annonce d’un déclin continu et catastrophique de l’humanité, propice à tous les exorcismes, et la confiance dans une amélioration régulière inéluctable, qui ferait de l’Histoire un édifiant spectacle, se faufile l’intempestive liberté critique du présent. « Le chemin critique est seul ouvert » par lequel « la pensée sort de l’endos ». Pensée de la crise, où se brise la chaîne du temps, elle n’est pus mécaniquement progressiste, mais révolutionnaire, afin de rendre justice aux possibles qui ne furent que possibles, et dont la trace a failli s’effacer54.
L’Histoire s’illumine alors du pouvoir de commencer – ou de recommencer, qui ne se confond pas avec la capacité de fonder un État, ou d’édifier des institutions, mais qui s’éprouve comme « expérience de la liberté » ; qui ne dresse pas l’instauration contre la tradition, mais qui instaure une autre tradition, qui réveille et rappelle une tradition niée. « En un instant, une saute de temps laisse entrevoir ce que nul savoir ou nulle vue n’aurait pu anticiper, saisir, concevoir : un tout autre rapport au monde, un tout autre état du monde. » Car tout advenu ne fait pas événement. L’événement ne vaut ni par sa masse, ni par son bruit, ni par sa surprise. Bric-à-brac d’anecdotes, de péripéties et de faits divers, les journaux sont le cimetière quotidien des non-événements.
Il n’est pas donné à tout point cet étrange pouvoir de ne pas faire encore ligne. Il faut à l’événement ce mélange d’enthousiasme et d’effroi qui atteste une profonde blessure du temps, d’où s’envole soudain, dans l’éphémère de l’instant, le prodige d’une pensée nouvelle. On entend alors, par-delà l’épaisseur des siècles et la distance des continents, un étrange chuchotement de la nouveauté qui reconnaît la nouveauté. On entend enfin le dialogue souterrain, ordinairement imperceptible, des commencements qui saluent les commencements.
Car « seul un commencement est capable d’écouter d’autres commencements55 ». Tel est bien le secret de l’assourdissant silence produit par l’écroulement du « socialisme réel ». Il s’agit, à n’en point douter, du fait majeur de cette fin de siècle.
Ce fait pourtant, ne libère aucun possible. Il ne commence rien. Il ne délivre aucune pensée nouvelle, aucune « nouvelle manière de commencer ».
Il s’affaisse sur lui-même, dans le ressassement hébété du même.
Nous voici donc à l’instant précieux de l’étonnement.
De l’étonnement, qui est la condition de tous les recommencements.
De l’étonnement, qui est « un savoir brisé56 ».
[|•••|]
Nous voici donc sommés de savoir nous étonner, si nous voulons voir naître une pensée. Nous voici donc obligés de regarder l’Histoire autrement, d’un œil grand ouvert sur un monde insolite.
Heure féconde du réveil. Des démystifications et des désillusions. Des illuminations et des révélations. C’est l’occasion de conduire aussi loin que possible l’indispensable travail de désabusement et de déniaisement. Sachant désormais que celui qui va contre le courant va encore dans le courant.
Heure propice à la relecture de Marx.
Non pour restaurer l’authenticité d’une œuvre défigurée. Mais pour plonger en elle la pointe de notre présent. Non pour rétablir dans ses droits une vérité cachée. Mais pour réveiller les virtualités enfouies sous le sommeil dogmatique du marxisme orthodoxe. « La lecture partage avec le baiser ce mystérieux pouvoir de rappeler à la vie ce qui était endormi57. »
Le « marxisme », ce pelé, ce galeux, est accusé d’avoir prêché une religion du salut terrestre, d’avoir déchaîné les forces aveugles du productivisme, d’avoir béni les armes de la science et de la technique, d’avoir organisé le culte idolâtre du prolétariat, d’avoir porté à son comble la tyrannie totalitaire de la Raison historique. Les accusateurs ont des pièces, des textes, des citations, à produire. Dans une querelle scolastique, la défense pourrait fournir les pièces symétriques, qui contredisent où annulent les précédentes.
Mais il ne s’agit pas d’un pieux retour à Marx. Plutôt d’un « détour » nécessaire58. La lecture peut alors tirer un texte de sa torpeur et le remettre enjeu dans le champ de la mémoire théorique.
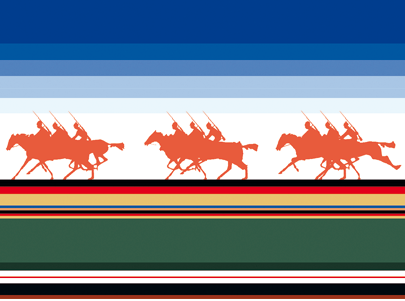
Documents joints
- Joseph de Maistre, Considérations sur la France, Bruxelles, Complexe, 1988.
- Voir Alain Brossat, « La mémoire captive », Philosophie, n° 4, Paris-VlII-Saint-Denis, 1992.
- Il s’agit de Newsweek dont la « une » fit sensation en 1977 et de l’Express.
- Voir notamment Henri Lefebvre, L’Idéologie structuraliste, Paris, Anthropos, 1971 et François Dosse, Histoire du structuralisme, Paris, La Découverte, deux tomes, 1991-1992.
- Voir Georges Politzer, Le Philosophie et les mythes, Paris, Éditions sociales, 1969.
- Voir André Glucksmann, stalino-cartésien « retourné », Descartes c’est la France, Paris, Flammarion, 1987.
- Georges Labica, Le Marxisme-léninisme, Paris, Éditions Bruno Huisman, 1984.
- Jean-Toussaint Desanti, Un destin philosophique, Paris, Biblio essais, 1984.
- Ibid.
- Dans son étude sur les partis politiques Ostrogorsky opposait déjà à la métaphore de l’unité organique l’acte libre de l’union ; au grand contrat définitif, les contrats constamment renouvelés. Alternative naïve, qui suppose une société libre d’individus raisonnables, abstraction faite des rapports de classe et de pouvoir, de l’aliénation et du fétichisme, elle n’échappe pas à la mystique du sujet, se contentant d’échanger le grand sujet jaloux contre des petits sujets privés. Un parti laïcisé, débarrassé des fantasmes du corps et de l’organicité, ne saurait être ni un surmoi, ni un but suprême, ni même une épousaille, mais tout simplement un accord, une association librement consentie et résiliable, en vue d’une pratique commune.
- Fernand Braudel, Le Monde, 6 juillet, 1983.
- Lucio Colletti, Le Déclin du marxisme, Paris, Puf, 1984.
- Jean-Toussaint Desanti, op. cit.
- André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Seuil, 1981.
- Bernard-Henri Lévy, interview au Nouvel Observateur, 1982.
- Alain Badiou, Peut-on penser la politique ?, Paris, Seuil, 1985.
- Jean-Toussaint Desanti, op. cit.
- Alain Badiou, op. cit.
- Ibid.
- Trotski, Staline, Paris, Grasset, 1948. Les arguments sur l’hétérogénéité de la classe et la pluralité de ses représentations se trouvent dans La Révolution trahie, Paris, 1936.
- Alain Badiou, D’un désastre obscur, Marseille, L’Aube, 1991. Voir aussi les réponses écrites aux questions de M. Galaz, revue Philosophie, n° 4, Paris-VIII-Saint-Denis, 1992.
- Jean-Christophe Bailly, La Comparution, Paris, Bourgois, 1992 (en collaboration avec J.-L.. Nancy).
- Comme l’écrit Emmanuel Lévinas : « La disparition de cet horizon me paraît un événement profondément troublant. Car elle bouleverse notre vision du temps. Depuis la Bible, nous sommes accoutumés à penser que le temps va quelque part, que l’histoire de l’humanité se dirige vers un horizon, même à travers des détours ou des vicissitudes. L’Europe a bâti sa vision du temps et de l’Histoire sur cette conviction et cette attente : le temps promettait quelque chose. Malgré son refus de la transcendance et de la religion, le régime soviétique était l’héritier de cette conception. Depuis la révolution de 1917, on avait le sentiment que quelque chose continuait à s’annoncer, à se préparer en dépit des obstacles et des erreurs. » Le Monde, 1992.
- Jean-Luc Nancy, op cit.
- Alain Badiou, D’un désastre obscur, p. 33.
- Jean-Christophe Bailly, op cit., p. 39.
- Ibid., page 9.
- Jean-Luc Nancy, op. cit., page 49.
- Alain Badiou, op. cit., page 25.
- Ibid., page 11.
- Jean-Christophe. Bailly, op. cit., page 40.
- Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, Berlin, 1823.
- « Nouveau » précis d’histoire de l’Union soviétique publié en 1990 par le quotidien Moskovskij Komsomolec, cité par Véronique Garros dans un remarquable article encore inédit, « Le poids du présent ».
- Mikhaïl Guefter, historien soviétique, recueil de textes et conférences en préparation aux éditions Verdier.
- Voir Françoise Proust, Kant, le ton de l’Histoire, Paris, Payot, 1991 : « Tout présent est critique ; tout présent est une bataille. L’Histoire est l’histoire du présent. »
- Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’Histoire. Voir à ce sujet Daniel Bensaïd, Walter Benjamin, sentinelle messianique, Paris, Plon, 1991, et Stéphane Moses, L’Ange de l’Histoire, Paris, Seuil, 1992.
- Peut-être vaudrait-il mieux parler de réflexion critique sur l’Histoire que de philosophie de l’Histoire, afin d’éviter la confusion avec les grands systèmes de philosophie de l’Histoire. Ce qui est intéressant, c’est de relever tant chez Benjamin que chez Guefter l’impossibilité désormais de faire de l’histoire sans problématiser son discours, sans creuser dans le récit même l’interrogation autoréflexive. Ni Histoire historienne ni philosophie de l’Histoire : la solution serait dans l’essai de philosophie historique.
- Georges Bataille, La Part maudite, Paris, éditions de Minuit, 1967, pages 179-182.
- Le Monde, 26 février 1983.
- Edgar Morin, La Nature de l’URSS, Paris, Fayard, 1983.
- Charles Péguy, Œuvres en prose, Pléiade II, Paris, Gallimard, page 766.
- Mikhail Guefter, « Le dit de la dignité », postface aux mémoires d’Anna Larina Boukharina, Boukharine, ma passion, Paris, Gallimard, 1990, page 373.
- Mikhail Guefter, « Convergence ou monde des mondes », conférence à paraître dans le recueil des écrits chez Verdier.
- Ibid.
- Mikhail Guefter, « Staline est mort hier », dans L’Homme et la société, 88/89, 1988, L’Harmattan.
- Ibid.
- Franz Rosenzweig, Hegel et l’État, Paris, Puf, 1991, page 240.
- Arthur Koestler, Les Somnambules, Paris, Calmann-Lévy, 1960.
- Voir Stephan Moses, L’Ange de l’Histoire, Paris, Seuil, 1992.
- Franz Rosenzweig, op. cit., p. 240 et 233.
- Jean-Christophe Bailly, op cit., page 12.
- Pour établir un lien organique entre socialisme et démocratie, Habermas dissout les intérêts de classe dans ceux de l’humanité en tant qu’espèce qui se constitue elle-même. Le paradigme de la production s’efface derrière celui de la communication ; les rapports sociaux deviennent rapports de communication. Par cette opération, la conscience morale est transférée de la raison pure individuelle au procès social de communication et les conditions universelles de l’entente mutuelle définissent une normativité immanente. La raison supra-individuelle des Lumières est ainsi sauvée et pluralisée dans l’intersubjectivité. Mais ce sauvetage continue à postuler une identité indémontrable entre l’intersubjectivité pratique et la raison en tant que sujet supra-individuel. L’intersubjectivité dont il est question, déracinée du rapport de production et de la domination qu’il reproduit, est aussi abstraite que celle impliquée dans la théorie rawlsienne de la justice. Elle présuppose des conditions de réciprocité généralisée là où il existe en réalité inégalité et violence, y compris dans le rapport communicationnel. « Les sujets de la communauté idéale de la communication de Apel, écrit Javier Muguerza, me donnent souvent la sensation d’être eux-mêmes des sujets idéaux, si ce n’est des ectoplasmes, plutôt que des êtres de chair et de sang. Quant à la situation de dialogue chez Habermas, j’ai souvent eu l’occasion de répéter qu’elle me rappelle la communion des saints, dans laquelle s’éteindrait tout conflit et où le dialogue lui-même Finirait par devenir superflu. » Voir notamment à ce propos Gyorgy Markus, Langage et production, Paris, Denoël, 1982 et Javier Muguerza, Desde la perplejidad, FCE, Madrid, 1990.
- Kant, Le Conflit des facultés.
- Françoise Proust, op cit., page 290.
- Ibid., page 123.
- Francis Bacon, Du progrès et de la promotion des savoirs, Paris, Gallimard, 1991.
- Comme le notait déjà Henri Lefebvre, « il est possible que chaque époque ait le Marx qu’elle souhaite ou qu’elle mérite ». Ce qui est alors enjeu, par-delà le retour aux textes, ce n’est pas une querelle de fidélité interprétative, mais la production d’une nouvelle compréhension en résonance avec notre présent : « Ne faut-il pas distinguer les compréhensions des interprétations ? Une nouvelle compréhension de la théorie marxiste s’introduit, disons-nous, en fonction d’une problématique nouvelle dans la pratique sociale. » (Henri Lefebvre, L’Idéologie structuraliste, Paris, Anthropos, 1971). Reste à savoir si les conditions de cette problématique nouvelle] dans la pratique sociale sont d’ores et déjà réunies.
- Selon l’expression d’Henri Maler, Thèse sur Marx et l’utopie, à paraître.