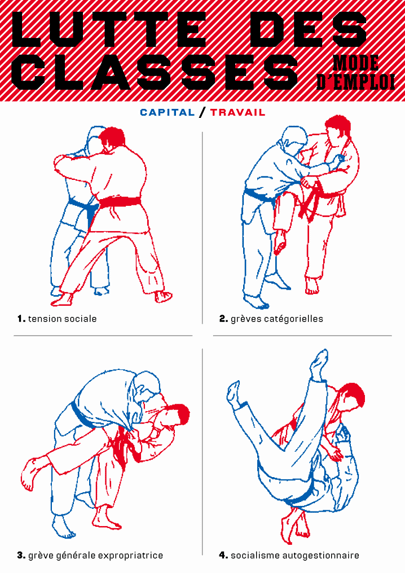
Avant les élections de mars, on a vu fleurir au sein du Parti communiste et du Parti socialiste, comme à leur pourtour, une abondante littérature sur la stratégie révolutionnaire. Depuis l’échec électoral, tout se passe comme si la stratégie était devenue muette, l’horizon tout à coup obstrué par un pour cent des suffrages.
Pourtant, en dix ans, le mouvement ouvrier français vient de connaître deux expériences essentielles et complémentaires. Celle d’une grève générale, la plus massive de son histoire, et de son impasse, dès lors qu’elle ne débouche pas sur la question du pouvoir politique. Celle de sa force électorale, et de sa fragilité, dès lors qu’elle ne repose pas sur une mobilisation extraparlementaire unitaire, enracinée dans les entreprises et les localités.
Edmond Maire déclarait dans une interview au Monde dès le 25 avril : « La grande leçon de ces dix dernières années pour tout le mouvement ouvrier de notre pays, c’est que nous sommes passés de la mobilisation sociale en mai 1968, sans alternative politique, à l’autre extrême : tout pour le changement politique, tout par les élections, sans mobilisation sociale ; cela, c’est mars 1978. » Cette fausse lucidité à retardement escamote la double responsabilité des directions politiques et syndicales : qui a refusé, en 1968, d’ouvrir un débouché politique sur la base de la centralisation et de la politisation du mouvement gréviste ? Qui a subordonné la riposte au plan Barre aux lendemains électoraux qui, à coup sûr, devaient chanter ?
Deux expériences : deux trahisons des directions réformistes. En 1968, elles prétendaient qu’on ne pouvait aller plus loin que les accords de Grenelle faute d’une solution politique. Depuis 1972 et la signature du Programme commun, elles prétendaient détenir cette solution et en tiraient argument pour différer tout affrontement prématuré avec le pouvoir : à l’automne 1974, au moment de la grève des postiers ; en octobre 1976 en canalisant la riposte au plan Barre par des journées d’action sans lendemains ; au lendemain des municipales de 1977, en refusant de pousser l’avantage face à un régime battu, déconfit et sur la défensive.
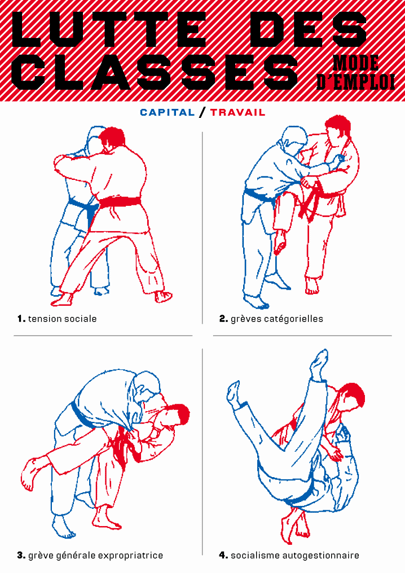 I. Mai 1968 : la grève générale et la crise révolutionnaire
I. Mai 1968 : la grève générale et la crise révolutionnaire
Ce qui a brutalement pris corps et chair en mai 1968, à l’encontre de toutes les théories sur l’embourgeoisement de la classe ouvrière et le dépassement des contradictions de classe dans la société de bien-être et de consommation, c’est l’actualité de la révolution socialiste. C’est surtout l’actualité du concept léniniste de crise révolutionnaire, sans lequel la prise du pouvoir par le prolétariat, classe exploitée et dominée idéologiquement, devient rigoureusement impensable.
Sans la métamorphose soudaine de millions de travailleurs qui brisent dans la crise le cycle infernal de leur soumission au capital et de leur aliénation, la capacité du prolétariat à s’ériger en classe dominante, à émerger du néant pour devenir « tout », devient une question insoluble. C’est pourquoi tout escamotage de la crise révolutionnaire conduit tôt ou tard à remplacer la perspective de la révolution par un processus graduel et électoral de conquêtes partielles, à substituer au but le mouvement.
La perspective stratégique de la grève générale insurrectionnelle, sur laquelle nous reviendrons, s’appuie sur cette hypothèse de la crise révolutionnaire qui permet seule de briser le cercle vicieux du réformisme et des tactiques parlementaires.
À la veille de 1968, la France de De Gaulle ressemblait trait pour trait à la France louis-philipparde, à la veille de la Révolution de 1848, magistralement peinte par Tocqueville dans ses Souvenirs : « Comme toutes les affaires se traitaient entre les membres d’une seule classe, suivant ses intérêts, à son point de vue, on ne pouvait trouver de champ de bataille où de grands partis puissent se faire la guerre. Cette singulière homogénéité de position, d’intérêt et par conséquent de vues qui régnait dans ce que M. Guizot avait appelé le pays légal, ôtait au débat parlementaire toute originalité et toute réalité, partant toute passion vraie […]. Le pays était alors divisé en deux parts ou plutôt en deux zones inégales : dans celle d’en haut, qui seule devait contenir toute la vie politique de la nation, il ne régnait que langueur, impuissance, immobilité, ennui ; dans celle d’en bas, la vie politique au contraire commençait à se manifester par des symptômes fébriles et irréguliers que l’observateur attentif pouvait aisément saisir1. »
Les élections législatives de 1967 n’avaient donné que quelques sièges d’avance à la majorité gaulliste sans que le rituel des motions de censure déposées par l’opposition parvienne à redonner un peu de « passion vraie » à la routine parlementaire. En revanche, les « symptômes fébriles » se multipliaient bel et bien dans la France d’en bas sans que gouvernement et partis s’en émeuvent : luttes étudiantes, manifestations anti-impérialistes, explosions ouvrières de Caen, Redon, Mulhouse, prenant le relais des grandes grèves de Saint-Nazaire et de la Rhodiaceta… Il eût fallu un observateur attentif pour saisir ces transformations moléculaires qui déclenchent la révolte chez un jeune ouvrier de Redon et donnent une soudaine intrépidité à des étudiants bien craintifs et studieux.
Tout à la politique institutionnelle, P. Viansson-Ponté n’était pas cet observateur qui écrivait à la une du Monde, quelques semaines avant l’irruption : « La France s’ennuie. » Il n’avait d’yeux que pour la partie visible de la société, celle de « la langueur, l’impuissance, l’immobilité ». Il n’était pas le seul. Dirigeants socialistes et communistes furent tout autant pris de court. De Gaulle aussi qui s’était, à la manière de Louis-Philippe, « retiré dans une espèce de solitude orgueilleuse, où finit presque toujours par vivre l’intelligence des princes longtemps heureux, qui, prenant la fortune pour le génie, ne veulent plus rien écouter, parce qu’ils croient n’avoir plus rien à apprendre de personne ».
Ce divorce entre l’effervescence sociale et l’immobilisme politique n’eut pas pour seule conséquence l’effet de surprise qui fit, pour tant d’observateurs médiocres, de Mai 68 un coup d’éclair dans un ciel serein. Il y en eut d’autres, plus profondes et plus graves, sur l’incapacité de la grève générale à trouver son propre débouché politique, à se consolider par l’auto-organisation, l’élection de comités de grève, le passage à la grève active.
Mai 68 marque bien, comme l’a souligné Ernest Mandel2, le sommet de la spontanéité ouvrière en Europe, depuis le jaillissement des conseils et des milices dans la Catalogne de juillet 1936. Mais il marque du même coup les limites de cette spontanéité : son incapacité, en l’absence de parti révolutionnaire implanté, à forger et centraliser les instruments de la dualité du pouvoir, et à apporter une réponse politique centrale dans le sens du gouvernement des travailleurs.
1. Grève générale et double pouvoir
De 1902 à 1905 s’étaient développés de larges mouvements grévistes en Europe. En Russie bien sûr, mais aussi en Italie, en Allemagne et en Belgique où les travailleurs avaient déclenché, en 1902, une grève générale pour le suffrage universel, qui fit l’objet d’une vive polémique entre Rosa Luxemburg et Émile Vandervelde. L’explosion de Mai 68 en France fut précédée par les grandes grèves belges de 1960-1961, par les explosions revendicatives de Turin (1962) et antifasciste de Gênes (1960), par les luttes des Asturies et l’apparition des commissions ouvrières en Espagne de 1962 à 1967, par les grandes manifestations de 1965 en Grèce.
À travers la notion de grève générale, la contribution de Rosa Luxemburg ouvrait en fait le débat de fond sur la crise et la stratégie révolutionnaire au sein de la social-démocratie allemande et internationale. Pour elle, la grève de masse comme les grèves belges de 1902 ou russe de 1905 s’oppose aussi bien à la conception anarchiste de la grève sur commande comme panacée révolutionnaire qu’à la récupération réformiste de la grève générale comme simple auxiliaire des batailles parlementaires.
Avec sa brochure3, elle tire le débat de l’impasse en inscrivant la grève de masse dans la dialectique concrète de l’organisation de la classe et de la formation de sa conscience. Elle dépasse du même coup le face-à-face stérile entre les anarcho-syndicalistes, pour qui la grève générale est le moyen de la révolution sociale, et les socialistes parlementaires qui leur opposent les gains de l’arithmétique électorale. Pour elle, la mobilisation des masses jette un pont entre les revendications sociales et les exigences politiques, à condition de comprendre la lutte de classe comme une lutte prolongée, dans la dimension de sa durée : « C’est sur le même terrain de la considération abstraite et sans souci de l’histoire que se placent aujourd’hui ceux qui voudraient entamer prochainement en Allemagne la grève de masse à un jour déterminé du calendrier et ceux qui, comme les délégués du congrès syndical, veulent faire disparaître du monde le problème de la grève de masse en en interdisant la propagande. L’une et l’autre tendance partent de l’idée commune et purement anarchiste que la grève de masse n’est qu’un simple moyen technique qui pourrait à volonté, en toute science et conscience, être décidée ou inversement interdite, sorte de couteau à virole qu’on peut tenir fermé comme en-tout-cas dans sa poche, ou au contraire ouvert, prêt à servir à toute éventualité. »
Quand elle analyse la grève de masse, Rosa Luxemburg aborde, à travers le mûrissement de la conscience de classe, la préparation de la crise révolutionnaire : « La révolution russe (de 1905) a pour la première fois dans l’histoire des luttes de classes rendu possible une réalisation grandiose dans l’idée de la grève en masse et même de la grève générale, ouvrant ainsi une nouvelle époque dans l’évolution du mouvement ouvrier… Les événements de Russie nous montrent la grève en masse inséparable de la révolution. L’histoire de la grève en masse en Russie, c’est l’histoire de la Révolution russe. »
Où la bureaucratie social-démocrate ne pouvait imaginer que la « tactique éprouvée » du travail municipal et parlementaire, elle entrevoit, brisant le cours de ce temps uniforme et de cette progression graduelle, les accélérations et les changements brusques, qui font entrer de nouvelles forces en action et bouleversent les rapports de forces. Elle entrevoit aussi que le fondement du pouvoir prolétarien ne saurait se ramener à la base trop étroite du parti qui prétend incarner à lui seul l’entièreté de la classe : « Si la grève en masse, si la lutte de masse doit avoir un résultat, il faut qu’elle devienne un véritable mouvement populaire, autrement dit entraîne dans la lutte les couches les plus étendues du prolétariat. Déjà dans sa forme parlementaire, la puissance de la lutte de classe prolétarienne ne repose pas sur le petit noyau organisé mais sur la vaste périphérie qui l’entoure du prolétariat, animé d’un sentiment révolutionnaire. Si la démocratie socialiste voulait n’engager la lutte qu’avec ses deux ou trois centaines de milliers d’organisés, elle se condamnerait elle-même à la nullité […]. » Ce qui est donc posé en pointillé, dès 1905, avant même que Rosa Luxemburg n’ait pu mesurer la portée historique et stratégique de l’expérience des soviets, c’est la dialectique du parti et de l’auto-organisation massive de la classe dans les périodes révolutionnaires.
En mai 1968, les directions réformistes se sont opposées pied à pied à toute la dynamique révolutionnaire de la grève générale. D’abord en refusant d’en lancer le mot d’ordre et en se contentant d’enregistrer l’extension de la grève pour bien montrer à la bourgeoisie qu’il n’y avait de leur part nul projet subversif4. Mais il ne faut pas voir là une simple différence de vocabulaire entre une grève générale constatée et une grève générale décrétée. Se contenter du constat, c’était du même coup, pour les dirigeants syndicaux, esquiver l’épineux problème de la centralisation de la lutte et de son organisation démocratique. C’était du même coup l’enfermer dans les limites d’une grosse grève revendicative, laissant les mains libres aux tractations parlementaires des partis.
Ici se vérifient les limites de l’admirable spontanéité ouvrière de 68. Les travailleurs furent comme surpris par l’explosion soudaine de leur propre combativité, au point de ne pas savoir en utiliser la force redoutable. La conscience peu préparée, non fécondée par un réseau de militants d’avant-garde implantés, retardait sur l’expérience et contenait en retour cette expérience en deçà d’un processus massif d’auto-organisation et de politisation. Il en est résulté que le canal de représentation traditionnelle des organisations syndicales et politiques fut peu remis en question et que les effets de 68 dans la classe ouvrière furent souterrains et retardés. C’est ce qui permit aux directions d’apporter avec l’Union de la gauche une réponse préventive à la radicalisation anticapitaliste sur le terrain électoral et parlementaire.
2. La grève générale et le gouvernement
En mai 1968, la question du pouvoir était objectivement posée par la grève générale… Mais elle ne le fut pas subjectivement, faute d’un parti révolutionnaire. Il y eut des conciliabules d’états-majors autour de Mitterrand et de Mendès pour préparer la relève, au cas où… Mitterrand envisagea la formation d’un « gouvernement de personnalités » avec participation des communistes, afin de pouvoir canaliser et maîtriser le mouvement de masse, aussi imprévu pour lui que pour les gouvernants : « Les événements se sont déroulés pendant plusieurs semaines sans que le gouvernement exerçât sur eux la moindre prise. Leur brusque aggravation a dépendu d’une série de hasards et de malentendus, leur déclenchement d’une décision de police et de l’irréflexion d’un ministre5. »
Pour la première fois depuis 1947, Mitterrand envisageait donc l’entrée des communistes au gouvernement, mais en tant que candidat Premier ministre il entendait que ce gouvernement fût « sans dosage ». Autrement dit, il revendiquait les pleins pouvoirs quant à sa composition. Il serait ainsi en mesure d’offrir à la bourgeoisie toutes les garanties nécessaires, jusqu’à lui réserver une place prépondérante par le choix des personnalités, tandis que le PCF se verrait attribuer la tâche habituelle d’organiser le retour discipliné au travail : « J’estimais que la présence communiste rassurerait plus qu’elle n’inquiéterait. Cette affirmation semblera aujourd’hui téméraire. Mais je savais que ni leur rôle ni leur nombre dans l’équipe dirigeante n’avaient de quoi effrayer les gens raisonnables qui, à l’instant même, voyaient dans la CGT et Séguy les derniers remparts d’un ordre public que le gaullisme se révélait impuissant à protéger face aux coups de boutoir des amateurs de la révolution. »
Ultérieurement, chaque fois que la question gouvernementale s’est posée, Mitterrand est resté fidèle à cette ligne de conduite. Aux présidentielles de 1974, il s’est présenté seul sur la base d’une charte distincte du Programme commun, non discutée au sein du PS, et sans que le PCF trouve alors à y redire. Quant à l’Union de la gauche, elle ne faisait qu’institutionnaliser cette perspective d’un gouvernement de collaboration de classes, tant du point de vue de son programme que de sa composition éventuelle.
Dès le lendemain du rassemblement de Charléty, le 28 mai, Mitterrand avançait l’idée d’un « gouvernement populaire6 » présidé par Mendès. Le 29, la CGT défilait seule aux cris de « gouvernement populaire ». Le 30, de Gaulle, de retour de Baden-Baden, annonçait les élections générales, aussitôt acceptées par les directions réformistes.
La seule réponse qu’il convenait d’apporter à la question gouvernementale lors de ces journées était celle d’un gouvernement des partis ouvriers majoritaires, du PC et du PS, sans ministres bourgeois. Mais, en l’absence de centralisation de la grève générale sur une plate-forme unitaire et en l’absence de son auto-organisation démocratique, le divorce restait profond entre la mobilisation sociale et la politique des partis. De sorte que le mot d’ordre de gouvernement PC-PS ne pouvait apparaître que sous la forme d’une combinaison parlementaire et non comme le débouché politique du mouvement de masse, et responsable devant lui.
Il en est résulté pour beaucoup de militants d’avant-garde issus de l’expérience de Mai une difficulté durable à penser l’articulation de la mobilisation sociale et d’un débouché politique prenant la forme de l’unité des partis ouvriers. Il en est résulté également une profonde déformation économiste de la plupart des organisations d’extrême gauche, qui posèrent la perspective révolutionnaire sur le modèle d’un nouveau Mai 68 poussé jusqu’au bout et réussi.
En somme, l’expérience de la grève générale et de la crise révolutionnaire ne constituait que la carcasse d’une stratégie possible. Elle laissait entières des questions essentielles : d’une crise à l’autre, quelles sont les formes de recomposition du mouvement ouvrier ? Le parti révolutionnaire est-il condamné à recruter au compte-gouttes ? Et, dans ce cas, en quoi les données subjectives de la prochaine crise révolutionnaire seraient-elles qualitativement modifiées ?
Toujours dans le débat sur la grève générale, Rosa Luxemburg tire la stratégie révolutionnaire de l’ornière des décisions statiques de congrès pour poser la question centrale de la formation et du développement de la conscience de classe à l’épreuve de la pratique. C’est un pas décisif vers la solution d’un vieux problème : comment une classe exploitée et dominée peut-elle poser sa candidature au pouvoir ? Comment peut-elle émerger de sa servitude pour apporter sa solution révolutionnaire à la crise économique et sociale ? On dirait aujourd’hui : comment peut-elle affirmer son hégémonie politique et culturelle ?
La bourgeoisie devient hégémonique économiquement et culturellement bien avant de s’emparer directement du pouvoir politique. Elle a pour elle le temps, l’argent, le savoir. La prise du pouvoir n’est que le couronnement d’une position dominante déjà établie. Pour s’imposer, le prolétariat doit au contraire briser l’étau de son exploitation quotidienne. Il n’y parvient que dans les circonstances exceptionnelles qui transfigurent la grande masse des travailleurs. Mais ces périodes de crise n’ont de chance de déboucher sur la conquête durable du pouvoir que si le mouvement ouvrier est déjà préparé à cette éventualité, s’il a gagné la confiance de la majorité des travailleurs conscients et des couches intermédiaires par sa capacité à apporter ses réponses et à opposer ses valeurs à la crise de la société capitaliste.
C’est ce facteur subjectif que Trotski souligne dans son Histoire de la Révolution russe. Il y reprend les « indices d’une situation révolutionnaire » en insistant sur la « réciprocité conditionnelle des prémisses : l’impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination inchangée […] ; l’accentuation de l’activité des masses […] ; le ralliement au prolétariat, des classes moyennes […]. » Mais comme Lénine il s’accorde à voir dans l’action du parti révolutionnaire le facteur subjectif capable de transformer une situation révolutionnaire en crise révolutionnaire dans laquelle la lutte pour le pouvoir est engagée : « La capacité, dont parlait Lénine, en ce qui concerne la classe révolutionnaire à mener des actions de masse assez vigoureuses pour briser l’ancien gouvernement qui ne tombera jamais même à l’époque des crises, si on ne le fait pas choir7. »
Encore cette insistance sur l’élément subjectif de la crise révolutionnaire est-elle insuffisante si on ne précise pas la nécessité pour l’avant-garde révolutionnaire de s’appuyer sur la majorité active de la classe. La simple conjugaison de l’idée de crise révolutionnaire et de la nécessité d’un parti d’avant-garde peut aussi bien déboucher sur une politique volontariste et putschiste, telle qu’elle fut théorisée au début des années 1920 par Lukacs et Tahleimer, et pratiquée par le jeune PC allemand lors de l’action de mars 1921.
La bataille pour la conquête de la majorité de la classe s’exprime à travers la tactique du front unique, dont les bases furent jetées par les IIIe et IVe congrès de l’Internationale communiste. C’est en fécondant cette bataille pour le front unique d’une perspective révolutionnaire que le parti révolutionnaire se construit, forge l’unité de la classe et prépare ses cadres aux tâches de la crise révolutionnaire.
Alors que la faible politisation du mouvement de masse en 1968 mettait en évidence les limites subjectives liées à la domination absolue des réformistes sur le mouvement ouvrier, la massivité et la soudaineté de la grève générale tendaient en revanche à masquer cette même faiblesse : comme s’il avait suffi de prendre rendez-vous à la prochaine grève générale pour qu’elle emporte tout sur son passage. Ce n’est donc pas tout à fait par hasard si Mai 68 a nourri, fût-ce de façon marginale, une résurgence de la vieille idéologie anarchiste de la grève générale, dans certains secteurs syndicaux (« Et si on arrêtait tout… »), ou plus simplement dans la mythologie cinématographique (L’An 01 et son envers individualiste Bof).
À l’instantané anarchiste de la grève décrétée, Rosa Luxemburg oppose clairement la construction et la consolidation d’un mouvement à travers la lutte : « C’est par le prolétariat, que l’absolutisme doit être renversé en Russie. Mais le prolétariat a besoin pour cela d’un haut degré d’éducation politique, de conscience de classe et d’organisation. Toutes ces conditions, il ne peut se les procurer dans des brochures et des feuilles volantes ; elles ne lui viendront que de l’école pratique, vivante de la lutte et dans la lutte au cours de la Révolution en marche. »
À la différence de 1968, la « répétition générale » de 1905 avait légué au prolétariat russe, avec les soviets, la forme enfin trouvée de la dualité de pouvoir. Elle lui avait légué l’ossature d’un parti soudé par une perspective stratégique commune et reconnu par l’avant-garde ouvrière. Mais elle lui avait aussi légué, à travers l’expérience soviétique, les éléments d’une tactique de front unique, qui trouvèrent entre février et octobre 1917 une lumineuse application, dont la théorisation fut postérieure.
II. 1978 : front unique contre Union de la gauche
Les directions réformistes du PC et du PS ont su tirer, à leur manière, les leçons de Mai 68. L’Union de la gauche fut leur réponse préventive pour canaliser dans une politique de collaboration de classes l’immense potentiel anticapitaliste qui s’était exprimé. Front de collaboration de classes, elle s’est inscrite dans la continuité de la politique d’alliance avec la bourgeoisie systématisée par le VIIe congrès de l’Internationale communiste avec l’adoption de la ligne des fronts populaires8.
Opposant la collaboration de classe à l’indépendance de classe, cette politique multiplie les liens qui enchaînent la classe ouvrière à la remorque de ses exploiteurs.
– Par le Programme commun lui-même, qui part de ce que la bourgeoisie est supposée accepter et non de ce qui est nécessaire aux travailleurs : la polémique entre le PC et le PS a porté sur le smic et sur le seuil de nationalisations, mais ils restaient d’accord pour laisser au second plan ou passer sous silence l’échelle mobile des salaires et la réduction massive des heures de travail, pour laisser la place prépondérante à la propriété privée et refuser l’expropriation sous contrôle ouvrier des secteurs clefs de l’économie, la planification autogérée de l’économie, le monopole sur le commerce extérieur.
– Par les alliances et les engagements institutionnels : engagement à garder Giscard et à se soumettre à la Constitution de 1958, donc à respecter l’intégrité du territoire au détriment des revendications d’indépendance pour les colonies et d’autodétermination pour les nationalités opprimées ; alliances avec les radicaux et gaullistes de gauche qui offraient à la bourgeoisie le gage d’alliances plus larges à l’avenir si nécessaire.
Parce qu’il était un programme de collaboration de classe, le Programme commun portait en lui la division. Parce qu’il avait pour perspective la gestion de la société capitaliste, il débouchait dans le contexte de crise sur un partage de l’austérité entre les travailleurs, sur l’abandon des revendications de plein-emploi au détriment des femmes et des immigrés, sur une négociation des inégalités salariales sous prétexte de lutte contre la hiérarchie.
Parce qu’elle était un front de collaboration de classes, l’Union de la gauche portait en elle la division. Dans les critiques qui se sont élevées après le 19 mars, celles d’Althusser comme celles d’Elleinstein, rien n’est dit sur la période qui va de la signature de juin 1972 à la désunion de septembre 1977. Comme si ces cinq années de lutte de classe pouvaient être mises entre parenthèses. Comme s’il n’y avait rien à en dire. Comme si la politique de leur parti commençait et finissait sur le seul terrain des alliances électorales. Comme s’ils voulaient ignorer que la politique de l’Union de la gauche s’opposait par nature à l’organisation d’une riposte unitaire contre l’austérité.
Les aspirations unitaires légitimes de millions de travailleurs sont frappées de plein fouet par la division du PC et du PS, prolongée par la division des syndicats. Mais cette division aux effets réels et profonds perpétue à sa façon la mystification en présentant en retour l’Union de la gauche comme l’unité perdue. En fait d’union, il ne s’est jamais agi que de l’unité des appareils pour tendre la main à la bourgeoisie. Parce que telle était sa fonction, l’Union de la gauche ne pouvait tolérer que se constituent les bases d’unification de la classe, à travers l’unité syndicale ou la mise en place de comités d’action : l’unité au sommet sans unité à la base pour laisser les mains libres aux manœuvres des appareils.
Althusser regrette après coup que l’unité de la classe n’ait pas été scellée par la mise en place de tels comités unitaires. Il renoue ainsi avec le seul aspect progressiste de la politique de front populaire initialement formulée par Dimitrov : l’élection de comités d’action unitaires par tous les organes et groupes participant à la mobilisation9.
Mais cette clause est précisément toujours restée lettre morte. Althusser devrait se demander pourquoi. De tels comités ne sauraient voir le jour par simple décret ou en tant que comités électoraux (comme ce fut le cas avec les éphémères comités d’unité populaire au Chili). Leur existence et leur vitalité supposent la mobilisation. Il aurait été possible dès septembre 1976 de lancer des comités d’action unitaires contre l’austérité. Dans leur lutte quotidienne de tels comités auraient eu à se poser et à résoudre la question des salaires, celle des fermetures d’usines… Ils auraient adopté démocratiquement au feu de la pratique des mots d’ordre sur le smic, les nationalisations, et bien d’autres questions quotidiennes de la lutte des classes. Dès lors, il aurait été infiniment difficile aux directions de rompre sur ces sujets par-dessus la tête des travailleurs. Car de la signature du Programme commun à l’accord bâclé du 13 mars, en passant par les claquements de porte du 22 septembre, tout s’est fait au nom des travailleurs sans qu’ils aient jamais eu voix au chapitre. Ni le PC ni le PS ne pouvaient en appeler à leur verdict unitaire en proposant des réunions intersyndicales, des assemblées d’entreprise et de quartier se prononçant sur les problèmes en litige. Le PS aurait couru le risque d’y voir désavouée sa politique d’austérité de gauche ouvertement annoncée depuis le congrès de Nantes et défendue avec énergie par Rocard. Le PC aurait couru le risque de voir soulevées des revendications qu’il écarte et de voir désavoué son chantage au désistement.
Dès lors que la classe ouvrière entre en lutte sur ses propres objectifs, elle est en mesure d’administrer la preuve que l’unité dans l’action et la confrontation des divergences maintenues ne sont pas incompatibles. La vieille formule du front unique, « marcher séparément et frapper ensemble », ne dit rien d’autre10.
Du point de vue de la lutte des classes, les questions du programme et du désistement devaient être dissociées. Les arguments sur le contenu programmatique auraient eu d’autant plus de force que chaque parti aurait annoncé clairement qu’il n’en faisait pas une précondition au désistement mutuel entre partis ouvriers pour chasser Giscard-Barre : la défaite de la majorité présidentielle aurait créé un rapport de forces plus favorable à ceux qui voulaient sincèrement mettre en avant des objectifs anticapitalistes.
Mais la discussion programmatique du PC n’était qu’un prétexte et un mauvais prétexte. Marchais conditionnait l’unité d’action à un accord préalable sur le programme. Rocard répondait qu’il fallait un programme au rabais pour rendre possible l’unité. Rocard eut en somme le dernier mot. Puisque le PC ne pouvait sans risque de suicide électoral pousser au-delà du second tour son préalable programmatique au désistement, il finit par se contenter, une fois la défaite consommée, de l’accord honteux du 13 mars, qui ne réglait aucun des problèmes soulevés et ne lui permettait même pas de sauver la face.
Cet exemple du désistement montre comment l’existence d’un mouvement unitaire aurait permis de déjouer l’entreprise de division du PC et du PS et de « les mettre d’accord ». Il suffisait que chaque comité intersyndical ou comité unitaire rappelle les exigences sur lesquelles il s’était prononcé, la plate-forme qu’il présenterait à tout gouvernement futur, et qu’il appelle les partis ouvriers à se désister inconditionnellement l’un pour l’autre au second tour.
Toute l’histoire des six dernières années montre comment la politique de front unique, d’unité et d’indépendance de classe s’oppose terme à terme à la politique de collaboration de l’Union de la gauche.
– Il s’agit d’une politique d’unité de la base au sommet permettant d’opposer l’unité démocratique de la base aux divisions et aux manœuvres du sommet, jusqu’à dresser la base des partis réformistes contre leurs directions.
– Il s’agit d’une politique qui puise sa force dans la mobilisation unitaire des travailleurs et permet de mettre en avant leurs revendications anticapitalistes.
– Il s’agit d’une politique qui s’oppose aux pactes et alliances avec la bourgeoisie. À ceux qui voyaient dans le Front populaire un cheval de Troie qu’il serait possible de tourner un jour contre la bourgeoisie, Trotski répondait : « Pour tourner le Front populaire contre la bourgeoisie, il faut d’abord chasser la bourgeoisie du Front populaire11 », d’où la nécessité de la rupture de tous les liens avec la bourgeoisie, de la collaboration avec Giscard et sa Constitution, comme de l’alliance avec les radicaux et les gaullistes.
Il s’agit enfin d’une politique qui permet de poser la question gouvernementale à travers le mot d’ordre d’un gouvernement des partis ouvriers majoritaires s’appuyant sur les comités et les organisations unitaires de la classe.
Sur la question du front unique, les leçons des six années d’Union de la gauche rejoignent celles de Mai 68 et bouclent la boucle des éléments nécessaires à une stratégie révolutionnaire.
III. Stratégie révolutionnaire, démocratie socialiste, dictature du prolétariat
Il ne suffit pas d’extraire les grandes lignes d’une stratégie révolutionnaire aujourd’hui de la double expérience de 1968 et de 1978. Il faut aussi les confronter à la perspective d’instauration du pouvoir prolétarien, vérifier l’adéquation des moyens au but.
Le PC et le PS ont besoin d’une couverture idéologique à leur pratique de collaboration de classe. Sous des formules qui peuvent varier d’un pays à l’autre, les partis communistes et socialistes d’Europe du Sud mettent en avant la notion de « démocratie mixte », autrement dit la combinaison des formes de démocratie directe issues des luttes de masse et des formes de démocratie représentatives incarnées par les institutions parlementaires et municipales bourgeoises12.
Cette « innovation » théorique présente un triple avantage, pour les PC, pour les PS et pour la classe dominante elle-même :
– aux PC elle offre un moyen commode de se débarrasser du concept de dictature du prolétariat (sous prétexte de rompre avec la terreur stalinienne), et un alibi pour mieux se rallier au respect des institutions et de l’État bourgeois13 ;
– aux PS elle permet de concilier une réhabilitation zélée de la démocratie parlementaire et une phrase gauche sur l’autogestion à la base, qui va directement à la rencontre des projets technocratiques et modernistes de l’administration d’État14 ;
– à la bourgeoisie elle offre l’occasion de relégitimer un système de domination dont la tradition démocratique parlementaire est de plus en plus recouverte par l’étatisme autoritaire, et de donner une caution « libérale avancée » à ses réformes.
La notion de démocratie mixte s’oppose à la tradition révolutionnaire, celle de la démocratie directe, de la Commune de Paris aux comités de grève et commissions de travailleurs, en passant par les conseils ouvriers turinois et les soviets, au nom de la lutte contre l’économisme et le corporatisme. En effet, opposer la « pyramide » des soviets ou des conseils à l’appareil d’État bourgeois comporterait selon les auteurs à la mode un fort danger de poujadisme : l’addition d’usine en localité, de localité en région, jusqu’au niveau central, des points de vue parcellaires ne saurait donner naissance à une volonté collective et à un projet politique global, mais seulement à une juxtaposition d’intérêts fragmentaires qui se neutralisent dans le meilleur des cas. Dans le pire, ils font le lit d’un parti unique qui les coiffe et les domine en se nourrissant de leur impuissance.
Au nom de ce danger supposé, certains comme Viveret et Rosanvallon, sous prétexte de réhabiliter la spécificité du politique, ont développé la théorie des deux cultures dans le mouvement ouvrier (étatiste et autogestionnaire)15. Jugé à l’épreuve de la pratique, leur néolibéralisme débouche sur une restauration du parlementarisme et une apologie de l’économie de marché qui constitue le fondement ultime de cet âge d’or de la démocratie représentative. Lorsqu’elle quitte le domaine des projets littéraires pour passer dans les faits, la démocratie directe n’est jamais qu’une béquille pour les institutions discréditées et un exutoire à l’aspiration démocratique des travailleurs. C’est le cas des commissions extra-municipales sans pouvoir de contrôle ni de veto mises en place dans certaines municipalités de gauche. Quand la démocratie directe menace d’empiéter sur les prérogatives institutionnelles, les réformistes se chargent d’en tracer énergiquement la frontière comme ce fut le cas dans les municipalités communistes en Italie, qui se sont opposées à ce que 10 % de la population puissent exiger un référendum sur certains projets d’aménagement urbain.
Quant à la démocratie directe dans les luttes, il suffit d’un coup d’œil dans le rétroviseur pour constater que jamais le PC ni le PS n’ont impulsé dans la lutte de tels organes souverains : conseils ou comités de grève élus. Le comble, c’est qu’ils justifient leur prudence au nom des risques de manipulation. Comme si les millions d’électeurs invités à poser leur bulletin dans l’urne et à rentrer chez eux n’étaient pas autrement manipulables qu’une assemblée de travailleurs élisant des délégués sur la base de mandats précis.
Maintenir la perspective de la dictature du prolétariat (c’est-à-dire la nécessité de briser l’ossature de l’État bourgeois et de le remplacer par la démocratie des producteurs associés), ce n’est pas seulement fixer un but à la lutte de classe, c’est du même coup déterminer à grands traits les moyens pour l’atteindre. En un mot le but et la stratégie sont indissolublement liés.
Dans son dernier livre, Poulantzas apporte cette justification sophistiquée à l’abandon du concept de dictature du prolétariat. Il convient maintenant de le répudier parce qu’il remplissait une « fonction historique précise : celle d’occulter le problème fondamental, celui précisément de l’articulation d’une démocratie représentative transformée et de la démocratie directe à la base. Ce sont là les vraies raisons qui justifient, à mon sens, son abandon, et non parce que cette notion a fini par s’identifier au totalitarisme stalinien […]. Il ne s’agit pas à vrai dire de faire la synthèse entre deux traditions du mouvement populaire, l’étatiste et l’autogestionnaire, qu’il faudrait coller ensemble. Il s’agit de se situer dans une perspective globale de dépérissement de l’État, perspective qui comporte deux processus articulés : la transformation de l’État et le redéploiement de la démocratie directe à la base. C’est la désarticulation de ces deux démarches qui a donné lieu à une scission sous la forme des deux traditions16. »
Contrairement à ce qu’écrit Poulantzas, le concept de dictature du prolétariat ne vise pas chez Lénine, au moment des premiers congrès de l’Internationale communiste, à « occulter » l’articulation des formes de démocratie. Il vise explicitement à trancher en faveur de la prééminence de la démocratie directe, contre les défenseurs de « l’articulation » que furent déjà Kautsky et les austromarxistes.
Il faut noter ensuite que Poulantzas se paie de mots quand, refusant de se prononcer, il s’évade dans « la perspective globale du dépérissement de l’État » qui permettrait de concilier démocratie directe et démocratie représentative : pour que l’État commence à dépérir, il faut qu’il cesse d’exister comme sphère séparée, que le pouvoir se résorbe dans la société civile. Or, comment le pouvoir pourrait-il être socialisé s’il n’est pas directement exercé par les collectifs de producteurs en tant que tels, supprimant les fonctions spécifiques de police, d’administration, de justice, et dépassant tendanciellement la division capitaliste du travail ?
Faute de résoudre le dilemme, si ce n’est verbalement, Poulantzas en reste à peser les pour et les contre du point de vue de Sirius : vulgairement parlant, le cul entre deux chaises. Mais cette position inconfortable n’est pas politiquement innocente. Bien au contraire. Entrant dans l’histoire concrète et contemporaine, Poulantzas délivre cet impitoyable verdict : « Apparaît à propos des transformations de l’appareil économique d’État le dilemme : ne pas en faire assez (Chili) ou en faire trop. Ce dernier cas est celui du Portugal entre 1974 et 1975 où des branches entières de l’appareil économique telles que les ministères de l’Agriculture et de l’Industrie, pourtant entièrement contrôlés par la gauche et acquis à une expérience socialiste radicale, furent totalement paralysés, non pas en raison des résistances de la bourgeoisie, mais en raison des formes et des rythmes de brisure adoptés pour leurs transformations. » Ce jugement se situe uniquement du point de vue de la mobilisation des masses elles-mêmes et du mouvement de la lutte des classes : simple question de dosage dans les ruptures entre le trop et le pas assez. Comme si, derrière le trop peu chilien ne se tenait pas la politique réformiste de l’appui à la grève générale en octobre 1972, la liquidation des comités de ravitaillement et des noyaux révolutionnaires dans l’armée, l’opposition à toute centralisation des cordons industriels, et non une question de degré dans les initiatives ministérielles. Comme si, au Portugal, l’offensive de normalisation du PS contre les commissions de travailleurs (démocratie directe) au nom de la souveraineté de la Constituante (démocratie représentative) et la politique de division du PC aligné sur une fraction du MFA n’avaient pas été les facteurs déterminants du contrecoup de novembre 1975, et non pas une politique trop hâtive de réforme agraire, de nationalisations et de reconversions industrielles.
En pratique, l’abandon de la dictature du prolétariat et son dépassement formel par l’articulation de la démocratie mixte servent toujours à légitimer les institutions parlementaires et, en dernière analyse, à les opposer aux organes de démocratie directe dès lors qu’ils entrent en conflit17. Toute l’expérience historique prouve qu’un tel conflit est inévitable.
C’est pourquoi nous tenons à réaffirmer, quelles que soient les survivances des formes de démocratie représentative, que la démocratie directe doit primer. Elle ne constitue pas une forme démocratique parmi d’autres, auxquelles il suffirait de l’articuler, mais une forme supérieure : comme Gramsci l’avait lucidement perçu dès l’expérience de Ordino Nuovo, à travers les comités, conseils ou soviets, le travailleur surmonte la fracture de l’homme et du citoyen, le dédoublement entre l’homme privé et l’homme public, la lésion entre l’économique et le politique.
Quant à l’objection selon laquelle un système fondé sur la démocratie directe, la fameuse « pyramide des conseils », porterait en son sein le double danger de juxtaposer des points de vue corporatifs et de laisser le champ libre à la centralisation réelle à travers un parti unique, nous y répondrons en avançant deux axes :
– Tout d’abord, il est absurde et schématique de présenter un tel système comme fonctionnant purement de bas en haut, par addition de préoccupations localistes et « corporatives » aux échelons successifs. Confrontées à des choix d’ensemble au niveau régional ou local, les collectivités démocratiques de base se prononcent à partir d’un débat sur des projets et des programmes globaux qui s’opposent sur les questions essentielles. C’est pourquoi le pluripartisme que nous défendons n’est pas une simple clause démocratique, mais la condition même pour qu’à travers la démocratie des conseils puisse se former une volonté générale, se dégager une orientation, qui ne sauraient résulter de la synthèse naturelle des points de vue parcellaires18.
– Ensuite, il est absurde et simpliste de présenter cette pyramide comme un corps homogène et indifférencié de la base au sommet, du quartier ou de l’usine jusqu’au gouvernement. La réponse que nous apportons aujourd’hui à la crise du territoire « national », déchiré par la concentration et la centralisation internationale du capital, débouche, au-delà des revendications immédiates d’autodétermination, sur la perspective d’autonomie socialiste ; c’est-à-dire d’assemblées régionales dans le cadre de la dictature du prolétariat, appuyées sur les comités d’usine et de localité, disposant d’un droit de veto sur tous les grands choix les concernant (énergétiques, transport, enseignement et culture). Il s’agit d’une réorganisation spatiale du pouvoir qui seule peut apporter une réponse à la crise des territoires nationaux dans la perspective des États unis socialistes d’Europe et constitue une médiation active dans le dégagement d’une volonté collective sous l’hégémonie de la classe ouvrière19.
D’ores et déjà il apparaît clairement à quel point le but et les moyens sont liés. Se prononcer pour la dictature du prolétariat et pour la souveraineté des organes de démocratie directe implique des conséquences pratiques pour la stratégie révolutionnaire :
– Défendre, susciter, promouvoir toutes les expériences de démocratie ouvrière : assemblées, comités de grève, délégués élus et révocables. Défendre l’unité et la démocratie fédérative dans les syndicats. Défendre l’autonomie d’un mouvement de masse unitaire des femmes. Qui peut prétendre que les tenants de la démocratie mixte aient systématiquement mis en avant ces formes de lutte et leur aient reconnu un quelconque droit, fût-ce celui de veto, sur les décisions d’un conseil municipal ou toute autre assemblée « représentative » ?
– Défendre le pluralisme et admettre la pluralité des partis au sein du mouvement ouvrier. Mais cela ne saurait être purement formel. La défense du pluripartisme passe d’abord par le refus de toute exclusive dans l’action contre des organisations ouvrières, même minoritaires. Elle a pour contrepartie la bataille pour l’unité dans l’action des partis ouvriers dans une perspective de front unique de classe. Qui peut prétendre que les tenants de la démocratie mixte aient été bien sourcilleux sur les exclusives, voire la répression syndicale pour délit d’opinion pratiquée par le PC, le PS ou un syndicat autogestionnaire comme la CFDT ?
– Défendre les revendications grâce auxquelles les travailleurs sortent de leur simple défense en tant que salariés pour remettre en cause le pouvoir du patronat dans l’entreprise et la propriété privée des moyens de production. Il s’agit de revendications que nous appelons transitoires, au premier rang desquelles celles d’expropriation, de contrôle ouvrier sur la production, d’ouverture des livres de comptes. Comment pourrait-il exister une démocratie directe des producteurs, si ces derniers n’entreprennent pas à travers leurs luttes de devenir agissants et de prendre leurs affaires en main ? Qui peut prétendre que les tenants de la démocratie mixte aient mis systématiquement en avant ces réponses, au moment de la querelle sur les nationalisations et sur la fuite des capitaux par exemple ?
– Défendre la réduction massive du temps de travail, aussi bien pour lutter contre le chômage que pour se donner les moyens d’un réel exercice de la démocratie : les 35 heures tout de suite, vers les 30 heures. Si les tenants de la démocratie mixte ne s’engagent pas en toute clarté sur de tels objectifs – et ils ne l’ont pas fait –, comment pourraient-ils nier que la démocratie de ceux qui ont du temps, celle des représentants professionnels, la démocratie dite représentative étouffera et dominera la démocratie directe de ceux qui travaillent 40 heures et n’ont ni le temps de vivre, ni celui de contrôler et de décider ?
– Défendre le droit de vivre, travailler, décider au pays, en rejetant les tutelles de l’État bourgeois. Le PC et le PS se prononçaient avant les élections de mars pour l’élection d’assemblées régionales, mais soucieux de ne pas porter atteinte à l’intégrité du territoire, ils ne mettaient en cause ni la tutelle des préfets, ni celle de la Datar, et surtout ne se posaient pas le problème de la responsabilité de ces assemblées devant leurs électeurs.
– Faire pénétrer le point de vue de classe, par effraction, dans toutes les institutions étatiques, appareils idéologiques et services, qu’il s’agisse de l’école, de la santé, de l’information, de l’armée ou de la justice. Toutes ces institutions sont traversées par des contradictions de classe. La politique révolutionnaire consiste à relier pratiquement ces contradictions aux enjeux centraux de la lutte des classes en brisant le huis clos institutionnel : par la revendication de droits nouveaux des exploités à l’éducation, au logement, à la santé, à la culture ; par le droit de regard ou de contrôle des organisations ouvrières sur ce qui se passe dans l’enseignement ou dans les casernes ; par la syndicalisation des soldats dans les syndicats ouvriers pour qu’ils exigent tous leurs droits de travailleurs sous l’uniforme ; par la levée des clauses de secret professionnel ou de devoir de réserve qui lient les personnels de l’État.
C’est à travers une telle démarche que la lutte dans les institutions peut s’appuyer et s’intégrer à la perspective globale d’émergence de la dualité de pouvoir. Poulantzas se situe aux antipodes lorsqu’il écrit : « La voie démocratique au socialisme est un long processus dans lequel la lutte des masses populaires ne vise pas à la création d’un double pouvoir parallèle et extérieur à l’État mais s’applique aux contradictions internes de l’État […]. Ce processus long de prise du pouvoir dans une voie démocratique au socialisme consiste pour l’essentiel à déployer, renforcer, coordonner et diriger des centres diffus dont les masses disposent toujours au sein des réseaux étatiques en en créant et développant de nouveaux, de telle sorte que ces centres deviennent sur le terrain stratégique qu’est l’État les centres effectifs du pouvoir réel. »
Poulantzas fait mine de combattre une position naïve qui verrait le double pouvoir surgir en extériorité absolue au pouvoir d’État, comme deux monolithes face à face. Nous pensons au contraire que les institutions d’État sont traversées de contradictions et qu’il est possible et nécessaire de peser dessus. Mais quand Poulantzas parle de coordonner et déployer des « centres diffus » (!) à travers les réseaux étatiques, à partir de quel « centre central », ou de quelle colonne vertébrale entend-il le faire ? À partir d’un état-major clandestin ? Non ? Alors en articulant les luttes dans l’institution au centre que constituent aujourd’hui le mouvement ouvrier organisé et demain le surgissement d’organes soviétiques ! Il ne s’agit pas d’investir l’État mais de peser sur ses contradictions pour en briser les rouages. Il ne s’agit pas d’influencer une couche d’officiers mais de briser la hiérarchie militaire en ralliant soldats et officiers dans des comités unitaires et démocratiques aux côtés de la classe ouvrière. Parler de « centres effectifs du pouvoir réel », sur le « terrain stratégique qu’est l’État » (sans même préciser qu’il s’agit encore de l’État bourgeois) montre, s’il en était encore besoin, que le bavardage sur la démocratie mixte sert bel et bien de couverture idéologique à un ralliement sans condition aux institutions étatiques et parlementaires actuelles.
IV. Alliances, front unique, hégémonie
La politique stalinienne se caractérise par une oscillation (ou une combinaison) entre les alliances de collaboration de classe (fronts populaires) et de sectarisme de la « troisième période ». Ce sont les deux revers d’une même politique s’accommodant fort bien de la définition des partis staliniens eux-mêmes comme uniques partis de la classe ouvrière. Le PCF l’a encore illustrée ces derniers mois en combinant les gages les plus larges donnés à la bourgeoisie (pacte avec les radicaux et les gaullistes, Union du peuple de France) avec la dénonciation de la social-démocratie accusée de revenir à sa nature profondément bourgeoise, et les exclusives contre les organisations révolutionnaires.
La question qui se trouve évacuée dans ce tourniquet perpétuel du sectarisme et de l’opportunisme est celle de la tactique de front unique amorcée par l’Internationale communiste de 1921-1922 et presque aussitôt enterrée par le stalinisme.
1. Cet escamotage historique et théorique permet aux auteurs de tradition stalinienne, selon les circonstances, de valoriser la ligne des fronts populaires comme une ligne antisectaire, corrigeant les erreurs dévastatrices de la troisième période où le combat prioritaire contre le social-fascisme facilita l’ascension du fascisme tout court. Ces auteurs ne font ainsi que reprendre à leur compte et entretenir délibérément la confusion des années trente. L’écho des fronts populaires dans les masses ouvrières tient au fait qu’elles y virent, après les ravages de la division, l’unité enfin réalisée de leurs partis et de leurs syndicats, sans voir le revers de la médaille : la subordination de cette unité à l’alliance avec les bourgeoisies. Trente ans plus tard, Jean-Pierre Delilez n’avance pas d’un pouce lorsqu’il écrit : « Les analyses communistes avant le Front populaire se bornaient à considérer que le réformisme était en définitive une composante des forces politiques bourgeoises et on allait même dans certains cas jusqu’à faire de l’organisation socialiste le levier essentiel de la réaction. C’est contre cette conception sommaire et sectaire que la lutte du PCF pour le Front populaire a été menée. » Même son de cloche chez Althusser lorsque, pour critiquer la politique du PCF envers le PS depuis un an, il se tourne vers la tradition du Front populaire et tresse des lauriers à son théoricien Maurice Thorez20 !
Il faut donc réaffirmer avec force que, malgré son importance, la question des alliances de classes est aujourd’hui secondaire, subordonnée à la question centrale qui est celle de l’unification de la classe ouvrière elle-même. À condition bien sûr de s’entendre sur la définition de la classe ouvrière et de ne pas la réduire aux seuls ouvriers d’industrie ou aux seuls travailleurs directement productifs. Il ressort du dernier recensement de l’Insee21 que la bourgeoisie à proprement parler représente environ 5 % de la population active (industriels et gros commerçants, les fractions supérieures des exploitants agricoles, des professions libérales, de la hiérarchie militaire et des cadres administratifs). La petite bourgeoisie traditionnelle constituerait au total 15 % de la population active : exploitants agricoles, artisans et commerçants, une partie des professions libérales et des artistes. La nouvelle petite bourgeoisie de fonction (professions libérales salariées, cadres administratifs moyens ou supérieurs, maîtrise) représenterait entre 6 et 12 % selon qu’on y inclut ou non les enseignants. Au bout du compte la petite bourgeoisie formerait donc 25 % environ de la population active alors que le prolétariat en formerait à lui seul plus des deux tiers, de 65 à 70 % (ouvriers, employés, techniciens, personnels de service, salariés agricoles).
Pour justifier l’importance donnée aux impératifs des alliances, les théoriciens du PCF sont systématiquement conduits à minimiser le poids du prolétariat, au prix de définitions restrictives et théoriquement erronées. Ils parviennent ainsi à séparer la classe ouvrière (44 %) des « couches intermédiaires salariées », soit plus de 30 % de la population active qui flotte quelque part dans l’intermède entre les classes fondamentales : une bagatelle ? Avantage non secondaire de l’opération : le PCF peut se définir comme le seul parti de la classe ouvrière (et éventuellement la CGT comme son vrai syndicat) en faisant du PS et des autres syndicats le parti et les syndicats des « couches salariées intermédiaires ».
Dès lors que l’on rejette ces alibis bureaucratiques, il devient inévitable de se prononcer sur la nature de classe du PS. Par son implantation, par ses liens avec les syndicats, par son électorat (30 % de l’électorat ouvrier contre 33 % au PC) il s’agit d’un parti qui a des comptes à rendre aux travailleurs. Ce qui n’exclut pas qu’il applique une politique bourgeoise, mais au prix de contradictions internes et dans ses rapports avec les travailleurs autres que pour un parti bourgeois qui défend purement et simplement les mandats de ses conseils d’administration. C’est pourquoi nous parlons du PS comme d’un parti ouvrier bourgeois et l’incluons dans notre bataille pour l’unité des organisations ouvrières.
Le PCF a besoin au contraire de maintenir le PS hors des organisations ouvrières, fût-ce au prix de zigzags spectaculaires et de la désorientation de ses propres militants. Delilez, dans son livre publié peu avant l’attaque du CC d’octobre 1977 sur la nature du PS, n’écrivait-il pas que les partis sociaux-démocrates sont des partis ouvriers réformistes « qui ont pu, quoique ce fût une erreur, être assimilés à des partis bourgeois » : « les partis qui se réclament des intérêts ouvriers, qu’ils soient réformistes ou révolutionnaires, ne fonctionnent pas de la même façon que les partis bourgeois ». Et Delilez de prendre pour exemple les partis socialistes allemand et travailliste anglais… A fortiori, le Parti socialiste français ! Mais admettre la caractérisation du PS comme parti ouvrier bourgeois impliquerait envers lui une politique de front systématique et non d’alliance circonstancielle. Elle introduirait en outre une différence qualitative entre les alliances au sein du front unique de classe et les alliances de collaboration de classe avec les formations bourgeoises. Engrenage dans lequel le PCF n’est pas prêt à s’engager (ni le PS d’ailleurs).
La question centrale est donc bien pour nous celle de l’unification de la classe ouvrière, passant par la lutte sur les revendications unifiantes face aux entreprises de division de la bourgeoisie, par l’unité des organisations ouvrières (partis et syndicats) autour d’objectifs anticapitalistes, par l’auto-organisation dans les luttes. Autour de ce front uni de classe peuvent se rallier et se regrouper tous ceux qui sont des victimes indirectes du grand capital et n’exploitent pas eux-mêmes directement la force de travail d’autrui : petits paysans, artisans et commerçants. Cette alliance est d’autant plus concevable que le programme du prolétariat implique aujourd’hui au premier titre l’expropriation des grandes entreprises, propriétés et commerces, mais non nécessairement la coopérativisation forcée pour les petits agriculteurs et commerçants. L’important, c’est qu’il s’agit d’un regroupement volontaire de forces sur le programme et sous la direction de la classe ouvrière et non d’alliance au sens historique et programmatique du terme, scellée par des mots d’ordre tels que « la terre aux paysans » dans le programme agraire du parti bolchevique22.
2. La tactique de front unique a pour fonction de mobiliser unitairement les travailleurs et leurs organisations afin que le niveau de conscience progresse sur la base de l’expérience commune. Elle n’implique aucune illusion sur le fait que les organisations réformistes en tant que telles et leurs directions pourraient se laisser entraîner sur une voie révolutionnaire ; elle a au contraire pour but à travers les instruments de l’action unie (syndicats, comités, soviets) de forger les organes permettant la rupture des masses envers leurs directions si nécessaire23.
C’est pourquoi le front unique ne saurait se limiter en aucun cas à un appel à l’unité pour l’unité. « Nous disons, écrivait Trotski en 1935, que le besoin instinctif d’unité est très souvent un besoin spécifique des masses ; mais la bataille consciente pour l’unité sur une base révolutionnaire est spécifique à l’avant-garde du prolétariat… Au moment des journées de Brest et de Toulon, les quatre appareils bureaucratiques (du PS, du PC, de la CGT et de la CGTU) étaient absolument comme un seul homme pour étrangler le soulèvement en échange d’un sourire amical de la part des radicaux. Le front unique fut ainsi transformé en instrument de collaboration avec la bourgeoisie. La fusion organisationnelle des deux partis, si elle se réalisait, ne signifierait dans les conditions actuelles que la préparation de l’unité nationale. Jouhaux et Monmousseau ont déjà achevé l’unification syndicale en sauvegardant les intérêts de leurs appareils mais en interdisant les tendances, c’est-à-dire qu’ils ont pris les devants pour tordre le cou au socialisme révolutionnaire. Quand les centristes, emboîtant le pas aux droitiers, commencent à trop déclamer à propos de l’unité, le devoir des marxistes est d’être sur leurs gardes. Unité avec qui ? Au nom de qui ? Contre qui ? À moins d’une claire définition des buts et des tâches le slogan d’unité peut devenir le pire piège24. »
Le but c’est de féconder le front unique d’un contenu révolutionnaire pour porter à un point de rupture la contradiction entre le mouvement des masses et la politique des directions.
Pour cela, la politique révolutionnaire consciente doit s’insérer dans le front unique. Sous quelle forme ? Cela dépend bien sûr des rapports de forces à un moment donné. Initialement, dans la version des congrès de l’Internationale communiste, sous forme de participation au front unique d’un parti révolutionnaire implanté, d’une alliance entre révolutionnaires et réformistes. Dans des cas où le rapport de forces est beaucoup plus défavorable, comme en 1935-1936, les révolutionnaires peuvent prendre leur place dans le front unique par des opérations « centristes » dans les partis de masse. C’est ce que préconisait Trotski aux marxistes révolutionnaires français en 1935, critiquant vertement ceux qui s’y refusaient sous prétexte d’intransigeance : « Les opposants à l’entrisme étaient précisément ces éléments qui se contentaient de groupes végétant passivement et qui commençaient, de façon sans cesse plus opportuniste, à s’adapter de l’extérieur au front unique entre la SFIO et le PC. » Dans d’autres circonstances enfin, l’insertion dans le front unique pour le féconder peut se limiter à la bataille pour les mots d’ordre les plus urgents dans le mouvement de masse et pour l’auto-organisation démocratique de la lutte. Le but permanent restant de confronter la politique des directions aux exigences et revendications des travailleurs, portées par leurs organisations unitaires de combat : syndicat unifié, comités d’action, etc.
De ce point de vue, la politique de front unique revêt bel et bien un double aspect : tactique : dans la mesure où il s’agit d’une politique visant à l’unité des travailleurs (telles qu’elles sont) dans lesquelles se retrouvent les travailleurs ; stratégique dans la mesure où elle vise en dernière analyse à l’unification de la classe, de sa forme la plus élémentaire (le syndicat) à sa forme supérieure : le soviet25.
C’est ce rôle charnière de la politique de front unique dans la préparation subjective de la classe ouvrière à l’exercice du pouvoir, dans sa capacité à se constituer en alternative sociale et politique, que perçoit justement Perry Anderson dans son livre sur Gramsci : « Car la tâche assignée au front unique reste sans solution cinquante ans plus tard. Les masses d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale et du Japon doivent encore dans leur majorité être gagnées au socialisme révolutionnaire. Il en découle que la problématique principale du front unique – le dernier conseil stratégique de Lénine au mouvement ouvrier occidental avant sa mort et le premier souci de Gramsci en prison – garde toute sa valeur aujourd’hui. Historiquement elle n’a jamais été dépassée. Gagner la classe ouvrière reste un besoin impératif avant qu’il puisse être le moins du monde question de prise du pouvoir. Le moyen de réaliser cette conquête – non pas des institutions étatiques mais de l’approbation des travailleurs, bien qu’en fin de compte il ne doive plus y avoir aucune démarcation entre les deux – est la première démarche de toute stratégie réellement socialiste aujourd’hui26.
3. C’est ce que refusent de voir tous ceux pour qui la réflexion stratégique commence avec le Front populaire et s’achève dans l’impasse des alliances parlementaires27.
Prise au sérieux, la politique de front unique permet au contraire d’apporter une réponse aux contradictions centrales de la révolution prolétarienne sur lesquelles viennent obstinément buter les auteurs mal débarrassés des schémas staliniens. Il faut, nous disent-ils, que la classe ouvrière s’affirme comme classe dirigeante ou hégémonique, qu’elle se constitue en alternative sociale, économique et culturelle, avant même de pouvoir prétendre à l’exercice du pouvoir.
Ce n’est pas faux. La dualité du pouvoir surgie brutalement d’une crise révolutionnaire dans les pays capitalistes développés, sans reposer sur un long travail de préparation subjective de la classe, serait précaire et vulnérable du point de vue de la classe ouvrière dans les pays capitalistes développés. Trotski ne pensait pas à autre chose quand il disait que le pouvoir serait, dans ces sociétés, plus difficile à prendre qu’en Russie, mais plus facile à garder. Mais quelles conclusions en tirer ? Anderson rappelle et établit sans ambiguïté possible que, pour Gramsci, cette conquête de l’hégémonie (explicitement liée à l’idée du front unique) ne débouche pas sur le gradualisme parlementaire de ses faux héritiers : elle n’exclut pas mais prépare le dénouement par l’affrontement de deux pouvoirs antagoniques dans la crise révolutionnaire28.
C’est à ce titre qu’une stratégie révolutionnaire aujourd’hui doit assigner au mouvement ouvrier de masse, à commencer par les syndicats, une fonction de totalisation de la lutte de classe, visant à apporter ses propres réponses sur tous les terrains :
a) Si la lutte trouve bien son épicentre dans l’entreprise et dans la résistance à l’exploitation elle ne doit pas s’y emmurer, mais au contraire embrasser, du point de vue des rapports d’exploitation qui régissent la relation travail salarié-capital, l’ensemble des rapports et mouvements sociaux. C’est la condition même pour que la contestation du capitalisme ne retombe pas en révoltes fragmentaires et corporatives, mais débouche sur une vision unifiée du monde et sur un projet de transformation conscient de la société. Il ne s’agit donc pas de juxtaposer les luttes de la jeunesse, des femmes, des soldats, des régions ou nationalités opprimées, des mouvements écologistes, comme des annexes ou dépendances de la lutte de classe, mais de les concevoir comme des dimensions transversales, entrelacées, qui toutes renforcent l’unité du combat et donnent corps à l’alternative révolutionnaire. L’implantation directe des syndicats sur les lieux de production avec la reconnaissance des sections syndicales d’entreprise constitue une conquête du mouvement ouvrier. Mais la politique réformiste a en échange encouragé un dépérissement ou une atrophie des fonctions sociales du mouvement ouvrier organisé. Si la classe ouvrière est bien la seule classe révolutionnaire jusqu’au bout et la colonne vertébrale du combat, ses organisations doivent accueillir et regrouper toutes les formes de mobilisations anticapitalistes. Une bourse du travail ne devrait pas être, pour ne prendre qu’un exemple, une simple maison des syndicats, mais le local des comités de soldats, la maison des femmes et le centre culturel du mouvement ouvrier…
b) C’est seulement dans la mesure où le mouvement ouvrier parviendra, dans le cadre d’initiatives unitaires de ses organisations, à développer ses propres activités sociales et culturelles, qu’il pourra opposer à la privatisation croissante des pratiques sociales (loisir, culture), liée à l’extension et à la généralisation de la production marchande, la reconstruction d’une conscience et d’une identité de classe attaquées aussi bien par la production marchande et la division du travail que par la politique d’intégration des organisations réformistes. À cette resocialisation peut contribuer la mise en place de réseaux pédagogiques parallèles (et d’écoles de langue nationale comme en Catalogne), de jeunes théâtres, de radios libres, de librairies différentes… À condition de ne pas se confiner dans une autonomie illusoire, mais de se définir dans leurs rapports au mouvement ouvrier, de tels réseaux s’opposent à l’étatisation qui est le corollaire inévitable de la privatisation des pratiques sociales : interventions multiformes de l’État-providence qui est aussi et d’abord un État autoritaire, tirant alibi du mythe du service public pour mêler indissolublement ce qui relève de la conquête populaire (droit à l’enseignement, à la santé) et ce qui relève de la normalisation sociale (pédagogie officielle, monopole de la radio, encadrement hospitalier).
Ainsi conçue, « l’expérimentation sociale » dont se gargarisent les néoréformistes peut être autre chose qu’un simple exutoire à la crise des institutions : une pratique unitaire et unifiante qui s’insère dans la politique de front unique pour lui donner toute sa dimension sociale et subversive.
La condition d’articulation de ces luttes dans une perspective de double pouvoir, c’est l’existence d’un parti d’avant-garde qui centralise le développement de la conscience de classe et exprime au plus haut niveau une alternative révolutionnaire. Un tel parti est plus nécessaire que jamais comme clef de voûte de l’unification de la classe. En effet, l’élévation globale du niveau culturel des travailleurs ne se traduit spontanément ni par l’homogénéisation de leurs rangs, ni par une progression mécanique de leur conscience de classe. Le double mouvement de privatisation et d’étatisation des rapports sociaux de production et de reproduction de la force de travail joue dans le sens de l’atomisation du mouvement ouvrier.
Bien sûr, ce n’est possible que dans la mesure où les grandes organisations ouvrières, loin de défendre l’indépendance de la classe, l’enchaînent de mille liens aux institutions et aux partis de la bourgeoisie. Mais cette pratique institutionnelle de collaboration de classe revêt elle-même des aspects nouveaux. En effet, les partis ouvriers réformistes, comme la social-démocratie d’avant 1914 ou les grands partis staliniens de masse de l’entre-deux-guerres, organisaient à leur façon la classe ouvrière en contre-société, embrassant le réseau de ses organisations de masse, syndicales, culturelles, associatives. Ce réseau correspondait au rôle de groupe de pression dans le cadre de la démocratie parlementaire représentative classique : le mouvement ouvrier réformiste y jouait à sa façon le rôle d’un lobby, sans s’identifier au système institutionnel pour s’y fondre.
En revanche avec le développement de l’État fort qui se traduit par la prééminence de l’exécutif et de l’administration d’État au détriment de la représentation parlementaire, les partis ouvriers bourgeois qui s’affichent comme « partis de gouvernement » entendent prouver à la classe dominante qu’ils sont en fait des « partis d’État ». Il ne s’agit plus seulement de s’engager en tant que « parti de gouvernement » issu d’une majorité parlementaire à respecter les règles de l’alternance. Il s’agit de s’engager par avance à épouser le rituel étatique et le jeu des compétences administratives, de jurer fidélité aux clauses de secret et aux impératifs institutionnels qui cimentent l’étatisme autoritaire contemporain.
La recherche de cette crédibilité étatique dicte la forme même des campagnes électorales qui deviennent par le truchement des médias une grande compétition technocratique dont l’épreuve du chiffrage est devenue, depuis les dernières législatives, le clou ; ce au détriment de la défense de l’intérêt et de l’identité propre de la classe exploitée. La logique de l’État fort ne laisse plus guère d’espace entre l’intégration et l’identification à l’État bourgeois, d’un côté, la défense de l’unité et de l’indépendance de classe dans le sens d’une alternative révolutionnaire, de l’autre.
La lutte pour cette unité et cette indépendance commence par la construction d’un parti révolutionnaire indépendant, seul capable d’arracher le mouvement de masse aux rets de la collaboration de classe, pour qu’il devienne un sujet conscient et agissant au lieu de se dissoudre dans le quadrillage institutionnel.
Critique communiste n° 26, janvier 1979
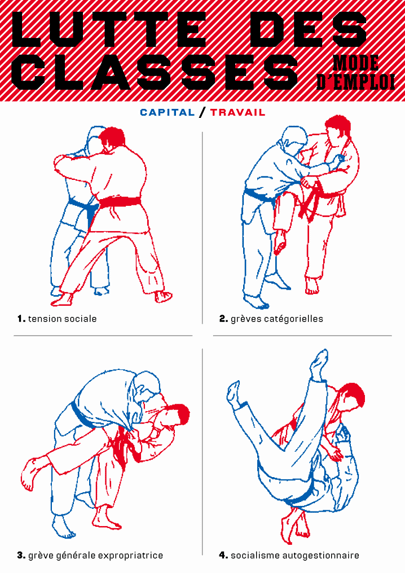
Documents joints
- Tocqueville, <em>Souvenirs</em>, p. 45, éditions Folio.
- Mandel, « Éléments pour un bilan », Inprecor, n° 29.
- Rosa Luxemburg, Grève de masse, parti et syndicat, éditions Maspero.
- En 1968, la CGT et la CFDT ont pris soin de ne pas lancer de mot d’ordre de grève générale qu’ils auraient alors dû organiser. Elles se sont contentées de la constater. Devant l’impasse des négociations, L’Humanité titra même un jour : « Le patronat prolonge la grève. » Seule la Fen lança le mot d’ordre de grève générale.
- Mitterrand, Ma part de vérité, Livre de poche.
- La JCR qui participait en tant que telle à cette manifestation répliqua sur la question gouvernementale en reprenant le mot d’ordre de « Gouvernement populaire, oui, Mitterrand-Mendès France, non ! » Ce mot d’ordre indiquait alors la nécessité de rompre avec la bourgeoisie (Mitterrand n’était pas membre du PS). L’OCI qui ne participait pas à cette manifestation avait alors comme seul mot d’ordre central le comité central de grève. Ce qui lui valut ultérieurement les plus vigoureux reproches de son organisation sœur britannique pour être restée en pleine grève générale sur le terrain du syndicalisme pur, sans avancer la moindre réponse gouvernementale.
- Les développements de Lénine sur la crise révolutionnaire, repris par Trotski dans L’Histoire de la Révolution russe, se trouvent notamment dans La Faillite de la IIe Internationale et dans La Maladie infantile…
- La différence entre ces « fronts populaires » d’hier et d’aujourd’hui tient aussi bien à la différence de période (qui ne fait pas aujourd’hui de l’Union de la gauche la dernière carte de la bourgeoisie avant le fascisme) qu’à la modification de la place des PC (qui ne sont plus les agences directes du Kremlin).
- Voir à ce sujet Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste, de Louis Althusser (éditions Maspero) et la série de quatre articles de réponse d’Ernest Mandel dans Rouge (juin 1978).
- À ce sujet : « Le PCF à la croisée des chemins », D. Bensaïd, dans le n° 23 de Dialectiques, et le numéro spécial bilan des législatives dans les Cahiers de la taupe, n° 22.
- The Crisis ojthejrench section, éditions Pathfïnder, p. 39.
- Nous avons traité de la notion de démocratie mixte et du débat à ce sujet en Italie dans le numéro 18-19 de Critique communiste : « Eurocommunisme, austromarxisme et bolchevisme ». Quand nous parlons de ses tenants, nous ne visons pas seulement ceux qui s’en font les théoriciens, comme Poulantzas, mais avant tout ses praticiens réformistes dans les PC et les PS, eurocommunistes et rocardiens de toutes nuances.
- Santiago Carrillo, L’Eurocommunisme et l’État. Voir aussi le numéro spécial 88-89 de la revue Recherches internationales et notamment l’article manifeste de Jean Kanapa. Les textes du débat italien ont été publiés en Espagne : El Marxismo y el Eslado, éditions Avance.
- Échanges et projets, la démocratie à portée de la main, éditions Albin Michel. Pour la critique des positions du PC et du PS sur la réforme des institutions : La Démocratie décentralisée et les projets de réforme de l’État, Paul Allies (polycopié, juin 1978).
- Rosanvallon et Viveret, Pour une nouvelle culture politique, Le Seuil.
- Poulantzas, L’État, le Pouvoir, le Socialisme, Puf.
- «Le revers de la démocratie mixte sur le terrain des institutions parlementaires, c’est en quelque sorte l’État mixte », tel que l’ont présenté les maoïstes de la révolution culturelle : la démocratie directe comme forme d’appoint au pouvoir réel qui reste celui du parti unique.
- La démocratie directe implique le principe de la responsabilité et donc de la révocabilité des élus, mais non celui du mandat impératif qui ferait barrage à la formation d’une volonté collective au profit de la juxtaposition d’intérêts fragmentaires.
- A ce sujet voir la thèse de Paul Alliés sur la formation et la crise du territoire et ses contradictions dans les différents numéros des Cahiers Occitanie rouge.
- Jean-Pierre Delilez, L’État du changement, Éditions sociales, et Louis Althusser, Ce qui ne peut plus durer dans le Parti communiste.
- Pour l’analyse du recensement 1975 de l’Insee, voir Les Cahiers de la taupe n° 18 : « Extension du salariat et développement du travail salarié féminin », dont les conclusions sont reprises dans l’article sur le PCF du n° 23 de Dialectiques.
- Il s’agissait bien alors d’un mot d’ordre d’alliance entre deux classes fondamentales, le prolétariat et la paysannerie. Un mot d’ordre repris, d’après Lénine lui-même, du programme socialiste révolutionnaire. C’est cette concession que Rosa Luxemburg reprochait aux bolcheviques, annonçant que la création d’une petite bourgeoisie agraire massive serait le creuset de la formation d’une nouvelle bourgeoisie.
- Lorsqu’il parle du front unique entre organisations révolutionnaires et réformistes, Trotski prend soin d’en préciser le caractère défensif et tactique, le distinguant ainsi du front unique offensif qui prend à travers sa forme supérieure, les soviets, une fonction stratégique : « La politique de front unique avec les réformistes est indispensable. Mais elle se limite nécessairement à des objectifs particuliers, essentiellement au combat défensif. Il ne peut être question de réaliser la révolution socialiste au moyen du front unique avec les organisations réformistes. La tâche fondamentale du parti révolutionnaire consiste à affranchir la classe ouvrière de l’influence des réformistes. » Œuvres, tome II, EDI.
- The Crisis ofthefrench section, p. 65.
- C’est la confusion entre ces deux fonctions et ces deux niveaux du front unique (voir supra la note 25) qui peut engendrer soit la version gauchiste du front unique (unité à la base sur l’intégralité du programme seulement), soit la version opportuniste (adaptation à l’unité des appareils réformistes).
- Perry Anderson, Sur Gramsci, éditions Maspero, p. 140.
- C’est le cas de Louis Althusser, mais aussi de Christine Buci-Glucksmann qui ne dit pratiquement rien du front unique dans son livre sur Gramsci et l’État (éditions Fayard).
- Sur la dialectique entre démocratie représentative et démocratie directe jusqu’au dénouement de la crise révolutionnaire, voir l’article « Eurocommunisme, austromarxisme et bolchevisme » dans Critique communiste, n° 18-19, et dans La Révolution et le Pouvoir, éditions Stock, la partie sur la dualité de pouvoir, p. 363-393.