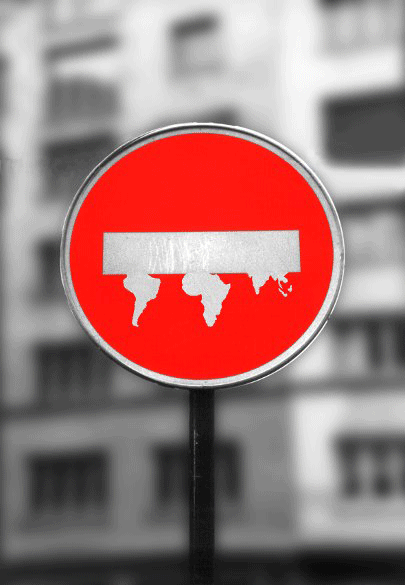
Qu’on l’appelle mondialisation ou globalisation, l’universalisation capitaliste sans phrases ni adjectifs évoque l’avènement d’un espace planétaire marchand homogène, dont le cosmopolitisme libéral des droits de l’homme constitue le discours idéologique. Il est significatif que le rapport annuel du Département d’État américain sur les Droits de l’homme soit passé de 137 pages en 1977 à 6 000 en 2000. Tout se passe en revanche comme si la notion d’impérialisme, qui a rempli tout au long du XXe siècle une double fonction analytique et stratégique, était devenue démodée avec la désintégration de l’Union soviétique, et comme si l’impérialisme, en tant que système hiérarchisé de dominations et de dépendances, était soluble dans la mondialisation. Certaines têtes de gauche, hier encore réputées bien faites, ont saisi l’occasion de l’intervention otanienne dans les Balkans pour jeter aux orties la mauvaise conscience de l’homme blanc et pour célébrer le magistère moral de l’Occident victorieux.
Le credo du nouveau cosmopolitisme libéral
La gauche social-libérale n’a pas oublié pour autant de revêtir l’armure sous la bure. La « troisième voie » s’est vite transformée en sentier de la guerre. Cette « guerre éthique », prêchée par Tony Blair, Bill Clinton, Joschka Fischer, Lionel Jospin ou Daniel Cohn-Bendit, a pris l’allure d’une nouvelle croisade du Bien contre le Mal, où la noblesse proclamée des buts poursuivis se situerait d’emblée hors de portée de toute critique politique et sociale. L’avènement d’une « politique étrangère éthique » n’a dès lors que faire du formalisme juridique international, ainsi que l’intervention de l’Otan dans les Balkans l’a illustré.
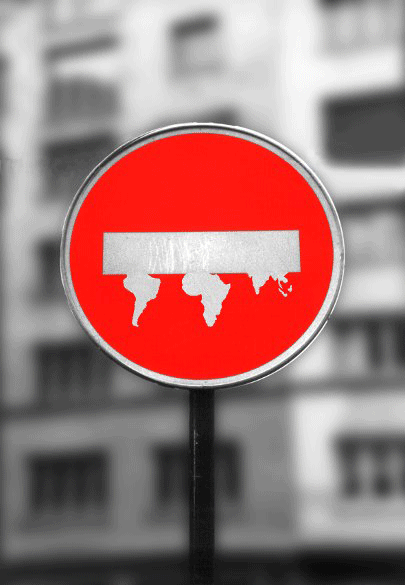 Un nouvel ordre impérial ?
Un nouvel ordre impérial ?
S’inspirant de John Hobson et de Rudolf Hilferding, Lénine voyait dans l’impérialisme moderne la combinaison variable de plusieurs caractéristiques : la concentration et la centralisation du capital sous forme de monopoles, la fusion du capital bancaire et du capital industriel dans une oligarchie financière, l’exportation des capitaux, la formation de cartels internationaux, le partage territorial du monde. Devant les métamorphoses consécutives à la Deuxième Guerre mondiale, certains auteurs remirent en cause cette théorie. Ils soulignaient que le capital financier jouait désormais un rôle moins important que la fusion organique du grand capital privé et de l’État, que l’invention de produits industriels de substitution relativisait le pillage des matières premières, que le contrôle direct des territoires déclinait avec la décolonisation, et que les rivalités interimpérialistes faisaient place à des relations pacifiées entre les pays du centre. Leur réfutation privilégiait cependant certains traits conjoncturels de la domination impériale au détriment de la logique structurelle inhérente à l’accumulation du capital.
Si l’impérialisme se caractérise en général par l’appropriation systématique par une nation de la valeur générée par une autre, la domination impérialiste est la forme politique de la mondialisation capitaliste et de son double mouvement contradictoire : d’extension spatiale du capital à l’échelle d’un marché mondial sans frontières, et d’organisation territoriale du développement inégal dont les États-nations ne constituent pas la forme ultime, car le capitalisme ne saurait être conçu comme un pur esprit économique. Comme l’a montré Karl Polanyi dans La Grande Transformation, le marché n’est pas une seconde nature parasitée par un ordre politique extérieur, mais une institution historique et le capitalisme n’est pas séparable des dispositifs institutionnels qui en garantissent la reproduction8. Loin de s’imposer comme un retour naturel aux automatismes marchands, la globalisation capitaliste est ainsi le résultat d’une contre-réforme politique énergiquement conduite par les États dominants, pour imposer de nouveaux régimes institutionnels globalisés, de nouveaux découpages territoriaux, de nouvelles règles commerciales et juridiques internationales.
L’impérialisme a ainsi connu plusieurs phases : celle, sous hégémonie britannique, des conquêtes coloniales du XIXe siècle (marquée par les guerres de l’opium, les interventions en Inde, en Égypte, en Afghanistan ; les expéditions françaises en Algérie, au Mexique, au Tonkin ; l’intervention américaine à Cuba et l’annexion d’un tiers du Mexique ; le grand partage de l’Afrique, etc.) ; celle de l’impérialisme moderne, analysée à la veille de la Première Guerre mondiale par Hobson, Hilferding, Boukharine, Lénine, caractérisée par l’exportation des capitaux, le pillage des matières premières et la fusion entre capital industriel et capital bancaire ; celle, consécutive à la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre froide, des guerres de libération nationale, de la « décolonisation négociée », de la conférence de Bandoung des pays non-alignés et de l’idéologie « développementiste » de la Cepal ; celle, enfin, de la globalisation en cours, qui résulte non d’un déterminisme technologique (Internet et les télécommunications), mais d’un nouvel ordre consécutif à la contre-réforme libérale, à la désintégration du camp dit socialiste, aux défaites sociales des classes ouvrières occidentales à la fin des années soixante-dix, au démantèlement de l’État social et à la faillite des régimes populistes du tiers-monde.
Partant de la contradiction structurelle entre la mondialisation de l’accumulation et sa territorialisation étatique, Alex Callinicos distingue ainsi trois périodes dans l’époque impérialiste du XXe siècle. Elles traduisent les changements de rapports entre les tendances contradictoires (analysées dans ce numéro de Contretemps par la contribution de Tony Smith) entre l’organisation nationale du capital et son intégration globale au marché mondial : de 1914 à 1945, prédomine l’étatisation du capital dans un contexte de conflits militaires entre les puissances impériales menaçant la survie même du système ; de 1945 à 1973, les deux tendances se neutralisent dans le contexte de la longue expansion d’après-guerre et de partage du monde scellé par la guerre froide ; de 1973 à aujourd’hui, les tendances à la globalisation du capital prennent le dessus dans un contexte de récessions récurrentes et d’instabilité politique croissante9.
Selon Samir Amin, la nouvelle domination impériale repose sur cinq monopoles dont bénéficient les pays du centre : sur les nouvelles technologies et les brevets ; sur le contrôle des flux financiers ; sur l’accès aux ressources naturelles ; sur les armes de destruction massive ; sur les moyens de communication. Il en résulte toute une gamme de nouvelles dominations du « développement du sous-développement » (ou la rechute dans le sous-développement) pour des régions entières, jusqu’à un développement limité et subordonné dans le cadre d’une nouvelle division internationale du travail (en vertu de laquelle les pays dépendants répondent aux besoins du centre dont la rente technologique assure une captation accrue de la valeur mondialement produite). Cette appropriation systématique de plus-value ne s’opère plus seulement à travers des rapports de domination bilatéraux, mais aussi, globalement, grâce à l’intervention des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), ou l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La contre-offensive impériale amorcée dès la fin des années soixante-dix, après la défaite au Vietnam, n’est pas strictement monétaire et économique, elle s’appuie aussi sur la course aux armements (et l’hégémonie militaire américaine) et sur les nouvelles stratégies d’intervention, dites de « basse intensité », mises en œuvre au long des années quatre-vingt en Amérique centrale et dans la Caraïbe. Les conséquences pour l’Amérique latine, sans même parler de l’Afrique, sont spectaculaires. Alors que ce continent représentait en 1950 14 % du PIB mondial, il n’en représentait plus que 8,8 % (Brésil inclus !) en 1998. Alors qu’il contribuait en 1950 pour 12 % au commerce mondial, il n’y contribuait plus que pour 3,5 % en 1998. Parallèlement, la dette extérieure a explosé, de 79 milliards de dollars en 1975 à 370 milliards en 1982, et à 750 milliards en 1999. Dans 13 des 18 pays concernés, le salaire moyen était inférieur en 1999 à celui de 1980. Entre 1990 et 1996, alors que les importations augmentaient de 127 %, les exportations n’augmentaient que de 76 %. L’écart technologique par rapport aux pays du centre s’est donc creusé. Sous l’effet des plans d’ajustement structurel dictés par le FMI, avec leur cortège de privatisations et de dérégulation, la spécialisation et l’insertion dépendante dans l’économie mondiale se sont accentuées, le soja devenant par exemple le premier produit d’exportation argentin.
Certains auteurs parlent de recolonisation, d’autres de « recompradorisation » des classes dominantes autochtones. Il faut cependant distinguer entre une bourgeoisie pour laquelle le marché national reste déterminant, comme en Argentine et au Brésil, même si les marges sont de plus en plus étroites pour un néopopulisme bourgeois, et une bourgeoisie et une bureaucratie « transnationalisées », de plus en plus aspirées par l’économie globale du marché mondial et par la cooptation institutionnelle de la « global governance », avec pour conséquence une autonomisation croissante envers les procédures de légitimation populaire.
Si la domination du dollar et la démonstration du leadership militaire américain dans les guerres du Golfe et des Balkans ont mis en évidence le rôle international des États-Unis, cela ne signifie pas pour autant que l’Union européenne soit leur simple vassal et auxiliaire. Elle représente bel et bien un impérialisme allié certes, mais aussi potentiellement concurrent. Le dénigrement médiatique du vieux « souverainisme » sert ainsi de couverture idéologique à l’émergence d’un souverainisme à la puissance douze, quinze, ou vingt-cinq, de « l’Europe-puissance ». La vision du monde selon laquelle, au lieu de se fondre dans un espace unique, les territoires se réorganiseraient en ensembles régionaux, tend en outre à gommer les différences entre ces ensembles. Il serait illusoire, comme le prétendent certaines bourgeoisies latino-américaines, de présenter le Mercosur (fût-il allié aux pays du Pacte andin), comme une alternative sous-continentale à la zone de commerce des Amériques voulue par les États-Unis (avec l’appui zélé du Mexique de Vicente Fox), dont le plan Colombie constitue un volet militaire légitimant les interventions présentes et à venir. Il serait également erroné de présenter le Mercosur, l’Union européenne ou le Traité de libre commerce Nord Atlantique, comme autant d’ensembles régionaux équivalents. Le développement inégal et la dépendance existent aussi entre blocs et régions. Indicateur de l’injustice planétaire, le rapport entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres de la population mondiale, qui était de 30 contre 1 en 1960, était passé en 1997 à 74 contre 1. L’heure de travail du travailleur américain moyen, qui s’échangeait sur le marché mondial contre 40 heures de travail d’un travailleur indien en 1980, s’échangeait contre le double, soit 80 heures, en 1995. Spirale de la dette et gap technologique aidant, vingt ans de contre-réforme ont bien accéléré les différenciations et non pas homogénéisé et pacifié le monde, ainsi que le prétendent les libéraux.
Si elle se traduit par l’avènement d’un impérialisme sans dehors, la mondialisation impériale ne signifie donc pas l’avènement d’un espace marchand homogène. Elle est, comme le souligne Samir Amin, intrinsèquement polarisante : le développement inégal constitue sa loi immanente. L’impérialisme n’est pas « le stade ultime du capitalisme », mais la conséquence inéluctable du développement inégal et de l’accumulation du capital dans le marché mondial.
« La question de l’espace d’accumulation du capital peut être posée à différents niveaux d’abstraction », écrivent les auteurs d’un article récent sur la périodisation du capitalisme10. Ainsi, le rapport entre le mode de production capitaliste et l’État-nation a souvent été conçu à tort non en termes historiques, mais en termes de nécessité logique et fonctionnelle. La différenciation spatiale ne prend cependant pas forcément la forme exclusive d’une fragmentation étatique. L’intérêt renouvelé, dans la gauche radicale anglo-saxonne, pour la production sociale de l’espace, ou les travaux de David Harvey sur la géographie politique insistent ainsi sur la nécessité de repenser les formations sociales détachées de leur enveloppe nationale exclusive.
Alors que, pour Rosa Luxemburg, l’inclusion de nouveaux territoires et de nouvelles populations était la condition nécessaire au métabolisme du capital pour rétablir l’équilibre sans cesse rompu de l’accumulation, la nouveauté inhérente à la globalisation marchande résiderait dans le fait que le développement inégal serait désormais non dépassé, mais « internalisé ». Les contradictions qui en résultent sont d’autant plus explosives. Loin d’être plus harmonieux, le développement devient encore plus inégal et plus mal combiné, ainsi qu’en témoigne le rapport de l’Onu 2000 fondé sur l’indice de développement humain (IDH). Même si les composantes de cet indice restent discutables, il fait apparaître un creusement des inégalités, non seulement entre régions de la planète, mais au sein même des pays riches, et entre hommes et femmes. Comme à l’époque de la mondialisation analysée par Marx sous l’Angleterre victorienne et palmerstonienne, le développement dépendant n’est pas un à-côté ou l’expression d’un retard par rapport à l’accumulation dans les pays dit avancés. Il demeure la condition même de cette accumulation élargie, de même que la spécialisation de l’Inde, l’esclavage colonial, et la guerre de l’opium furent l’envers nécessaire de l’essor du capitalisme industriel des années cinquante et soixante du XIXe siècle.
Le monde n’est pas à vendre
Le nouvel ordre impérial et ses tentatives de légitimation sont perclus de contradictions anciennes et nouvelles, porteuses de nouvelles violences et de nouveaux désordres planétaires.
1. La contradiction entre la mobilité des capitaux et des marchandises, et le contrôle des flux de main-d’œuvre dans le cadre d’une nouvelle division internationale du travail cherchant à tirer le meilleur parti des différentiels de productivité du travail, afin de transférer la plus-value vers les pays à forte composition organique du capital et du travail11. Cette contradiction prend aussi la forme de l’opposition entre la libéralisation des marchés et la pénalisation sécuritaire du social. Ou encore, entre l’apologie libérale d’un État social minimal et la demande d’un État pénal (militaire et policier) maximal. Plus généralement, il apparaît que les États doivent plus que jamais assurer les infrastructures nécessaires à la reproduction des rapports de production, garantir la sécurité de la propriété, des communications, des échanges, et qu’aucune institution internationale n’est capable de remplir ces fonctions dans un avenir prévisible. L’ordre du capital repose donc encore sur une multiplicité d’États dont la coopération dans le cadre de la « gouvernance globale » ne remplace pas les fonctions. En revanche, le rôle de ces États est appelé à se transformer dans la mesure où ils ne sont plus seulement les garants de leurs marchés internes, mais doivent de plus en plus renforcer leurs moyens d’assurer la reproduction sociale et de garantir la propriété au-delà de leurs frontières. Le refus du plus puissant d’entre eux, l’État américain, de se plier à un droit commercial (adoption de sanctions unilatérales), juridique (refus d’un tribunal pénal international), ou écologique (refus de ratifier les accords de Kyoto), en dit long sur le sens d’un cosmopolitisme libéral à sens unique. Dans son Grand Échiquier, Zbigniew Brzezinsky résume sans fioritures la mission impériale dans le monde : « Les trois grands impératifs de la stratégie géopolitique sont de prévenir la collusion des vassaux et de maintenir leur dépendance en matière de sécurité, de veiller à la solvabilité des débiteurs, et d’empêcher les barbares de se rassembler12. »
2. La contradiction entre l’émergence d’un ordre juridique cosmopolite et un ordre politique et militaire qui demeure fondamentalement interétatique. Les tribunaux internationaux dont la légitimité dépend de ratifications nationales sont financés par les États, voire par des donateurs privés, alors que les contributions au fonctionnement de l’Onu sont lâchées avec un élastique par les États-Unis notamment. La traduction de Milosevic devant la juridiction de La Haye illustre les paradoxes de cette justice à sens unique, où les pays riches achètent l’extradition du justiciable, alors que d’autres criminels de guerre (comme les responsables de l’agent orange qui dévaste encore le Vietnam, les commanditaires politiques des tortures en Algérie, ou encore Ariel Sharon reçu comme un allié respectable dans les capitales occidentales), bénéficient des indulgences d’une « justice internationale » à la tête du client. L’équivoque soigneusement entretenue entre le droit (juridique) et le devoir (compassionnel) d’ingérence humanitaire illustre bien ces ambiguïtés. Après l’attribution du Prix Nobel de la paix à MSF, son ancien président Rony Brauman et son président en fonction Philippe Biberson dénonçaient dans une tribune de presse la « trompeuse approximation de ce droit », ainsi que la « propagande new age transformant une guerre en geste humanitaire » : « Le slogan du droit d’ingérence ne présente pas seulement l’inconvénient d’être fallacieux, ce qui est en soi suffisant pour le récuser : mettant États et ONG apparemment sur le même plan, il jette sur celles-ci le soupçon légitime qui pèse sur ceux-là13. »
3. Le « droit du plus faible » cher à Alain Madelin se révèle donc, dans le monde inégalitaire réellement existant, comme le nouveau masque de la justice du plus fort. L’idée d’une justice universelle peut exprimer une aspiration à l’universalité à laquelle la période de décolonisation a donné une impulsion encore active. Pour le moment, c’est « un échec juridique », estime Monique Chemillier-Gendreau. Apparue entre la période de décolonisation et la chute du Mur, la notion de « patrimoine de l’humanité », qui réhabilitait à partir du droit de la mer les notions de jus nullius ou de jus communis, se heurte aux intérêts des États les plus puissants, qu’il s’agisse de la ratification des accords de Kyoto ou de la discussion sur les droits à polluer. Le rapport contractuel déterminé par les rapports de forces, qui domine de plus en plus la loi commune dans les rapports entre États comme dans le droit privé, va à l’encontre de la notion même de « patrimoine commun ».
4. Se pose en effet une question cruciale concernant le sujet politique du droit. S’agit-il de la totalité des humains, autrement dit de l’Humanité majuscule en tant qu’espèce, accédant à un statut non seulement biologique mais juridique, à travers la notion de crime contre l’humanité ? Les rapports juridiques internationaux tendent pourtant de plus en plus à revêtir la forme de contrats inégalitaires sans Loi commune censée les encadrer (comme l’ont montré les négociations sur l’Ami). Se dessine ainsi ce que Monique Chemillier-Gendreau considère comme « le désastre d’un monde contractualisé sans les tempéraments de la loi. » En l’absence d’une source politique de la loi commune, l’affaiblissement de l’Onu renforce seulement un ordre économique et politique inégalitaire au profit d’une coalition volontaire des puissances occidentales. Au lieu d’envisager sérieusement les tensions entre la démocratie politique et la rhétorique universelle des droits de l’homme, il n’est pas surprenant que Madeleine Albright se contente d’y voir « un principe de civilisation ». Il est plus étonnant d’entendre un philosophe comme Richard Rorty décréter pragmatiquement que la discussion n’a plus lieu d’être, puisqu’il s’agit d’un « fait mondialement accompli » !
5. Si la souveraineté ne correspond plus à sa définition courante (l’exclusivité de compétence sur un territoire) et si les pouvoirs régaliens s’effritent alors que la socialisation du travail change d’échelle, à quels niveaux s’exerce désormais la volonté populaire ? Faute de répondre à la question, le système de représentation perd ses enjeux et tombe en déshérence. Dans la mesure où il esquisse une articulation d’espaces différenciés non homogènes, le principe de subsidiarité pourrait fournir un fil conducteur pour une démocratie qui ne coïncide plus ni avec des appartenances nationales, ni avec des espaces uniques. Encore faut-il préciser les modalités d’une subsidiarité ascendante, où le pouvoir serait délégué par consentement explicite et dans la mesure seulement où les décisions requises ne peuvent plus être prises à l’échelon inférieur.
Résistances globalisées
De Seattle à Porto Alegre en passant par Nice, Prague, Québec, Bangkok, Melbourne, Dakar, Gênes, prend forme une carte mondiale des résistances aux défis de la mondialisation capitaliste, de la crise écologique, ou des pouvoirs inédits de la biotechnologie. En décembre 1999, les manifestations de Seattle contre l’OMC ont marqué un tournant. Le message qui, depuis, a fait le tour du monde, en est le symbole : « Le monde n’est pas à vendre ! Le monde n’est pas une marchandise ! ». C’est un cri d’alarme sur ce qui peut arriver à notre planète, sur les risques qui pèsent sur nos conditions d’existence et de reproduction en tant qu’espèce.
Car la privatisation du monde va bien plus loin aujourd’hui que l’appropriation privée des moyens de production. Elle s’étend aux services, à la santé, à l’éducation, à l’habitat, aux transports, à l’information ; à la privatisation de la monnaie avec le transfert du droit d’émission à des banques indépendantes de tout pouvoir politique et législatif ; à la privatisation du droit, avec un recul de la loi commune devant les contrats privés ; à la privatisation du vivant et des organes. L’utilisation commerciale d’embryons par des laboratoires privés à des fins médicales ou cosmétiques, voire l’appropriation privée du capital génétique de groupes humains entiers, comme certaines tribus amazoniennes ou les populations islandaises, passent de la science-fiction à la réalité.
Nous sommes ainsi confrontés non à une crise passagère de croissance, mais à une véritable crise de civilisation, où les relations sociales et les rapports de l’espèce humaine à la nature se réduisent à la misérable évaluation marchande. Si le monde n’est pas une marchandise, et si nous ne voulons pas que tout soit soumis aux arbitrages à court terme des marchés, quelle société voulons-nous construire et quelle humanité voulons-nous devenir ? La seule logique capable de s’opposer au despotisme impersonnel du capital mondialisé est celle du bien commun, du service public, de la satisfaction de besoins collectivement déterminés, en un mot une logique d’appropriation sociale et démocratique.
Après l’alerte des crises dites asiatiques de 1998, des voix de plus en plus nombreuses se sont inquiétées des désordres planétaires consécutifs à la dérégulation libérale. De Georges Soros à Jean-Marie Messier, certains ont même commencé à prêcher un « dialogue constructif », dans le cadre de la « société civile globale », entre les composantes « raisonnables » du forum antisocial de Davos et du forum social de Porto Alegre. Nul doute que ces voix se feront à nouveau entendre à l’occasion du second forum de Porto Alegre, en février 2002. Pourtant, le dispositif institutionnel de la gouvernance impériale globalisée n’est pas réformable. Il est urgent de lui opposer, au nom d’une société solidaire fondée sur le bien public, non seulement le contrôle des mouvements spéculatifs de capitaux, mais l’abolition de la dette qui saigne les pays dominés, le démantèlement des pactes militaires, la lutte sans merci contre l’OMC, le FMI, et le club fermé du G7 ou du G8.
La toile tissée à travers les manifestations et les contre-sommets de Seattle, de Porto Alegre ou de Gênes, peut ainsi annoncer la naissance d’une alternative internationaliste à la mondialisation capitaliste.
Contretemps n° 2, septembre 2001
www.danielbensaid.org
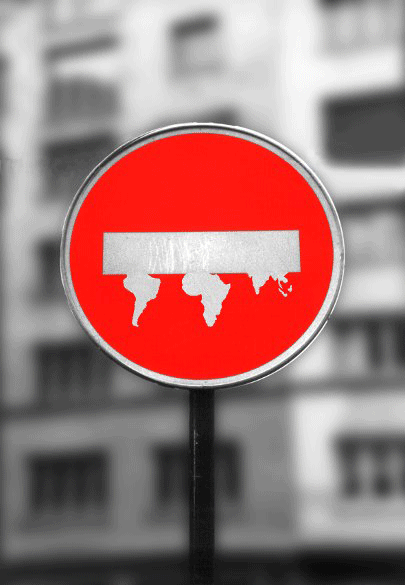
Documents joints
- Peter Gowan, « The new liberal Cosmopolitanism ».
- James Rosenau, « Citizenship in Changing Global Order », Governance without Government, Cambridge University Press, 1992.
- Alain Madelin, Le Droit du plus faible, Paris, Laffont, 1999.
- Michaël Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, éd. Exils, 2000.
- Voir dans le présent numéro de Contretemps leur article sur « La multitude contre l’Empire ».[/efn_note
. Nous nous contentons de noter dans cette introduction que la conception d’un espace marchand globalisé, où la domination du capital s’exercerait sans médiations politiques et institutionnelles, aboutit à osciller entre une prolifération rhizomatique de contre-pouvoirs, condamnés à résister éternellement à un pouvoir du capital devenu insaisissable et indépassable, dont la circonférence est partout et le centre nulle part ; et l’hypothèse événementielle d’un effondrement catastrophique d’un système dénudé au point de devenir immédiatement vulnérable à ce qui lui résiste. La thèse d’Empire prolonge celle de Susan Strange qui diagnostiquait dès 1989 « l’émergence d’un empire non-territorial avec Washington pour capitale », et la formation d’une multitude de « semi-citoyens de l’empire disséminés un peu partout5Susan Strange, « Towards a Theory of Transnatinal Empire », in E-O Cziempel et J. Rosenau, Global Changes and Theoretical Challenges, Lexington, 1989.
- Harry Harootunian, « Out of Japon : The New Association Mouvement », Radical Philosophy, n° 108, sept 2001.
- Voir Elllen Meiksins Wood, « Trabajo, Classes y Estado en el capitalismo global », Resistencias mundiales, Clacso, Buenos Aires 2001.
- Alex Callinicos, « Periodizing Capitalism and Analyzing Imperialism : Classical Marxism and Capitalist Evolution », Phases of Capitalist Development, op. cit. Palgrave, New York, 2001.
- Alnasseri, Brand, Sablowski et Winter, « Space, Regulation and Periodization of Capitalism », Phases of capitalist development, éd. par Robert Albritton, Makoto Itoh, Richard Westra et Allan Zuege, Palgrave, New York, 2001.
- C’est André Gorz qui parle de composition organique du travail pour désigner le rapport entre travail mort (socialisé) et travail vivant qui caractérise la forte productivité du travail dans les pays dominants.
- Zbiniew Brzezinski, The Grand Chessboard, New York, 1997, p. 40.
- Le Monde, 8 décembre 1999. Voir également l’entretien avec Rony Brauman dans le présent numéro de Contretemps.