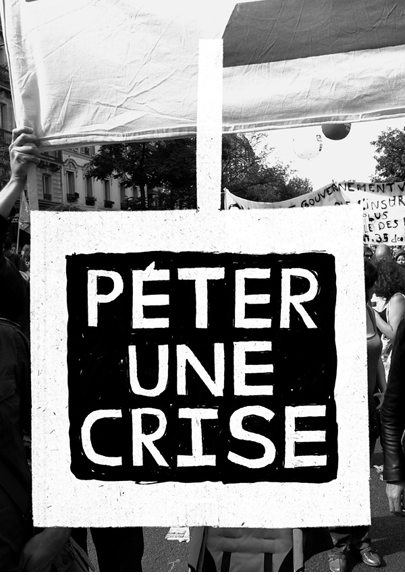
De divers côtés, Gramsci est revendiqué comme le principal penseur marxiste s’étant penché sur les spécificités de la révolution en Occident. En effet, ses apports sont indispensables à toute réflexion stratégique mais ne sauraient être isolés des débats initiés par Lénine et Trotski dans l’Internationale des années vingt.
Gramsci est souvent présenté comme le seul dirigeant communiste de l’entre-deux-guerres qui aurait perçu, en ce qui concerne la révolution en Occident, la nécessité d’un tournant stratégique fondamental par rapport à Octobre 1917. Annick Jaulin, dans le numéro 9 de la revue M consacré à Gramsci, écrit ainsi péremptoirement :
« La révolution de 1917, loin d’être le modèle pour l’avenir, est le dernier événement d’une époque qui a commencé en 1789 : mais “la guerre de mouvement” est terminée, commence “la guerre de position”. Ainsi, le marxisme n’existe pas mais est à inventer comme philosophie de la praxis et le léninisme est un combat d’arrière-garde qui laisse entièrement à penser ce que pourrait être une hégémonie dans les sociétés où la société civile est plus état que l’État1. »
Notre propos n’est pas de discuter ici des textes de Gramsci lui-même – nous renvoyons de ce point de vue au court et remarquable essai de Perry Anderson publié en 1978, malheureusement peu discuté en France2 – mais de revenir sur certaines extrapolations faites à partir de ses écrits et présentées comme des éléments clés de ce tournant stratégique. Par là, nous élargirons la discussion aux questions de lutte pour le pouvoir dans les pays capitalistes avancés.
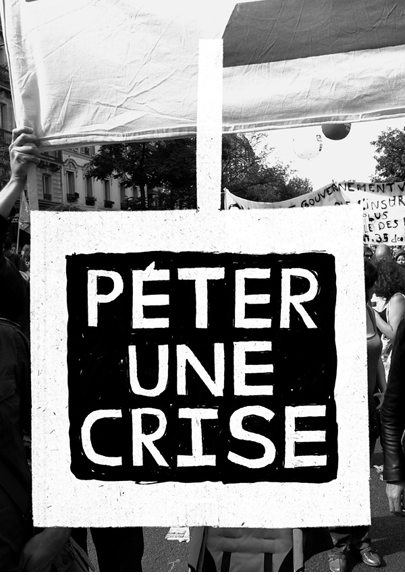 L’Est et l’Ouest
L’Est et l’Ouest
Lors de son Ier Congrès (1919), l’IC a une vision simple de l’extension du processus révolutionnaire vers l’Occident. Pas seulement parce que ses militants ont « mal assimilé » l’expérience des bolcheviques ; Lénine lui-même, dans les thèses qu’il écrit pour ce congrès, résume ainsi la tâche principale des partis communistes, là où le pouvoir des soviets n’existe pas : éduquer les masses sur la nécessité d’une nouvelle démocratie prolétarienne qui doit remplacer la démocratie bourgeoise. Pour ce faire, « élargir et organiser des soviets dans tous les domaines [et] conquérir à l’intérieur une majorité communiste, sûre et consciente3 ».
Il est vrai que cette perspective s’appuie sur l’expérience de la Hongrie, de l’Allemagne de 1918, où le processus révolutionnaire, comme en Russie, semble mettre immédiatement à l’ordre du jour le pouvoir des soviets. Mais lorsque s’ouvre le IIIe Congrès (1921), la vague révolutionnaire née de la guerre marque le pas. Des expériences comme celle de la révolution allemande font apparaître une série de problèmes d’orientation nouveaux. Lors de ce congrès. Lénine et Trotski font bloc autour de la défense d’une politique de front unique. Celle-ci sera approfondie les mois suivants. Ils n’abordent pas la question en termes généraux de façon à permettre de penser systématiquement la différence entre l’Est et l’Ouest, ils ne donnent que des indications. Pour Lénine, le processus sera plus lent et plus complexe. Pour Trotski, le pouvoir sera plus difficile à conquérir (mais plus facile à garder) qu’en Russie où les bolcheviques ont en un certain sens culbuté les classes possédantes.
Leurs préoccupations sont en fait plus directement politiques. Il s’agit de battre les partisans de « l’offensive », qui, en Allemagne (mars 1921), viennent de se lancer dans une action aventuriste de lutte directe pour le pouvoir. Ces courants sont certes hétéroclites, mais dominent les jeunes partis communistes et une partie de l’appareil de I’IC : Lénine et Trotski craignent d’être minoritaires et se voient même contraints de passer des compromis, par exemple sur l’appréciation de l’action de mars donnée par l’IC. Ces courants ont en commun de ne pas comprendre l’inflexion qui vient de se produire dans la situation politique, ils partagent une même vision linéaire du processus de radicalisation des masses et de ce que doit être la tactique des partis communistes (« l’offensive »). Ils refusent, ou pour le moins, résistent fortement à la politique de front unique proposée par les deux principaux dirigeants de la Révolution russe. Si ceux-ci gagnent la bataille, ils le doivent davantage à leur prestige qu’au fait qu’ils auraient réellement convaincu.
Au demeurant, à l’époque, Gramsci refuse cette tactique : ce n’est que plus tard qu’il verra dans ces courants les représentants typiques de la « guerre de mouvement4 ». Le front unique, c’est d’abord l’insistance sur la nécessité de gagner la majorité dans les masses pour faire la révolution et le besoin de l’unité d’action avec la social-démocratie. Mais, au fur et à mesure qu’elle va se développer, cette orientation va en fait avoir des conséquences sur tous les terrains : question syndicale, premières systématisations concernant les revendications transitoires, problème du gouvernement ouvrier. Une série de caractéristiques propres sont alors prises en compte.
Ainsi, Radek, lors du IVe Congrès (1922), indique explicitement que c’est la différence entre l’Est et l’Ouest qui est à la racine des problèmes. « Le gouvernement ouvrier, écrit-il, n’est pas la dictature du prolétariat. » Transition qui n’est pas une nécessité, mais une étape possible : « Ce point de départ possible consiste en ce que les masses ouvrières en Occident ne sont pas politiquement amorphes et inorganisées comme en Orient. Elles sont organisées dans des partis et attachées à ces partis. À l’Est, en Russie, il est plus facile, lorsque commence la tempête révolutionnaire, de les amener directement dans le camp du communisme. C’est beaucoup plus difficile chez vous5. » Plus tard, Gramsci, à propos de l’Est, parlera de « société civile primitive et gélatineuse6 ».
Après l’échec allemand de 1923, cette réflexion sur la révolution en Occident, amorcée à partir du front unique, fut abandonnée au profit d’une ligne à dominante, sectaire et gauchiste, qui culmina au cours de la « troisième période » stalinienne des années trente. Mais, dès le Ve Congrès (1924), sous la houlette de Zinoviev et de certains anciens partisans de la théorie de « l’offensive », on trouve des germes d’une telle orientation. Ce qui indique que cette dernière avait des racines profondes et qu’on ne peut la réduire à un simple effet direct de la prise de pouvoir dans l’IC par Staline.
Dès 1924, Trotski mène bataille contre ce type d’orientation, au nom, précisément, de la continuité avec la politique de front unique qu’il approfondit alors et systématise. Lorsque Gramsci formule sa notion de « guerre de position », il fait référence au front unique des années vingt et, en outre, critique en des termes identiques à ceux de Trotski, les positions, « classe contre classe » de I’IC et de la majorité du Parti communiste italien.
Tous deux se prononcent pour le front unique dans la lutte contre le fascisme. Tous deux pensent qu’il y aura une période de transition, entre la chute de ce dernier et la dictature du prolétariat et que, dans ces conditions, le mot d’ordre de Constituante revêt une grande importance.
Crise révolutionnaire et « modèle d’Octobre »
Chez Lénine, la notion de crise révolutionnaire est clé. Dès 1915, dans La Faillite de la IIe Internationale, il écrit : « Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, mais toute situation révolutionnaire n’aboutit pas à une révolution. » Dans les années vingt, autour de cette idée, plusieurs débats vont se télescoper dans l’IC. D’abord une confusion, quasi inévitable, entre cette idée de situation révolutionnaire, en tant que notion stratégique et le « modèle russe » c’est-à-dire la forme concrète prise par le processus révolutionnaire en Russie.
Ensuite, la confusion entre « l’actualité de la révolution » comme donnée d’une nouvelle période historique (celle de l’impérialisme) et « l’actualité de la révolution » au sens conjoncturel du terme : en l’occurrence les crises qui suivent la fin de la guerre 1914-1918. Sur ce second point, les débats que mènent Lénine et Trotski, contre les partisans de « l’offensive », les conduisent à lutter contre toute vision « catastrophiste » de la crise. Dès le deuxième congrès de I’IC, Lénine avait polémiqué à la fois contre les économistes bourgeois, qui présentent la crise comme un simple malaise, et « les révolutionnaires [qui] s’efforcent parfois de démontrer que cette crise est sans issue, pour la bourgeoisie. Or c’est une erreur. Il n’existe pas de situation absolument sans issue7 ».
Avant 1914, au sein de la IIe Internationale, domine une idéologie de la marche, inéluctable, au socialisme résultant de la croissance sociale et politique (et donc électorale) du prolétariat. Les « partisans de l’offensive » reproduisaient une vision en quelque sorte symétrique : sous les coups de la « crise sans issue » du capitalisme, de sa crise historique, la radicalisation des masses ne pouvait qu’aller inéluctablement à « gauche », vers des positions révolutionnaires.
C’est pour leur répondre que Trotski, lors du IIIe Congrès, prononce le célèbre discours dans lequel il distingue, du point de vue de l’actualité de la révolution, période et conjoncture et critique les visions mécanistes théorisant une crise inéluctable, produit direct de la crise économique. Il explique que le capitalisme peut réussir une stabilisation temporaire sur la base des échecs – ou des limites – de la lutte du prolétariat. Il est intéressant de noter que plus tard, en 1929, Trotski reprendra une partie de cette argumentation dans une polémique contre l’orientation et la pratique du Parti communiste français qui développe alors une vision linéaire de la radicalisation des masses8.
La notion de crise chez Lénine doit donc être déconnectée de toute vision « économiste ». Ce que soulignait, à la fin des années soixante-dix, Christine Buci-Gluksmann, souvent présentée en France comme une théoricienne des positions « eurocommunistes de gauche ». Mais elle ajoutait, comme d’autres, que Lénine serait resté enfermé dans une vision donnée : « La crise de l’État reste le point le plus élevé, le plus global d’une crise nationale, qui est d’emblée une crise révolutionnaire entraînant une destruction radicale de tout l’ancien appareil d’État, sa suppression et la constitution d’un appareil nouveau, populaire, authentiquement démocratique, celui des soviets. » Aujourd’hui, la crise des dictatures (Portugal, Grèce, Espagne), comme la crise de l’État en France et en Italie, tend à montrer que crise révolutionnaire et crise de l’État ne coïncident plus, du moins au départ, et selon un modèle d’attaque frontale9.
Si l’on en croit la première remarque, Lénine serait resté prisonnier de l’expérience russe, celle d’une révolution où, d’emblée, l’État tsariste s’est effondré tandis que se développaient massivement les soviets. Reste que dans un texte comme La Maladie infantile, dans lequel Lénine reprend et explicite cette notion de crise, la démarche n’est pas celle décrite par Christine Buci-Glucksmann. Lénine ne cherche pas du tout à élaborer un modèle des formes de la crise révolutionnaire.
Il avance simplement un certain nombre de critères, au demeurant très généraux, susceptibles de permettre à un parti révolutionnaire de juger si une situation est mûre – ou non – et pose la question de la lutte ouverte pour le pouvoir. Il reprend, souvent assez exactement, les idées avancées dès 1915 dans sa polémique avec les réformistes. À aucun moment, l’idée de crise n’est réduite à un modèle. Il insiste sur l’idée qu’une crise révolutionnaire, pour se développer pleinement, nécessite une crise profonde de la domination bourgeoise. Ce qui ne veut pas dire d’emblée l’effondrement du pouvoir d’État et l’émergence des soviets.
Christine Buci-Glucksmann ajoute que le problème nouveau, apparu à la fin des années soixante, vient de ce que crise révolutionnaire et crise de l’État ne coïncident plus, tout au moins au départ, et selon un modèle « d’attaque frontale ». Or, c’est justement à ce type de situation révolutionnaire, effectivement différent de l’expérience russe, que l’IC, en particulier au travers de l’expérience allemande, avait commencé à répondre par la politique de front unique.
Ainsi, Trotski traite explicitement du problème, dans ses textes des années trente de polémique avec le Parti communiste allemand10. Il distingue, sur la base de l’expérience passée, deux formes possibles du processus révolutionnaire. L’une, qui voit un effondrement rapide de l’État bourgeois et le surgissement des soviets. En quelque sorte, le modèle russe. Cette hypothèse lui apparaît la moins probable. L’autre envisage un processus plus complexe, dans lequel la crise de l’État n’existe pas, d’emblée, alors qu’une logique de double pouvoir se développe à partir des comités d’usine et sur la base du contrôle ouvrier.
Dans certaines circonstances, écrit-il, le contrôle ouvrier peut devancer considérablement la dualité de pouvoir dans le pays. Hypothèse la plus probable en Allemagne, selon lui, compte tenu de l’existence d’un État fort, d’une tradition d’organisation des ouvriers dans l’entreprise, de la puissance de la social-démocratie, etc. Pour reprendre l’expression de Christine Buci-Glucksmann : « crise révolutionnaire et crise de l’État ne coïncident plus, au moins au départ »…
Bien entendu, les quatre derniers mots ont leur importance. Trotski, pas plus que Gramsci, n’envisageait que l’on puisse faire l’économie d’un affrontement avec l’État, ni que cet affrontement se réduirait à sa seule crise propre… Même s’il s’agit d’un autre débat, il n’est pas possible de le contourner en le masquant derrière une prétendue vision « russe », de la crise révolutionnaire, censée être celle de Lénine et d’autres.
« Coercition » et « consentement »
Si l’IC des années vingt commence à prendre en compte, du point de vue de l’orientation politique, la différence entre l’Est et l’Ouest, la réflexion concernant l’analyse des formes de domination de la bourgeoisie dans ces pays et la démocratie bourgeoise est, en revanche, peu poussée. Certains ont cru trouver dans les textes de Gramsci, sensible à ce problème, une distinction entre « coercition » et « consentement » qui permettrait de théoriser cette différence.
En Russie, l’État tsariste, répressif et policier, fonctionnait à la « coercition ». À l’Ouest, la domination passe surtout par le « consentement », c’est-à-dire l’acceptation par les classes exploitées des normes idéologiques, culturelles, de la classe dominante. La définition, qui serait celle de Lénine, de l’État réduit, en dernière analyse, à une bande d’hommes armés, serait en quelque sorte une projection de la réalité de l’État tsariste.
Cette typologie nous semble inadéquate. En premier lieu, la vision qu’elle donne de l’État tsariste est unilatérale. Certes, lors des explosions révolutionnaires de 1905 et 1917, la fonction directement répressive de celui-ci apparaît brutalement. Mais, en période « normale », il serait illusoire de ne pas voir que, malgré sa crise structurelle, cet État fonctionne aussi à la légitimité, même si ses formes de légitimité, compte tenu de son caractère « féodal » (Lénine), ne sont pas les mêmes que celles de la démocratie bourgeoise.
Par ailleurs, Perry Anderson souligne avec raison que ce dosage entre « coercition » et « consentement » ne permet pas de rendre compte de la réalité de la démocratie bourgeoise. « Si nous revenons à la problématique d’origine de Gramsci, la structure normale du pouvoir politique capitaliste dans les démocraties bourgeoises est en fait, simultanément et indivisiblement, dominée par la culture et déterminée par la coercition. »
Par culture ou idéologie, il ne faut pas simplement entendre l’intériorisation de certaines normes par les individus, mais des réalités bien matérielles : la forme de l’État, comme « État représentatif », qui produit l’illusion que les masses s’autogouvernent, et l’organisation de la « société civile ». Le terme de société civile désigne non pas « la sphère des besoins matériels », l’économie, mais les institutions publiques et privées qui structurent la société et qu’il faut distinguer de l’État au sens strict.
Il faudrait ajouter, surtout pour les analyses portant sur la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, l’instauration d’un certain nombre de « droits sociaux » (santé, éducation, travail, etc.). Ils sont certes le produit de rapports de forces entre classes, mais ils sont perçus comme des « droits démocratiques », produits de l’évolution logique de la démocratie. Et d’ailleurs, comme les « libertés démocratiques », ils représentent un acquis effectif et important pour la classe ouvrière.
Mais, « historiquement, et c’est là l’essentiel, le développement de toute crise révolutionnaire déplace l’élément dominant, au sein de la structure du pouvoir bourgeois, de l’idéologie vers la violence11 ». Toute stratégie révolutionnaire pour les pays capitalistes avancés doit prendre en compte cette domination par la « culture » – nous y reviendrons – mais elle ne peut oublier la détermination dernière par la « coercition ».
Il est vrai que l’expérience des luttes de classes que nous avons connues entre 1968 et 1978 en Europe posait surtout le problème de la conquête de l’hégémonie. Encore qu’il ne faille pas évacuer l’exemple du Chili, pays non européen, mais où, pourtant, la tradition de démocratie bourgeoise était dominante, contrairement à d’autres pays d’Amérique latine.
Une dernière remarque pour qu’il n’y ait pas d’équivoque : il ne peut être question d’extrapoler, à partir du fonctionnement normal de la société, les conditions d’affrontement avec l’État bourgeois sous la forme d’une vision « militariste », une sorte de face-à-face entre le mouvement révolutionnaire et les corps répressifs. Dans ces conditions, les choses seraient vite jouées. En fait, une crise ouverte provoque des ébranlements décisifs, y compris dans les appareils répressifs : le comprendre et travailler en ce sens est une question déterminante de toute stratégie. Question « classique » au demeurant, si l’on se réfère à la « tradition léniniste ».
Dans la revue M, André Tosel, voulant synthétiser l’apport de Gramsci, critique son « usage instrumental, libéral-démocrate [qui] servit de garant au tournant eurocommuniste, initié par le PCI et partagé un instant par le PCF et le PCE ». Il y oppose « l’héritage le plus fécond de Gramsci, la perspective d’une réforme continue, unité d’une réforme intellectuelle et morale et de transformation économique, unité aussi de la démocratie directe et de la démocratie représentative ».
Démocratie représentative et démocratie directe
Si certaines extrapolations faites à partir de Gramsci sont permises par ses textes, on chercherait en revanche en vain chez lui une stratégie visant à articuler démocratie représentative et démocratie directe. Certainement parce que, dès 1917, il savait que la perspective de la « démocratie combinée » avait été formulée comme une alternative à la stratégie léniniste. Aussi bien pour la Révolution russe que pour la révolution allemande.
L’IC n’a cessé de s’en démarquer. Lénine reprochait aux partisans de la « démocratie combinée » de vouloir articuler deux formes de pouvoir politique. Celui de la démocratie bourgeoise (Parlement, Constituante) et celui de la dictature du prolétariat (soviet). Et donc de soumettre la seconde, les soviets, à la première. On voit d’ailleurs, nous y reviendrons, que ce n’est pas la même chose que de parler des liens entre démocratie représentative et démocratie directe.
C’est en tout cas au nom de la « démocratie mixte » qu’argumente, en 1974, Ingrao, un dirigeant « de gauche » du Parti communiste italien : « Le développement des structures d’auto-organisation de type conseilliste pose le problème d’une instance générale de vérification des volontés et de décision. Le Parlement élu au suffrage universel peut être cette instance […] il est utopique de penser qu’on peut sauter par-dessus ce moment de formation de la volonté générale12. »
Quand on connaît la politique du PCI, on comprend que ces déclarations couvrent un réformisme des plus classiques. Mais prenons en compte l’argumentation. Elle repose finalement sur la nécessité du Parlement pour « dégager la volonté générale », les conseils ouvriers n’étant capables d’exprimer que des points de vue particuliers, « corporatistes » selon l’expression employée à l’époque par les tenants de ces positions.
Ce qui est alors occulté, ce sont les conditions mêmes de formation de la « volonté générale ». On sait, dans la tradition marxiste, que la fonction de l’« État représentatif » dans la démocratie bourgeoise est de produire une prétendue volonté générale exprimée par les citoyens : « La forme générale de l’État représentatif – dans une démocratie bourgeoise – est en elle-même l’arme idéologique principale du capitalisme occidental ; son existence même prive la classe ouvrière de l’idée du socialisme entraînant un autre type d’État, et les moyens d’information et autres mécanismes de contrôle culturel renforcent dès lors cet “effet” idéologique central. […] L’existence de l’État parlementaire constitue donc le cadre formel de tous les autres mécanismes idéologiques de la classe dirigeante13. »
La démocratie socialiste ne peut donc être qu’une autre forme de pouvoir politique : dans ses aspects institutionnels, dans les rapports établis entre le « politique », le « social », l’« économique », que le capitalisme présente comme des ordres totalement séparés. L’opposition n’est donc pas entre deux principes : un système représentatif et la démocratie directe. Même si la confusion est souvent faite14.
La démocratie directe, c’est le refus de céder une quelconque parcelle de la « souveraineté » à un représentant et donc le principe du mandat impératif. Il est facile pour ceux qui en font la base de la « démocratie socialiste » (nous ne parlons pas ici d’une société sans classe) de montrer qu’une telle démocratie est certes possible ponctuellement, pour représenter des mobilisations, mais qu’elle est utopique (au mauvais sens du terme) s’il s’agit d’établir les règles de fonctionnement d’un pouvoir politique plus stable. Il ne resterait donc plus qu’à se rabattre sur des formes de démocratie représentative bourgeoise.
Si l’on regarde les textes « classiques » de Marx ou de Lénine sur la dictature du prolétariat, il est surtout question de révocabilité des élus15. La référence à une dialectique entre démocratie directe et démocratie représentative ne règle donc rien. Elle cache souvent, comme chez Ingrao, la soumission « des structures d’auto-organisation de type conseilliste » à la « volonté générale » du Parlement bourgeois. Reléguant les conseils au seul rôle d’expression de points de vue particuliers, elle ne peut en fait envisager de nouvelles formes de pouvoir politique liées à un projet différent de société.
Sur la dictature du prolétariat
La démarche est totalement différente lorsque Gramsci traite de l’expérience des conseils ouvriers de Turin en 1919. Pour lui, la forme d’organisation des conseils s’oppose à la structuration produite par la société capitaliste qui fait d’un côté du prolétaire un « esclave » salarié et, de l’autre, un citoyen désincarné. Avec les conseils, « la dictature du prolétariat peut s’incarner dans un type d’organisation spécifique de l’activité propre aux producteurs. […] Sa raison d’être est dans le travail, dans la production industrielle, c’est-à-dire dans un fait permanent, et non pas dans le salaire, dans la division des classes, c’est-à-dire dans un fait transitoire qu’il s’agit de dépasser. […] Le conseil d’usine est le modèle de l’État prolétarien16. »
Pourtant, ces formulations, que l’on trouve dans de nombreux textes de dirigeants de l’IC de l’époque, sont lapidaires. Elles supposent résolue la séparation de l’« économique » et du « politique », certes spécifique au système capitaliste, mais qui ne peut être abolie du jour au lendemain. De telles affirmations ne sont pas étrangères à la vision que Gramsci – comme d’autres – a de l’impérialisme, nouveau stade du capitalisme, qui fusionne politique et économie et rompt ainsi avec la période « libérale ». C’est considérer comme réalisé ce qui n’est qu’une tendance : « Puisque le régime de la concurrence a été aboli par la phase impérialiste du capitalisme mondial, le Parlement national a achevé son rôle historique17. »
Quoi qu’il en soit, le processus historique en Russie s’était développé de façon plus complexe avec l’apparition de deux structures bien distinctes : les soviets et les comités d’usine. Certains virent dans l’existence de ces deux institutions les effets d’une démocratie prolétarienne non « pure » qui devait prendre en compte l’existence des paysans. Les soviets, sous un certain aspect, étaient bien un instrument d’alliance de classe avec la paysannerie. Pourtant, la révolution allemande de novembre 1918 vit à nouveau apparaître ces deux structures. C’était bien la preuve que la dictature du prolétariat ne pouvait, d’un seul coup, fusionner dans une seule forme de représentation sociopolitique l’ensemble des niveaux de la réalité sociale et qu’une instance de représentation politique distincte était nécessaire. L’IC des années vingt distingua ces deux niveaux. Il ne s’agit pas de reprendre ici tous les débats de l’époque sur les formes d’organisation de la dictature du prolétariat : la place exacte des comités d’usine et celle des syndicats, les discussions, moins connues, avec l’opposition ouvrière qui, en 1921, proposait « un congrès des producteurs », séparé des soviets, afin de définir les grandes lignes de la construction économique. Il convient, par contre, de souligner ce que nous avons indiqué plus haut. La démocratie socialiste suppose une organisation du pouvoir politique et des formes de représentation que l’on ne peut réduire à la notion de démocratie directe, ni même à la simple construction de la « pyramide des conseils ». Ce qui supposerait que la société pourrait, du jour au lendemain, devenir transparente à elle-même et « absorber le politique ».
Reste le débat entre les bolcheviques et Rosa Luxemburg sur la Constituante. On sait que Rosa écrivait en prison une brochure dans laquelle elle dénonçait la dissolution de cette assemblée. Avec raison ? On voit mal comment auraient pu coexister deux institutions – les soviets et la Constituante –, se définissant chacun comme l’expression du pouvoir politique central. D’autant qu’à l’époque, derrière la Constituante, se regroupaient clairement les forces de la contre-révolution.
D’ailleurs, à peine sortie de prison, lors de la révolution de novembre 1918, Rosa ne laissa subsister aucune ambiguïté lorsqu’il fallut trancher du point de vue stratégique. Soit le pouvoir aux conseils ouvriers, soit, comme le défendait la bourgeoisie, la social-démocratie, et aussi les partisans de la « démocratie mixte », le pouvoir à la Constituante. Il faut distinguer le choix de sa bataille, juste, contre la majorité gauchiste du jeune Parti communiste allemand qui choisit de boycotter les élections à la Constituante.
En fait, la brochure de Rosa apparaît spécialement pertinente dans sa critique de la façon dont les bolcheviques ont fait de nécessité vertu en sous-estimant l’importance des libertés démocratiques « formelles ». Question qui, à l’évidence, constituait sa préoccupation première18.
La discussion sur les formes de représentation politique ne peut éviter la question du « parti unique de la classe ouvrière ». L’idée d’un tel parti était dominante dans l’IC de l’époque. Ce qui n’avait rien à voir avec les théories et pratiques staliniennes ultérieures, et n’avait pas comme logique automatique l’interdiction des autres partis.
Parti unique et pluripartisme
Il s’agit, en fait, d’une notion qui n’a rien de particulièrement « bolchevique » et plonge plutôt ses racines dans les traditions de la IIe internationale. La social-démocratie d’avant 1914 se pense comme le parti de la classe ouvrière, son représentant politique, qui doit intégrer les autres formes d’organisation de la classe : syndicats, coopératives, etc.
Tout naturellement, face à la faillite de la social-démocratie, dans leurs premières années, les partis communistes se conçoivent comme les représentants de la classe ouvrière, en quelque sorte remplaçant la IIe internationale faillie. La réalité s’avéra plus complexe et la politique de front unique introduit partiellement une logique de rupture avec cette problématique : n’implique-t-elle pas, en effet, de reconnaître le partenaire comme un parti de la classe ouvrière ?
Trotski, dans les années vingt, partage cette vision. Il avance, en ce qui concerne la Russie, des formulations beaucoup plus péremptoires que Lénine. En 1927, la plate-forme de l’Opposition de gauche maintient toujours cette idée du parti unique. Pourtant, Trotski, dans La Révolution trahie (1936), sera le premier et le seul dirigeant communiste de l’entre-deux-guerres à rompre explicitement avec cette notion. Gramsci, lui, la conservera. Perry Anderson souligne même que ses conceptions sur « la guerre de position » s’articulent avec une définition autoritaire du rôle du parti.
Cette remise en cause de la part de Trotski ne constitue pas une simple réaction « libérale » face au stalinisme, mais se fonde sur une argumentation plus profonde. Pour lui, l’identité classe-parti est fausse, pas seulement parce qu’un parti peut trahir sa classe et qu’il faut alors le remplacer par un autre, mais parce qu’un parti peut s’appuyer sur plusieurs fractions de la classe et l’expérience a montré que l’hétérogénéité de la classe ouvrière impliquait l’existence possible de plusieurs partis. Démarche qui nous semble décisive. Elle ne fonde pas le pluralisme nécessaire sur une catégorie morale ou sur les nécessités du marché, mais sur les conditions mêmes d’existence de la classe ouvrière. Pour un parti révolutionnaire, gagner l’hégémonie ce n’est plus simplement une question de bon rapport pédagogique avec la classe ouvrière de la part d’une organisation qui est la représentante de cette classe même si celle-ci l’ignore encore. La démocratie politique – comprise non seulement comme « liberté de discussion », mais comme lutte de partis, avec tous les droits que cela suppose – n’est donc pas un supplément d’âme au regard de la démocratie socialiste, alors qu’elle constituerait une caractéristique de la démocratie bourgeoise. Dans l’un et l’autre cas, elle s’enracine dans des nécessités différentes.
L’importance de ce fait est à souligner face à tous ceux qui expliquent que rompre avec « la démocratie représentative bourgeoise » induit une inéluctable logique politique de marche au « totalitarisme ». Arguments qui ne sont pas seulement présents dans la droite libérale ou dans la social-démocratie. À preuve ce qu’écrivait, en 1977, Poulantzas, partisan d’un passage au socialisme articulant démocratie représentative et démocratie directe. Il expliquait que la perspective de destruction de l’appareil d’État, au sens « classique » que ce terme avait chez Marx et Lénine, signifiait « l’éradication de toute forme de démocratie représentative et des libertés dites formelles, au profit exclusif de la démocratie directe à la base, et des libertés réelles. La seule démocratie directe, à la base ou au mouvement autogestionnaire […], conduit inéluctablement, à plus ou moins long terme, à un despotisme étatique ou à une dictature des experts19 ».
Un tel raisonnement suppose d’identifier la « démocratie socialiste » à la seule démocratie directe à la base et les libertés démocratiques à la démocratie représentative bourgeoise. Alors, en effet, l’argumentation apparaît inéluctable20. Puisqu’il est question d’autogestion…
Cette redéfinition des formes du pouvoir politique doit naturellement s’accompagner de profonds bouleversements sociopolitiques : rupture avec la domination de la loi de la valeur (qui n’est pas synonyme de suppression de tout marché), redistribution de l’espace de la vie sociale par une diminution du temps de travail, processus de mise en œuvre de socialisation de l’économie… Sans s’engager dans le détail de « l’économie de transition », soulignons une remarque qui a son importance par rapport aux années vingt : après une réelle expérience de contrôle ouvrier, les bolcheviques réorganisèrent le travail dans l’usine de façon plutôt autoritaire. Certes, il est toujours difficile de faire la part entre ce qui est déterminé par les conditions socio-économiques catastrophiques et ce qui relève des problèmes d’orientation. N’empêche que le marxiste-révolutionnaire tchèque Petr Uhl a raison d’écrire : « Si les révolutionnaires acceptent le mot d’ordre d’Engels – en entrant dans l’usine, abandonne toute idée d’autonomie –, comme l’ont accepté en pratique les bolcheviques russes, alors la société humaine ne brisera jamais ses chaînes21. »
Mais qu’en est-il de ces transformations possibles lorsque la bourgeoisie est encore économiquement et politiquement dominante ? En France, Mai 68 et les années qui suivirent ont peu apporté – hormis quelques exemples tels celui de Lip – sur les problèmes de contrôle ouvrier. Une situation déjà rencontrée en juin 1936 et qui pèse sur les traditions du mouvement révolutionnaire dans notre pays. En Italie, par contre, au cours de la même période, des luttes à dynamique de contrôle ouvrier sur les conditions de travail ont joué un rôle important. Durant la révolution portugaise, les expériences de contrôle sont allées plus loin : comptabilité, stock, embauche… On a même vu les huit cents travailleurs d’une entreprise de l’automobile reconvertir la production et fabriquer des réfrigérateurs. Dans une situation de ce type, il n’y a pas de Muraille de Chine entre contrôle et passage à la gestion directe, lorsque la réalité de l’entreprise le permet, ou bien par des coordinations de branches avançant des propositions de nouvelles orientations économiques. Refuser une telle dynamique, sous prétexte que le pouvoir politique n’est pas encore aux mains de la classe ouvrière, serait stupide ; c’est précisément ainsi que se réalise l’apprentissage d’un nouveau pouvoir.
En tout état de cause, l’expérience sociale n’a pas plus apporté, concernant la crise révolutionnaire que ce qui nous avons discuté dans les pages précédentes. Trotski polémiquait, rappelons-le, avec les staliniens de la « troisième période » (mais aussi lors de la préparation du projet de programme de l’IC en 1928 avec les positions de Boukharine) contre une vision restrictive du contrôle ouvrier et une compréhension des revendications transitoires qui n’admettrait leur validité qu’en fonction de l’imminence de l’affrontement décisif avec l’État bourgeois.
On a souvent souligné, à juste titre, les potentialités « autogestionnaires » d’une classe ouvrière qui, par rapport au passé, s’est considérablement développée en force sociale et en niveau culturel. Il faut pourtant indiquer un autre aspect : le laminage, par le développement du capitalisme, de toutes les sphères qui autrefois permettaient au prolétariat de développer des pratiques « d’autonomie » ou de « gestion » ouvrière. Au sein de l’entreprise, d’abord, par la dislocation des collectifs ouvriers, de leurs cultures et de leurs formes de maîtrise du procès de production. Et aussi par la pénétration des rapports capitalistes dans l’ensemble des secteurs. Alors que, jusqu’à la Première Guerre mondiale, le développement des coopératives constituait un point d’appui important du mouvement ouvrier et du processus de constitution du prolétariat en classe.
L’IC ne s’oppose pas à ce mouvement coopératif, mais son déclin s’amorce entre les deux guerres et, après 1945, son espace économique disparaît. Lorsque des coopératives se maintiennent, elles ne revêtent pas de caractéristiques radicalement différentes des entreprises capitalistes. Nous ne parlons pas ici de telle ou telle expérience liée à des luttes ou de caractère artisanal, mais d’une évolution générale.
Les coopératives de consommation – une tradition forte dans le mouvement ouvrier – résistent parfois plus longtemps. Mais, avec la pénétration du capital dans ce secteur, elles disparaissent ou deviennent des chaînes de distribution classiques. Dans l’après 1968, les expériences qui ont eu lieu sur ce terrain, y compris la mise en œuvre d’autres circuits (voir les marchés rouges italiens), sont restées ponctuelles et liées à des mobilisations22.
Ces « potentialités autogestionnaires » ne peuvent donc s’exprimer que lors de crises du système au sens large du terme. Nous retrouvons là tous les problèmes stratégiques discutés au long de cet article et que ne peut régler la seule référence à l’autogestion. Cette notion, que nous reprenons à notre compte, exprime la vieille idée d’« autogouvernement » que, dès sa naissance, le mouvement ouvrier a portée. Face à l’expérience stalinienne et à la réalité des États bureaucratiques, elle conserve toute son importance. Pourtant, elle traduit davantage une aspiration qu’elle ne constitue une réponse. On sait que s’est développée une version réformiste de l’autogestion qui évacue les questions de la rupture et de l’État. D’un point de vue révolutionnaire, elle ne résout pas les problèmes des formes de pouvoir de la « démocratie socialiste » tels que nous les avons abordés dans les pages précédentes.
On voit donc que, quelle que soit l’importance des aspirations qu’elle traduit, cette notion ne constitue pas par elle-même une nouvelle donnée stratégique susceptible de bouleverser les coordonnées « traditionnelles » du mouvement ouvrier et la ligne de partage entre réforme et révolution.
En 1977, Poulantzas reprochait à la Ligue communiste et, plus largement, à tous les partisans d’une « stratégie de double pouvoir » de concevoir la constitution de ce nouveau pouvoir « dans une extériorité absolue » par rapport à l’État. Il ajoutait, prenant l’exemple de la révolution portugaise : « Je pense que rupture il y aura, mais ce n’est pas forcément entre l’État en bloc et son extérieur, les structures de pouvoir populaire à la base. Ça peut se passer entre une fraction de l’armée régulière qui, elle, appuyée aussi, par ailleurs, par des pouvoirs populaires à la base, par les luttes syndicales ou des comités de soldats, une fraction entière de l’armée d’État donc, peut rompre avec sa fonction traditionnelle et passer au peuple. C’est comme ça que ça s’est passé au Portugal : il n’y a pas eu du tout affrontement avec les milices populaires, d’une part, et l’armée bourgeoise, de l’autre. »
Et Poulantzas ajoute : « Je trouve difficile qu’une situation classique de double pouvoir se représente en Europe, en raison précisément du développement de l’État, de sa puissance, de son intégration dans la vie sociale, dans tous les domaines, etc. Développement et puissance qui en même temps le rendent très fort face à une situation du double pouvoir, et très faible aussi, car le deuxième pouvoir peut désormais se présenter aussi à l’intérieur de l’État en quelque sorte ; les ruptures peuvent passer aussi à l’intérieur de l’État, et c’est ça sa faiblesse23. »
État et double pouvoir
À vrai dire, ces idées ont quelque chose d’étonnant. Ainsi, celle sur l’armée au Portugal. Elle illustre parfaitement la remarque faite plus haut sur la façon de concevoir les fonctions d’affrontement avec l’État bourgeois et, en particulier, avec ses corps répressifs : des crises et des différenciations en leur sein sont indispensables. Faut-il rappeler que la prise du pouvoir en octobre 1917, dans ses aspects militaires, ne s’est pas effectuée sous la forme d’une bataille rangée entre les milices ouvrières (« la garde rouge ») et une armée intacte ? Elle fut victorieuse parce que des régiments entiers, les armes à la main, passèrent du côté de la révolution.
Au Portugal, cette crise de l’institution militaire a pris des formes assez particulières, avec des fractures importantes dans la hiérarchie et l’existence du MFA. Cela prouve que, même si l’on prend en compte des données spécifiques au Portugal, les armées modernes peuvent subir des ébranlements très importants. Ce qui, pour des révolutionnaires, est plutôt rassurant.
D’où une question d’orientation décisive : non pas l’opposition frontale entre milices et armée, mais une politique d’approfondissement des fractures au sein de l’armée par la pression du mouvement populaire, la constitution de comités de soldats contre les réformistes qui militaient en défense de l’unité de l’armée et du MFA… C’était là une condition pour que « des officiers révolutionnaires », hésitant à mettre complètement en cause cette unité, s’engagent plus profondément dans le processus révolutionnaire, pour « qu’une fraction entière de l’armée d’État passe au peuple ». En ce qui concerne la remarque de Poulantzas sur le développement de l’État, « son intégration dans la vie sociale », il conviendrait de discuter en détail cette description qui, en fait, recouvre des réalités qui ne peuvent être totalement confondues. D’une part, des institutions directement liées à l’extension de certaines fonctions de l’État : que l’on songe, par exemple, à la place prise par des administrations liées à tel ou tel ministère. Il existe aussi d’autres institutions, plus ou moins liées à l’État selon les pays, et déterminantes dans la structuration de la société civile : école, télévision… Sans parler des entreprises de services qui fonctionnent quelquefois comme sociétés privées ou comme « services publics ».
Il n’est pas difficile, de ce point de vue, de remarquer que la situation a changé par rapport à la Russie de 1917 ou même à l’Allemagne des années vingt. Le mouvement ouvrier a d’ailleurs depuis longtemps pénétré ces institutions dans lesquelles travaillent de nombreux salariés. On voit mal comment une situation de double pouvoir pourrait se constituer « en totale extériorité vis-à-vis d’elles » ! Poulantzas signale qu’en période de crise, c’est là un point de faiblesse extrême pour l’État bourgeois et une possibilité de sa paralysie. Mai 68 en France en a largement apporté la démonstration. Il s’agissait pourtant d’une simple grève générale, et non de la mise en œuvre au sein de ces institutions de pratiques de contrôle, voire de gestion directe. Cette discussion – en termes « d’extériorité » ou non – est à vrai dire quelque peu circulaire. Comme celle que nous relevions précédemment par rapport à Christine Buci-Glucksmann, elle repose sur une ambiguïté fondamentale : l’analyse de l’État bourgeois.
Ces deux auteurs, avec d’autres, partaient en guerre contre une vision « instrumentaliste » de l’État, qui aurait dominé la IIIe Internationale, en particulier après la mort de Lénine. Une telle vision étant dénoncée comme inapte à comprendre les crises et les contradictions propres au niveau de l’État. Les analyses de l’IC des années trente étant présentées comme exemple type de cette conception réductrice ne prenant pas en compte les contradictions au niveau des différentes formes politiques et débouchant sur l’orientation que l’on connaît. Ce n’est pas nous qui allons contredire ce dernier constat. Regrettons, une fois de plus, que, lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur « le marxisme de la IIIe Internationale », les analyses de Trotski sur les différentes formes de pouvoir capitaliste ne soient pas prises en compte.
En tout cas, l’idée que l’État serait un simple instrument entre les mains d’une classe bourgeoise déjà constituée nous semble fausse. Citons Gramsci : « La classe bourgeoise n’est pas une entité hors de l’État […]. L’État amène à composition, sur le plan juridique, les dissensions intérieures des classes, les désaccords entre intérêts opposés ; il unifie et modèle l’aspect de la classe tout entière24 ». Il faut ajouter que, par rapport à la classe ouvrière, l’État n’est pas en simple rapport d’extériorité et/ou de répression. Il a une fonction de division et d’atomisation, c’est-à-dire d’organisation en fonction de la logique du système. L’État représentatif est donc tout à la fois un cadre d’unification de la bourgeoisie et, comme nous l’avons déjà signalé, par sa forme politique même, « l’arme idéologique principale du capitalisme occidental ». Il n’est pas une simple technique politique- juridique – un système de démocratie représentative opposé à la démocratie directe – mais la forme de domination politique de la bourgeoise ou, dit autrement, la façon dont la société capitaliste s’organise politiquement.
Le problème n’est pas de fermer les yeux sur les contradictions spécifiques que peut produire ce type d’État ou d’ignorer comment certaines d’entre elles renvoient à des rapports de forces entre classes. Il est, en l’occurrence, de comprendre dans quel cadre elles fonctionnent.
Poulantzas, pour se débarrasser de cette vision de « l’État comme chose, [de] la vieille conception instrumentaliste de l’État, outil passif, sinon neutre, totalement manipulé par une seule fraction », explique : « L’État capitaliste ne doit pas être considéré comme une entité intrinsèque mais, comme c’est d’ailleurs le cas pour le capital, comme un rapport, plus exactement [comme] une condensation matérielle (l’État-appareil) d’un rapport de forces entre classes et fractions de classes telles qu’elles s’expriment, de façon spécifique toujours (séparation relative de l’État et de l’économie donnant lieu aux institutions propres de l’État capitaliste), au sein même de l’État25. »
Définition ambiguë qui laisse la porte ouverte à une transformation de la nature de cet État par l’évolution, en son sein, de ce rapport de forces. Faut-il rappeler que le capital n’est pas simplement « la condensation matérielle » d’un rapport de forces entre classes, mais un rapport social, capitaliste justement. Bien sûr jouent en son sein les rapports de forces entre classes, les contradictions dans un cadre qu’il faut briser, et pas seulement faire évoluer en faveur de la classe ouvrière.
C’est ce qu’indique finalement la perspective stratégique de destruction de l’État bourgeois, c’est-à-dire sous un autre terme, la dictature du prolétariat. Destruction qui ne signifie pas simplement affrontements inévitables avec le « noyau dur » de l’appareil d’État, mais aussi fondation de nouvelles formes de pouvoir politique, d’un État nouveau.
La bataille pour l’hégémonie
Avant de conclure, nous voudrions indiquer une des difficultés importantes rencontrées dans la bataille pour l’hégémonie : ce que l’on pourrait appeler une perte d’autonomie culturelle profonde du prolétariat dont Ernest Mandel, dans Le Troisième Âge du capitalisme, dégage les racines : « Les conquêtes culturelles du prolétariat (livres, journaux, formation culturelle, sport, organisation), garanties effectivement par l’essor et les luttes du mouvement ouvrier moderne, perdent les caractéristiques de volontariat, d’indépendance et d’autonomie vis-à-vis du procès de production et de circulation marchandes capitalistes qu’elles avaient acquises à l’époque de l’impérialisme classique (en Allemagne surtout dans la période 1890-1933). Avec la récupération de la production et la circulation marchande des besoins culturels du prolétariat, c’est une reprivatisation profonde de la sphère des loisirs de la classe ouvrière qui se produit. Elle représente une rupture brutale avec la tendance à l’élargissement des activités collectives ou solidaires, c’est-à-dire l’auto-activité du prolétariat, à l’époque du capitalisme de libre concurrence et de l’impérialisme classique26. »
La reconquête de cette autonomie n’est pas chose facile. Que l’on se souvienne de l’expérience italienne des radios libres. Dans un premier temps, en lien avec les mobilisations populaires, elle semble reproduire le même phénomène – avec des techniques différentes – que la presse ouvrière du début du siècle : un lieu décisif d’affirmation d’une autre identité et d’une autre culture. Mais, avec le recul des luttes, elles deviennent le point d’appui d’une nouvelle forme d’appropriation capitaliste de l’espace. Les rapports aux grands médias modernes (radio, télévision) illustrent bien la situation contradictoire du mouvement ouvrier face à des institutions clés de la société civile. Des expériences comme celle de la création de radios à Longwy durant la lutte des sidérurgistes ne peuvent remplacer une « demande d’État » qui renvoie finalement à la place contradictoire de ces institutions publiques ou parapubliques.
Leur existence traduit la nécessité de « socialisation » (de prise en charge des besoins par l’ensemble de la société) – d’où l’idée de « service public » – mais on ne peut ignorer qu’il s’agit aussi d’institutions bourgeoises. On rencontre un problème similaire avec l’école. Sur ces terrains comme sur d’autres, les expériences de lutte de classe qui se sont développées en Europe entre les années 1968 et 1978 apportent des indications précieuses. Pourtant, il faut bien faire un constat : celui des limites de ces processus révolutionnaires. Nous voulons dire par là que, si l’on compare avec le passé, même celui du Portugal où la chose est allée le plus loin, les crises ont profondément ébranlé la bourgeoisie, sans radicalement remettre en cause, aux yeux des grandes masses, la légitimité de sa domination, sans crise profonde de l’État.
Ce bilan de l’expérience sociale elle-même fixe donc des limites aux discussions sur les formes de crise révolutionnaire en Occident à notre époque. Et, de toute façon, nous l’avons déjà souligné, notre démarche n’est pas de construire des modèles, mais d’expliciter certaines « hypothèses stratégiques » qui nous semblent, jusqu’à preuve du contraire, incontournables pour la définition d’un projet révolutionnaire. Le travail sur les années vingt et trente est nécessaire parce que « les querelles internationales qui, sur ces problèmes, rassemblèrent et divisèrent Rosa Luxemburg, Lénine, Lukacs, Gramsci, Bordiga ou Trotski, sont les marques du dernier grand débat stratégique du mouvement ouvrier27 ». Non pas regret d’un Âge d’or, mais constat historique. Ce travail est aussi utile car il peut en partie nous permettre d’avancer dans l’actualisation de ces données stratégiques.
Nous l’avons vu à propos des textes de Trotski traitant des formes possibles du processus révolutionnaire en Allemagne, et du décalage entre des expériences de double pouvoir apparaissant dans la société autour du contrôle ouvrier et de la crise de l’État proprement dite. Une donnée de fond de la révolution en Occident semble bien être la nécessité pour les masses de faire l’expérience pratique et prolongée, avant l’affrontement inévitable, d’une démocratie supérieure à la démocratie bourgeoise. Une nécessité qui plonge ses racines dans les formes de domination bourgeoise mais aussi dans ce qui les renforce : l’expérience du stalinisme et du « socialisme réellement existant ». À la veille du bicentenaire de la Révolution française, concluons par un rappel : la nécessité de défendre l’idée même de révolution n’implique en rien l’oubli de la différence profonde entre « révolution bourgeoise » et « révolution prolétarienne ». Dans le premier cas, les rapports de production capitalistes peuvent se développer dans l’ancienne société, dans le second, la classe ouvrière ne peut occuper des positions durables de pouvoir au sein du système capitaliste. D’où la place centrale, pour elle, de la lutte pour le pouvoir politique qui, en fait, détermine toute transformation en profondeur de l’ordre social. Telle est, en dernier ressort, la donnée de base des « hypothèses stratégiques » dont nous avons parlé.
Dans les années soixante, Lucien Goldmann, qui se réclamait du « réformisme-révolutionnaire », introduit en France par André Gorz et Serge Mallet, savait bien qu’en toute rigueur la défense d’une telle position signifiait la mise en cause de cette donnée de base. Ce qu’il fit en expliquant qu’existait une « nouvelle classe ouvrière » capable de prendre des positions de pouvoir, économique et social, dans le système capitaliste.
Alors, « le schéma marxiste traditionnel d’un prolétariat n’ayant aucune possibilité de conquérir des positions sociales et économiques importantes à l’intérieur de la société capitaliste, ne saurait arriver au socialisme que par une révolution politique, une conquête de l’État préalable à toute réforme fondamentale de la structure économique, se trouve profondément modifié. Des conquêtes qualitatives orientées vers le contrôle de la production et l’autogestion ne supposent plus nécessairement une conquête préalable de la machine étatique et la marche vers le socialisme prendra un chemin analogue au développement de la bourgeoisie à l’intérieur de la société féodale28. » Or, même si ce n’est pas le lieu ici de discuter des transformations et de l’évolution de la classe ouvrière en Occident, il nous semble clair que rien, ni dans l’analyse, ni dans l’expérience, ne prouve l’existence d’une « nouvelle classe ouvrière » occupant la place que lui donnait Lucien Goldmann.
Critique communiste n° 65, 1987
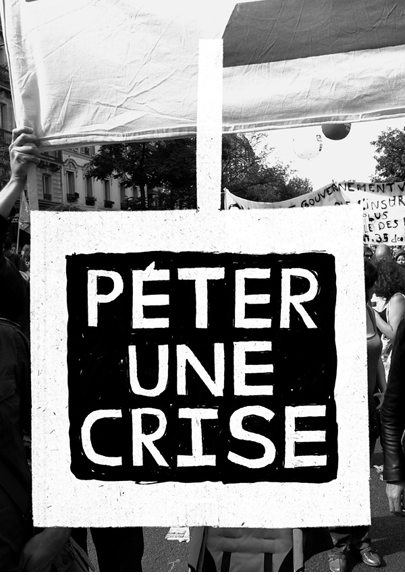
Documents joints
- Revue M, n° 9, mars 1987, consacré à l’anniversaire de la mort de Gramsci.
- Perry Anderson, Sur Gramsci, Petite collection Maspero, 1978.
- Les Quatre Premiers Congrès de l’IC, Maspero.
- Voir Gramsci et Bordiga face au Komintern (1921-1926), Quintin Hoare : « Toute l’histoire du PCI entre 1921 et 1924 fut marquée par une série de désaccords [avec le Komintern] tournant autour de la question du front unique. Le maximum que les communistes italiens étaient disposés à accepter – sur ce point, Gramsci et Togliatti étaient en accord avec Bordiga – c’est ce qu’ils appelaient le front uni à la base », in numéro des Temps modernes sur Gramsci, février 1975.
- Cité par Pierre Frank in L’Histoire de l’Internationale communiste, La Brèche.
- [Ibid.
- Œuvres, t. 31, p. 233.
- « La troisième erreur de l’Internationale syndicale rouge », publié in L’Internationale syndicale rouge, Maspero, 1976.
- « Sur le concept de crise de l’État et son histoire », in La Crise de l’État, sous la direction de Nicos Poulantzas, Puf politiques, 1976, p. 64.
- « Le contrôle ouvrier et la coopération avec l’URSS » in Comment vaincre le fascisme, Buchet-Chastel, p. 211. Et, surtout, au sujet du contrôle ouvrier sur la production, Anthologie sur le contrôle ouvrier, les conseils ouvriers et l’autogestion, réalisée par E. Mandel, Maspero 1970, p. 281.
- Sur Gramsci, p. 72-75.
- Entretien recueilli par Henri Weber dans Le Parti communiste italien : aux sources de l’eurocommunisme, Christian Bourgois, 1977, p. 181.
- Perry Anderson, op. cit., p. 46.
- On ne peut donc, en toute rigueur, faire appel à Rousseau pour fonder les principes de « la démocratie socialiste » comme le fait Lucio Colleti : « La théorie politique marxiste dépend, pour l’essentiel, de Rousseau » (in De Rousseau à Lénine, Gramma, 1974, p. 257). Marx en ayant simplement fourni les « bases économiques ».
- Encore que, dans La Guerre civile en France, Marx fasse référence une fois au mandat impératif, même si ce n’est pas le centre de son argumentation. Lénine, dans les passages de L’État et la Révolution, qui traitent de ce texte de Marx sur la Commune, écrit : « Certes, le moyen de sortir du parlementarisme ne consiste pas à détruire les organismes représentatifs et le principe électif […]. Nous ne pouvons concevoir une démocratie, même une démocratie prolétarienne, sans organismes représentatifs : mais nous pouvons et devons la concevoir sans parlementarisme ». Il serait de toute façon vain de vouloir chercher dans ces deux textes une théorie quasi achevée de la dictature du prolétariat et d’escamoter certains problèmes qu’ils contiennent.
- Écrits, t. 1, Gallimard, 1974.
- Ibid., p. 323.
- Nous ne traitons pas dans cet article des questions actuelles concernant les pays de l’Est. Par exemple, de la revendication apparue en Pologne d’une double Chambre. Nous croyons simplement que ce type de perspective n’a que peu à voir avec celle des partisans de « la démocratie mixte » en système capitaliste. Car dans ces pays où les principaux moyens de production et d’échange ont été expropriés et où existe une planification (bureaucratique), la revendication d’une double Chambre tend à se remplir d’un contenu démocratique et social différent de ce qui se passe dans une économie de marché, lorsque la bourgeoisie contrôle les principaux moyens de production.
- Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, Puf, p. 283 et 289.
- En ce qui concerne les libertés démocratiques pour les anciennes classes possédantes, Lénine expliquait dans La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky que le retrait du droit de vote aux membres des anciennes classes possédantes était une mesure « russe » et non une norme de la dictature du prolétariat. En 1933, Trotski écrit : « II n’est pas du tout exclu qu’ayant pris le pouvoir, les ouvriers d’Allemagne se trouvent assez puissants pour accorder la liberté de réunion et de presse également aux exploiteurs de la veille […] Même pour la période de la dictature du prolétariat, il n’existe pas un principe de base pour limiter à l’avance la liberté de réunion et de presse aux seules masses laborieuses » (« Fascisme et mots d’ordre démocratiques », in Œuvres, t. 1, p. 240, EDI).
- P. Uhl. Le Socialisme emprisonné, La Brèche, Paris, 1980, p. 60. Voir aussi Zbigniew M. Kowalewski, Rendez-nous nos usines, La Brèche, 1985.
- Voir L’État, le patronat et les consommateurs, Michel Wieviorka, PCJF politiques 1977.
- Interview par Henri Weber in Critique communiste, juin 1977.
- Écrits, t. 1, p. 151.
- Les transformations actuelles de l’État in La Crise de l’État, op. cit., p. 38. Notons toutefois que Poulantzas rejette explicitement l’idée réformiste classique que l’État aurait une « double nature ».
- <em>Le Troisième Âge du capitalisme</em>, 10-18, t. 2, p. 402.
- Perry Anderson, op. cit., p. 140.
- Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaines, Idées, NRF, 1970, p. 352.