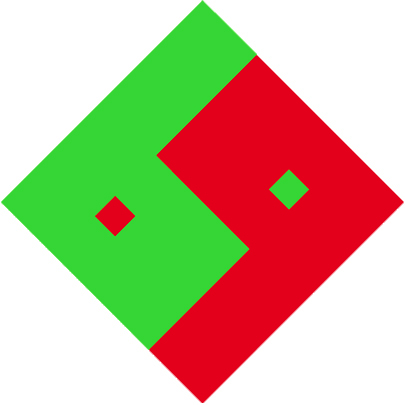
La crise écologique est, avec la crise du travail salarié, le grand révélateur des limites de la rationalité marchande. Les conditions naturelles de reproduction à long terme de l’humanité ne sauraient relever de critères immédiats de rentabilité financière. La mesure « misérable » de toute chose par le temps de travail abstrait atteint ici aussi ses limites. Il existe pourtant une écologie « profonde » et une écologie sociale, des écologies de droite et des écologies de gauche, qui articulent différemment question écologique et question sociale. Elles traduisent des compréhensions distinctes de l’imbrication entre mode de production et rapport à la nature.
Le jeu des définitions est toujours risqué. Pour Alain Lipietz, l’écologie scientifique met en évidence « les limites de l’activité de transformation du monde par les êtres humains », et l’écologie politique se nourrit de cette science pour critiquer le culte de la productivité. Le terme d’écologie désignerait donc à la fois « une science sociale et un mouvement social1
». Cette prétention à fonder une politique sur l’autorité rigoureuse d’une science a des antécédents de sinistre mémoire. Les deux ont à y perdre : la science, en se subordonnant aux aléas de la politique ; la politique, en faisant un usage dogmatique de la science.
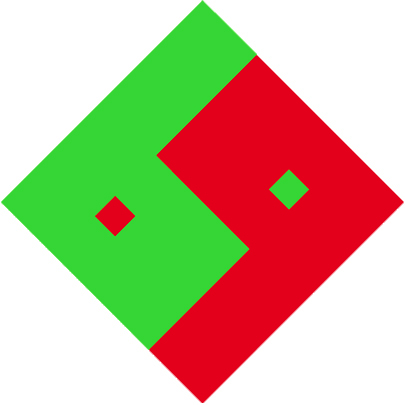
L’approche de Bruno Latour est plus subtile. Dans la mesure où il n’y a pas, selon lui, d’un côté la nature et de l’autre la politique, on n’aurait pas le choix de faire ou de ne pas faire de l’écologie politique. Croire cependant qu’elle s’intéresse à la nature serait sa « maladie infantile ». Il conviendrait plutôt de se demander ce que la nature, la science et la politique « ont à faire ensemble ». L’écologie politique devrait se proposer de faire subir à la nature ce que le féminisme fait subir à l’homme : « Effacer l’antique évidence avec laquelle il passait un peu rapidement pour la totalité2
. » L’importance des crises écologiques ne témoignerait pas d’un intérêt nouveau pour la nature, mais de l’impossibilité de maintenir désormais, sous peine de catastrophes, une séparation étanche entre nature et politique, et « l’obligation d’internaliser l’environnement ».
Fondateur de la revue Écologie politique, Jean-Paul Deléage souligne avec raison que « l’écologie politique ne peut tirer son fondement de la science, fût-elle écologique ». Face aux prétentions et aux ambiguïtés de l’écologie politique, il s’agit d’entreprendre ce qui fut fait naguère pour l’économie : une critique de l’écologie politique.
En 1993, Alain Lipietz proclamait péremptoirement l’avènement d’un « nouveau paradigme » écologique, « le paradigme vert, en tant qu’il englobe les aspirations émancipatrices du mouvement ouvrier et les élargit à l’ensemble des relations entre humains, et entre eux et la nature ». L’affaire est lourde de conséquences, puisque ce primat paradigmatique justifierait la prétention des Verts à « un rôle futur de direction culturelle ». On retrouve ainsi, par la voie détournée du paradigme écologique, l’idée par ailleurs condamnée d’une avant-garde éclairée et de sa vocation hégémonique autoproclamée au nom du savoir scientifique3
.
Dans un petit livre récent, Lipietz est revenu sur cette question essentielle : « Y a-t-il un paradigme de l’écologie politique ? » Définit-elle un faisceau de valeurs et d’objectifs distincts de celui que proposent libéraux, démocrates, socialistes, communistes ou libertaires ? Est-elle « capable de coaliser un certain nombre de forces sociales aspirant à des réponses nouvelles aux questions qui se posent à l’ensemble de la société » ? La réponse de Lipietz est catégoriquement « oui » ! Le noyau identitaire de cette écologie politique reposerait sur deux caractéristiques fondamentales : l’anti-productivisme et l’anti-étatisme. À première vue de bon aloi, ces deux « anti » s’avèrent aussi problématiques l’un que l’autre.
Défini comme la poursuite illimitée du programme baconien de domination de l’empire humain sur l’empire naturel, le terme de productivisme stigmatise la fuite en avant dans la production pour la production. Mais il ne remonte pas à la racine de cette course à l’abîme : la soif mortifère de profit. L’accumulation illimitée du capital n’est pas la seule forme de productivisme imaginable. Les désastres écologiques, en Union soviétique comme en Chine, sont là pour le rappeler. Encore faut-il préciser, sans l’exonérer le moins du monde, que ce productivisme bureaucratique est la forme brutale qu’a prise l’accumulation primitive dans un contexte de concurrence impitoyable dominée par la loi du marché mondial. Le productivisme réellement existant aujourd’hui est organiquement lié à la logique intime du capital. C’est pourquoi l’anti-productivisme de notre temps est nécessairement un anticapitalisme : le « paradigme écologique » est indissociable du « paradigme social » déterminé par les rapports de production.
Quant à l’anti-étatisme, pas plus que l’anti-productivisme il ne suffit à fonder une politique cohérente. Car il y a bien des façons de s’opposer à l’étatisme centraliste et bureaucratique : du non- État des libertaires à l’État allégé des libéraux, en passant par le dépérissement de l’État comme corps séparé et la socialisation de ses fonctions, qui est le fil conducteur d’un communisme critique.
La notion de paradigme écologique remplit donc avant tout une fonction idéologique. Elle est censée fournir un fondement doctrinal propre à la « troisième gauche » sans attaches de classe chère à Daniel Cohn-Bendit. Elle est assez vague pour permettre une critique feutrée de la mondialisation capitaliste en faisant l’impasse sur la question cruciale de l’appropriation sociale. Cohn-Bendit a au moins le mérite de mettre les points sur les i : « Le renversement politique n’est pas souhaitable ; les gens sont convaincus avec raison que le système qui marche le mieux, c’est le capitalisme. » L’heure serait venue pour lui de « renoncer à l’autogestion pour la gestion4
».
L’épreuve de la gestion tout court est, hélas, assez probante. Il s’agit de « contrarier les logiques dominantes » et de les « réorienter en profondeur », dit Dominique Voynet. En pratique, la ministre verte se contente d’une acception minimaliste du développement durable : « le meilleur rapport coût/bénéfice ». Cette « écologie faible » (ou modeste) a conduit l’écologie gouvernementale à de bien douteux compromis : sur les organismes génétiquement modifiés, sur l’ouverture des sites de stockage de déchets nucléaires, sur la poursuite de la filière mox… Solidarité plurielle oblige ! Le lobbying efficace de la branche bâtiment et travaux publics contre le projet Natura 2 000 de protection des écosystèmes a abouti en 1998 à réduire les 1 623 sites proposés en 1995 par les équipes de recherche du muséum national d’Histoire naturelle (15 % du territoire) à 800 sites (4 % seulement du territoire). Les bénéfices escomptés du marché du génie génétique à l’horizon de 2005 s’élèveraient à 110 milliards de dollars ! Et le plan Jospin de lutte contre le changement climatique avalise sans crier gare l’institution d’un marché des permis à polluer, réclamée par les États-Unis dans les négociations internationales.
À force d’avaler des couleuvres, on finit par ramper. Et le bogue retentissant des Verts devant la marée noire de l’Erika et les dégâts de la tempête de Noël 1999, au-delà des maladresses médiatiques de Voynet et de Cohn-Bendit, est révélateur des contradictions d’une écologie gestionnaire. On ne biaise pas avec le marché dont la logique est bel et bien globale : une écologie gouvernementale et technocratique, sans ambition de transformation sociale, n’est décidément pas à la hauteur des défis annoncés.
Dans la mesure où elle élargit le champ des connaissances et introduit de nouvelles temporalités sociales, l’écologie critique interpelle « le Rouge », comme le dit fort bien Pierre Rousset. Dans la mesure où elle oblige à aller au cœur du fonctionnement de nos sociétés, elle interroge aussi « le Vert ». Elle oblige l’un et l’autre à un inventaire critique : qu’en est-il du progrès ? de la croissance ? du bien-être ? Elle leur interdit le recours commode à un avenir d’abondance, permettant de ne rien choisir et de ne pas arbitrer sous prétexte que tout sera un jour simultanément possible et compatible. Ce joker de l’abondance a longtemps justifié un bond imaginaire dans un monde virtuel sans contraintes ni limites. Si tant est qu’elles puissent être transgressées un jour, ces limites sont pour longtemps encore notre lot. En attendant, toute politique reste un art des limites5
.
Nous touchons ici à la question cruciale de savoir en quoi consiste au juste la spécificité de l’écologie critique. En regroupant sous ce vaste titre fourre-tout des phénomènes sociaux relevant aussi bien de l’urbanisme, de la santé publique, des pathologies du travail, du réseau de transport ou de la consommation d’énergie, la notion perd en précision ce qu’elle gagne en extension. Au risque de perdre en route ce qui fait la nouveauté et la spécificité de la question écologique. Engels, qu’il serait exagéré de qualifier d’écologiste, critiquait dès 1845 avec beaucoup d’acuité les dégâts du progrès, liés à la course productiviste au profit, en matière de logement, de fléaux sociaux, de dégradation du paysage. Toutes proportions gardées, les catastrophes industrielles du XIXe siècle n’avaient rien à envier à celles du XXe. Qu’on se souvienne du coût humain et social du canal de Panama, de l’insécurité dans les mines, des déraillements de chemins de fer, du naufrage du Titanic, du saturnisme – maladie des taudis – et de la tuberculose – maladie de la pauvreté. On mourait de la silicose bien avant que l’on commence à mourir de l’amiante.
Si la critique d’un certain fondamentalisme écologiste indifférent à la question sociale est nécessaire, la réduction inverse de l’écologie aux souffrances sociales les plus diverses passe à côté de la question désormais essentielle des rapports des sociétés humaines à leur environnement et des limites naturelles relatives qui conditionnent leur capacité de reproduction. C’est la prise de conscience de ces limites qui fait la nouveauté de la question écologique.
Cette précision devrait aider à démêler les arguments confus, et parfois contradictoires, de certains plaidoyers écologistes. Il faut défendre la biodiversité ? Nous en sommes bien d’accord. Mais pourquoi au juste ? Par préférence esthétique pour la différence contre l’uniformité ? Pas respect de la vie sacralisée sous toutes ses formes ? Serait-il donc incompatible d’être écologiste conséquent et pêcheur, chasseur ou amateur de corrida ? Un bon écologiste devrait-il être forcément végétarien ? Pourquoi le respect absolu du vivant devrait-il s’arrêter au règne animal au lieu de s’étendre au règne végétal ? Ou commence et ou finit la vie dans un écosystème ? On voit poindre les dérives possibles d’un intégrisme écologique mêlant imprudemment des critères philosophiques ou religieux, esthétiques et sociaux.
La disparition des dinosaures (et de bien d’autres espèces) a probablement été l’une des conditions d’apparition de l’espèce humaine. Imaginons un dinosaure écologiste, partisan intransigeant de la biodiversité de son temps et du statu quo de son univers. Il aurait tout fait, légitimement, pour empêcher les modifications qui ont conduit à notre existence. Il aurait ainsi voulu priver le monde de cette bizarrerie aussi inouïe qu’improbable que constituent les sociétés humaines. De même, l’acharnement à préserver les conditions de reproduction de l’espèce terriblement prédatrice que nous sommes empêche peut-être l’éclosion de formes inédites et imprévisibles du vivant.
Une écologie naturaliste radicale, n’accordant à l’espèce humaine aucun intérêt particulier dans le règne du vivant devrait logiquement être indifférente aux arguments qui privilégient la survie de l’espèce et la solidarité intergénérationnelle. Elle pourrait même redouter que l’intervention de l’artefact humain ne vienne fausser la régulation naturelle dont participeraient aussi les catastrophes et les épidémies.
Le paradoxe n’est qu’apparent. C’est en effet en référence à notre pauvre échelle humaine, à l’échelle de notre pauvre temporalité historique, que se situe le seul argument rationnel convaincant en faveur d’une préservation de la biodiversité actuellement existante. Car la diversité elle-même n’est pas éternelle. Elle a une histoire. Il y a la diversité d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Pourquoi se priver de surprises en s’accrochant à celle d’aujourd’hui, si ce n’est précisément parce que c’est la nôtre !
Si l’apparition et le développement de l’espèce humaine ont bénéficié de circonstances écosystémiques exceptionnelles, l’effet cumulatif des atteintes à l’environnement et sa modification à une vitesse dépassant celle des capacités d’adaptation risquent de produire un franchissement de seuil, de provoquer des conséquences incontrôlables, jusqu’au basculement qualitatif conduisant à une extinction de l’humanité. C’est un argument fort en faveur d’un principe rigoureux de précaution. Mais c’est, reconnaissons-le, un argument conservateur et, à n’en point douter, un argument anthropocentrique dans la mesure où il accorde une attention particulière et un statut privilégié à notre humble engeance.
L’écologie sociale est forcément une écologie humaniste. Faut-il y voir la preuve d’une nostalgie anthropocentrique du sacré, un reste de présomption de la créature divine ? Pas nécessairement. À moins d’exclure la possibilité d’un humanisme profane, ce qui soulèverait bien d’autres questions ! Religieux pour religieux, le naturalisme radical n’est pas moins suspect de relents polythéistes et de fantasmagorie païenne.
La controverse relève en réalité d’une opposition politique entre une écologie humaniste et une écologie anti-humaniste, entre une écologie sociale et une « écologie profonde » ou naturaliste. Le partage se fait sur la question de savoir si l’homme peut être considéré comme une fin actuelle de la biodiversité ou comme une espèce parmi d’autres dont l’avenir nous indiffère. Confrontés aux misères de notre temps, nous nous efforçons d’y répondre avec nos moyens en ménageant notre niche spatio-temporelle. À ce niveau, la crise écologique ne cesse de croiser la crise sociale.
Les limites imposées par notre appartenance à la biosphère et par le fait que nous restons, en dépit de la technique, des êtres naturels sont certes relatives. Mais, à notre échelle humblement humaine de quelques milliers d’années, un seuil fatal pour l’espèce que nous sommes pourrait être franchi. Nous pouvons toujours, en bons mécréants, hausser les épaules : « Et alors ? Si les dinosaures ont disparu, pourquoi les humanoïdes associés devraient-ils jouir d’un privilège de longévité ? » Si nous sommes si peu de chose, autant profiter au mieux du peu de temps qu’il nous reste, vivre sans temps mort et jouir sans entraves, avant la catastrophe annoncée : « Point de lendemain ! » Seule une écologie humaniste peut au contraire éviter l’effet démobilisateur d’un écologisme apocalyptique. Face aux conséquences désastreuses de l’effet de serre, du stockage des déchets nucléaire, du transport à moindre coût des produits polluants, des effets sur l’environnement de l’urbanisation sauvage et de l’agriculture industrielle, c’est par l’expérience du lien concret entre écologie critique et lutte de classe que la conscience et la mobilisation écologistes gagneront la force nécessaire pour conjurer les périls qui nous menacent.
C’est à cette intersection entre crise écologique et crise sociale que nous jouons en effet avec nos limites. Dans leur critique de la théorie malthusienne de la surpopulation, Marx et Engels rejetaient la notion de limite naturelle ou absolue. Sans être conscients de la question écologique telle qu’elle se pose désormais à nous, ils n’ignoraient pas pour autant la notion de limite relative à une époque et à un mode de production donnés : le capital, qui se survit au prix d’une irrationalité croissante, est bel et bien à lui-même sa propre limite. De même, les énergies dites non renouvelables le sont sous certaines formes et à une certaine échelle temporelle. Il n’y a pas, dans un avenir prévisible, péril de pénurie absolue en la matière. Par rapport au niveau actuel de dépense énergétique, les réserves que représentent l’énergie solaire et la biomasse sont considérables. En revanche, il peut se produire une rupture d’équilibre aux conséquences imprévisibles, entre la lenteur du stockage (végétal et fossile) et la rapidité du déstockage induit par notre mode de consommation.
Par son fonctionnement systémique, la biosphère permet l’épanouissement et la reproduction du vivant. Elle opère comme une sorte d’immense organisme à recyclage et à régulation complexes permettant de passer de l’organique à l’inorganique, et vice-versa. Des travaux pionniers de Marsh (1864) et Haeckel (1867) au rapport du Club de Rome (1972) ou au rapport Brundlandt (1987) a émergé l’idée d’une temporalité écologique spécifique qu’illustrent bien les notions d’énergies non renouvelables ou de développement durable. Le rapport Brundlandt définit en effet le développement durable comme « répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». Il s’agit de concilier deux ordres partiellement contradictoires : celui de la biosphère à laquelle nous appartenons et celui d’un monde social proprement humain. Le principe de précaution (légalement reconnu en France à propos du « risque de dommages graves et irréversibles ») est étroitement lié à ce souci du futur et du long terme.
Apparaît ainsi la discordance entre une temporalité sociale, rythmée par les cycles d’accumulation du capital, et une temporalité écologique, déterminée par le stockage et le déstockage d’énergie naturelle. Marx a entrevu, à propos de la sylviculture, cette rupture entre la longue durée de phénomènes naturels et le court terme qui régit l’économie marchande : « La longue durée du temps de production (qui ne comprend qu’un temps de travail relativement restreint) et par suite la longueur de périodes de rotation, font de la sylviculture quelque chose de peu propice à l’exploitation capitaliste essentiellement privée6
. » Le capital vit au jour le jour, avec pour seul horizon le profit du lendemain ou du surlendemain. Après lui, le déluge ! Seule la bureaucratie parasitaire peut rivaliser avec son insouciance et son égoïsme à courte vue.
Contre la prétention à une éternité marchande, le verdict écologique est impitoyable. Par rapport aux régulations de la biosphère, la rationalité partielle du marché fonctionne au prix d’une irrationalité globale croissante. La critique de l’écologie politique exige une révision radicale des rapports réciproques entre nature et société, science et politique. Elle impose du même coup de reformuler quelques grandes interrogations. Quelle histoire faisons-nous ? Quelle planification des ressources et des projets est compatible avec un développement durable ? Quelle démocratie peut en décider ?
Une nouvelle dialectique des temps sociaux implique un dialogue constant entre la politique comme art du présent (où les choix techniques font l’objet d’une « évaluation citoyenne ») et l’éthique comme « messagère du futur ». Il ne s’agit plus seulement de prévenir les dommages graves que nous pouvons infliger à notre niche écologique, mais de déterminer l’humanité que nous entendons devenir.
On n’échappe pas à la question de la relation entre le rapport prédateur à la nature et le rapport social d’exploitation. S’agit-il de deux domaines juxtaposés, indifférents l’un à l’autre ? Sont-ils, au contraire, étroitement imbriqués ? L’histoire des sciences et des techniques, de l’essor du capitalisme, de l’industrialisation et de l’urbanisation plaide à l’évidence pour la seconde hypothèse. La formule de Bacon définit bien un programme de domination : « La nature est une femme publique, nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l’enchaîner selon nos désirs. »
Comme l’écrit Dominique Bourg, c’est « notre mode de production et de consommation qui est en cause7». « Les crises écologiques d’une époque, confirme Alain Lipietz, sont des crises des rapports sociaux de cette époque. » Crises sociales et crises écologiques sont, dans une large mesure, superposables : « À partir des temps modernes, les crises écologiques apparaissent totalement subordonnées à l’économie. » Il n’est pas fortuit que les médecins hygiénistes et les philanthropes du XIXe siècle, confrontés aux dégâts sanitaires et urbains de l’industrialisation capitaliste, fassent figure de pionniers de l’écologie moderne : le libéralisme économique a « engendré sa propre forme de crise écologique ».
Ces crises se propagent non seulement à travers l’atmosphère et les cours d’eau, mais aussi par le biais de la circulation marchande. L’essentiel des pollutions atmosphériques provient ainsi des « pratiques marchandes visant à la maximisation des profits et des rentes8
». L’écologie a ses raisons que la déraison capitaliste ignore. Le capital fait de la nature « un pur objet pour l’homme » et « une pure affaire d’utilité ». On ne saurait donc confier le soin écologique de la planète à la régulation du marché, fût-ce à un « marché vert ». Comment résoudre les crises écologiques sans changer radicalement cet ordre marchand ? Une régulation politique démocratique ne serait sans doute pas suffisante pour conjurer toute forme de crise écologique – l’expérience de l’Europe de l’Est est là pour rappeler la possibilité d’un écocide bureaucratique 9– mais c’est certainement une condition nécessaire.
Lipietz définit l’environnement comme un bien collectif, international et intergénérationnel. Grâce à l’introduction de « régulations écologiques », la valeur des marchandises au XXIe siècle devrait parvenir selon lui à refléter « non seulement le travail incorporé dans leur production, mais la dégradation de l’environnement ». Comment cette dégradation pourrait-elle être mesurée en termes monétaires ? Les indéfinitions du principe pollueur-payeur en montrent d’ores et déjà la difficulté. Que paie, au juste, le pollueur ? Le coût social de la déforestation, de la pollution des eaux, de l’effet de serre, est « beaucoup plus diffus », admet Lipietz, que ne l’estime son évaluation marchande.
Le problème n’est pas nouveau. « Vis-à-vis de la nature comme de la société, notait Engels, on ne considère principalement, dans le mode de production actuel, que le résultat le plus proche et le plus tangible. » C’est pourquoi « la commensurabilité n’existe pas ». L’économie classique s’avère incapable de penser autrement qu’en termes d’équilibre. Elle traite les « externalités » comme des défaillances par rapport à un idéal de concurrence parfaite. Leur évaluation monétaire exprime de façon tout à fait inadéquate la « véritable valeur » sociale des coûts environnementaux. La proposition de taxes spéciales tente d’internaliser ces coûts. Mais l’improbable équivalence entre les lésions à long terme infligées à la nature et leur compensation monétaire immédiate illustre les limites de la rationalité concurrentielle et le conflit entre temporalités marchandes et écologiques10.
L’internalisation, qui prétend évaluer les dommages en monnaie, de façon à déterminer les nuisances compatibles avec l’équilibre du marché, ne parvient pas à prendre en compte le mode de reproduction de la biosphère. Soumise aux critères de valeur marchande, elle tend à définir des optima de pollution supérieurs à la capacité régénératrice de l’environnement. C’est pourquoi la critique de l’écologie politique doit contribuer à mettre en crise la science économique et ses prétentions. L’objet de l’économie ne peut plus être l’allocation optimale de ressources selon la logique dominante du marché. Elle rencontre dans l’écologie l’exigence de normes extra-économiques. Il faut rechercher une autre rationalité, « qui se confonde avec le raisonnable11
». La « bioéconomie » se présente alors comme un ultime effort pour échapper à l’écologie de marché sans avoir à rallier la critique marxiste.
La question des pollutaxes et des quotas transférables (deux modalités pratiques du principe pollueur-payeur) montre pourtant les limites des correctifs fiscaux compatibles avec la régulation marchande. Elle soulève un triple problème de justification, d’effet redistributif et d’affectation du produit. S’agit-il de financer la remise en état de ce qui a été détérioré ? Elles sont alors une forme de redevance. S’agit-il de réparer un dommage particulier ? Elles correspondent alors à une indemnisation. Ou s’agit-il simplement d’affecter un prix dissuasif plus ou moins arbitraire (en tout cas politique) à la nuisance ?
Certains auteurs redoutent que les pollutaxes ne deviennent un moyen d’évacuer une contradiction tenace. Les permis négociables sur l’émission de gaz à effets de serre présenteraient en effet l’avantage de fixer un plafond global, une sorte d’enveloppe globale de pollution tolérable, mais ils auraient aussi le double inconvénient d’exiger un surcroît de contrôle bureaucratique (fort peu anti-étatiste) et surtout d’entretenir ou d’accroître les inégalités de la planète, les riches rachetant aux pauvres leurs droits à polluer pour pouvoir préserver leur propre mode de développement écocidaire. C’est à l’idée même d’un environnement-marchandise, d’une écologie de marché ou d’une écologisation du capital que doit s’attaquer l’écologie critique.
Dominique Bourg estime à juste titre que l’écologie politique est vouée à l’échec si elle prétend figer les inégalités sociales en l’état inégal actuel. Les forces productives ne sont certes pas neutres. Façonnées par les rapports de production, elles contribuent en retour à les reproduire. S’il est insuffisant pour garantir un progrès culturel et social, leur développement n’en est pas moins nécessaire pour permettre une forte baisse du travail contraint, non seulement dans les pays riches mais à l’échelle planétaire.
Pour André Gorz, le travail mort pèse désormais tellement lourd sur le travail vivant, qu’il n’est plus d’émancipation pensable dans et par le travail. Déterminant une hétéronomie irréductible du travailleur, l’industrie et la technique seraient devenues aliénantes par nature. À cette dépossession irréversible ne pourrait s’opposer qu’une « revalorisation de l’autolimitation comme valeur éthique et comme dynamique concrète de changement ». Cette « culture de l’autolimitation » et cette exhortation à une ascèse écologique nous renvoient une fois encore à l’épineuse question des limites et des seuils. S’il est vrai que le productivisme industriel et l’euphorie scientiste du capital en expansion se sont caractérisés par leur insouciance des limites, les crises écologiques, sanitaires et urbaines d’aujourd’hui soulignent l’importance des effets de seuil. Au-delà d’un certain niveau d’émission des gaz à effet de serre, les conséquences deviennent incontrôlables. Au-delà d’un certain seuil d’urbanisation barbare des mégapoles, la reconstitution d’une cité démocratique à visage humain devient difficilement imaginable.
Enchaîné par le compromis fordien à la logique productiviste du capital, le mouvement ouvrier s’est souvent montré indifférent, voire carrément hostile, à la critique écologique. Il n’est pas surprenant que cette fracture soit longue à réduire, d’autant plus qu’il n’est pas toujours facile de concilier à court terme l’écologie radicale et la défense de l’emploi. De grandes questions, de plus en plus urgentes, comme celles de l’agriculture, de la santé, de la ville, créent cependant un besoin pressant de convergences.
La déchirure est également flagrante lorsque certains pays du Sud, et non des moindres, refusent des mesures de limitation en matière de pollution ou de consommation énergétique, qui figeraient en l’état le développement inégal de la planète. Faut-il, comme Alain Lipietz, stigmatiser ces « raidissements nationalistes » des « élites productivistes du Sud » et réduire la responsabilité du Nord aux « abus de pouvoir du passé » ? Comme si les abus de pouvoir n’étaient pas encore ceux du présent ! Et comme si l’argument écologique ne pouvait pas aussi servir à perpétuer des rapports de domination ! Alors que la moyenne tolérable d’émission de carbone est évaluée à 600 kg par habitant de la planète, les États-Unis en émettent cinq tonnes, l’Union européenne deux et le Bangladesh 60 kg.
Justifiant par avance, au nom de l’urgence, tous les compromis gouvernementaux nécessaires, Lipietz plaide pour une stratégie écologiste faible : une politique écologiste se devrait d’être « résolument réformiste, c’est-à-dire réformer résolument et tout de suite ». Nul ne saurait faire la fine bouche devant des réformes radicales. Deux ans de ministère vert de l’Environnement n’ont guère confirmé cette ardeur réformatrice. Dans Vert espérance, constatant que les Verts les plus fondamentalistes ne savent que répondre sur l’anticapitalisme, Lipietz se montrait plus incisif : « Ils rêvent sans doute à une multitude de microruptures, à des révolutions moléculaires à jamais inachevées. » C’était avant 1997 et la conversion à la réal-écologie ministérielle. Du temps où l’espérance verte avait encore de l’ambition…
Bruno Latour va encore plus loin dans le sens d’une écologie faible. Avec la multiplication des hybrides et des intérêts, la dispersion postmoderne des collectifs en compositions variables, la dissolution des classes et l’extinction de leur lutte, l’affrontement épique entre progrès et réaction aurait perdu son sens. Droite et gauche ne pourraient plus dès lors « récapituler ces divisions » croisées. Il n’y aurait plus de front principal repérable, mais des convergences de circonstance, des alliances changeantes et des compromis kaléidoscopiques. La politique deviendrait ainsi une affaire d’opportunités sans principes.
Les lignes de front sont indéniablement brouillées et parfois croisées. « What is left of the Left ? » demandent les Britanniques confrontés à la « troisième voie » social-libérale. S’il existe bien une gauche de droite, une gauche du centre et une gauche de gauche, il n’y a pourtant pas de droite de gauche. Et si l’on cherche sérieusement la voie d’une écologie sociale et démocratique, on retrouve inévitablement les questions cruciales de la propriété et du pouvoir. Il n’y a plus alors une, mais des écologies politiques.
L’écologie des profondeurs prétend étendre à tous les êtres naturels l’impératif kantien de ne jamais les traiter comme moyens et à l’écosystème de la planète entière le respect du vivant12. Au nom d’une obligation inconditionnelle envers un avenir ventriloque, le philosophe Hans Jonas rend le présent indécidable et cherche des substituts antidémocratiques à la politique dans le recours à une transcendance dont le rejet constitue à ses yeux « l’erreur la plus colossale de l’histoire ». Pour la corriger, Jonas va jusqu’à souhaiter une resacralisation et « un nouveau mouvement religieux de masse ». Ce vœu risque hélas d’être exaucé, pour le pire plutôt que pour le meilleur, sans que l’écologie ait le moins du monde à y gagner.
L’autre issue envisagée par Jonas consisterait à s’en remettre au despotisme éclairé des savants dépositaires de l’écologique scientifique. Dans cette perspective, « l’heuristique de la peur » justifie la résignation aux tourments du présent comme à un moindre mal. Alors que son « principe responsabilité » prétend insister sur la solidarité entre générations, les attaques libérales contre les systèmes de retraite par répartition contribuent à détruire leur solidarité sociale : cette contradiction suffit à vérifier l’imbrication entre paradigme social et paradigme écologiste.
Il existe aussi une écologie institutionnelle tournée vers les décideurs, dont la pratique de prédilection est le lobbying auprès des gouvernements ou des conférences internationales. La voie des corridors et des antichambres est d’autant plus tentante pour certaines organisations non gouvernementales que les lieux de décision au sommet semblent hors de portée des citoyens ordinaires. Il leur paraît alors plus réaliste d’influencer les détenteurs du pouvoir que de construire une alternative radicale. Ce lobbying institutionnel est fort éloigné de la démocratie participative ou autogestionnaire. Il en est même très exactement l’opposé.
Émerge enfin l’ébauche d’une écologie populaire et militante, irriguant les mouvements sociaux, syndicaux, agraires, associatifs. Elle ne pourra se développer sans surmonter les indéfinitions théoriques de l’écologie politique actuelle. Présentant la transformation de la revue Écologie politique en Écologie et politique, l’éditorial de Jean-Paul Deléage souligne « la nécessité de repenser le projet initial » : « Bien des arguments anti-systémiques (anti-productivistes, anti-étatistes, anti-hiérarchiques) des premiers prophètes de l’écologie se sont retournés au profit du système, laissant exsangues les mouvements politiques qui avaient formé le projet de renverser la société de consommation13. »
Au risque de ranimer les craintes d’une planification autoritaire, René Passet est catégorique sur ce point : il est impossible d’assigner aux biens et aux coûts écologiques une valeur monétaire. Quelle autre mesure envisager, si ce n’est une mesure politique et démocratique, une évaluation collective des besoins, des moyens et des risques, éclairée par le développement de la culture scientifique générale ? Pour des écologistes critiques, la « gestion normative » par une planification des ressources à moyen et long terme devrait s’imposer.
Leur fragilité théorique condamne hélas nombre de courants écologistes à faire pudiquement l’impasse sur les questions de la propriété et de la planification, pourtant décisives lorsqu’il s’agit de gestion durable des ressources, d’aménagement du territoire, de politique des transports ou de la ville. Quelques voix osent cependant lever le lièvre : « La planification, assimilée au modèle déchu dirigiste centralisé, est tournée en dérision au moment où nous en avons besoin pour concevoir et promouvoir des stratégies à long terme de développement durable », car « le développement viable demande une régulation accrue des marchés et la subordination des objectifs économiques à l’impératif social »14.
Se dessinent ainsi les contours d’un écocommunisme à venir. La constitution de grands groupes d’intérêts privés comme Vivendi, concentrant des fonctions aussi sensibles que le traitement de l’eau, la gestion des déchets et la production de l’information, met à l’ordre du jour l’extension du service public pour assurer la transparence de ces secteurs et leur gestion en fonction de besoins sociaux démocratiquement déterminés. Le choix de transports moins polluants irriguant équitablement l’ensemble du territoire, garantissant des conditions de travail humaines, s’oppose à la logique de services coûteux, polluants, inégalitaires, soumis au seul critère de rentabilité marchande. Plus généralement, une politique ambitieuse d’aménagement du territoire réclame la transformation des schémas actuels de services collectifs dans le sens d’une planification démocratique décentralisée. Dans certaines branches fortement internationalisées, les moyens d’une telle planification imposent d’ores et déjà d’envisager des formes d’internationalisation de la propriété publique et de gestion commune, au moins au niveau européen15.
Le combat contre le chômage et l’exclusion passe lui aussi par l’exigence d’un mode de vie moins prédateur, plus riche en emplois, élargissant l’éventail des métiers socialement utiles. Les luttes contre les pollutions, contre les pathologies du travail, pour la défense de la santé publique et d’une alimentation de qualité, pour le développement d’une agriculture paysanne et contre la pollution des eaux par l’agro-industrie sont indissociablement sociales et écologistes. Un projet écocommuniste exigerait enfin une articulation démocratique nouvelle entre présent et avenir, comme entre espaces régionaux, nationaux et internationaux, entre présent et avenir. Car, ainsi que le dit José Bové : « Face à de tels enjeux de société, il est impossible de gagner seul. Non, Monsieur Jospin, il ne s’agit pas d’une gauloiserie franchouillarde et éphémère16. »
Le Sourire du spectre, nouvel esprit du communisme, chapitre II (Partie III : « Métamorphoses du spectre »), Paris, Éditions Michalon, 2000
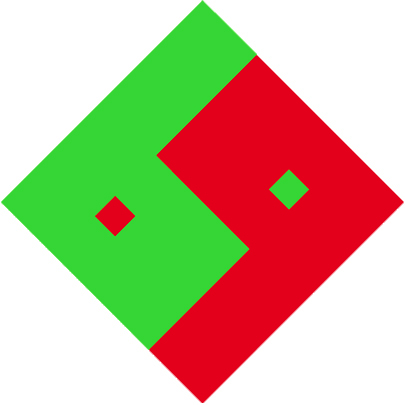
Documents joints
- Alain Lipietz, Qu’est-ce que l’écologie politique ?, Paris, La Découverte, 1999. ↩︎
- Bruno Latour, Politiques de la nature, Paris, La Découverte, 1999, p. 71. ↩︎
- Alain Lipietz, Vert espérance, Paris, La Découverte, 1993. ↩︎
- Daniel Cohn-Bendit, Une envie de politique, Paris, La Découverte, 1998. ↩︎
- Sur ce sujet, voir la critique efficace par Michel Husson du néomalthusianisme libéral comme du paradigme vert, in Sommes nous trop ?, Paris, Textuel, 2000. ↩︎
- Karl Marx, le Capital, Paris, Éditions sociales, Livre III, tome II, p. 225. ↩︎
- Dominique Bourg, Planète sous contrôle, Paris, Textuel, 1998. ↩︎
- Alain Lipietz, Qu’est-ce que l’écologie politique ?, op. cit., p. 114. ↩︎
- Il est significatif que l’écologie soviétique prometteuse des années vingt, inspirée des travaux de Vernadsky ait été l’une des premières victimes du Thermidor bureaucratique : sa critique du productivisme était difficilement compatible avec les délires de la collectivisation forcée et de l’industrialisation à marche forcée, ainsi qu’avec l’idéologie du « socialisme dans un seul pays », peu propice au souci internationaliste de la biosphère ; de même, l’exigence démocratique inhérente à une politique écologique radicale ne pouvait qu’entrer en conflit avec le volontarisme bureaucratique et ses entreprises pharaoniques. ↩︎
- Voir, K. W. Kapp, les Coûts sociaux dans l’économie de marché, Paris, Flammarion, 1976. ↩︎
- Jean-Paul Maréchal, le Rationnel et le Raisonnable, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1997. ↩︎
- Poussant cette logique, certains écologistes démographes évaluent à moins d’un milliard la population de la planète raisonnablement compatible avec le respect de la diversité. On peut craindre le pire des moyens envisageables (ethnocides, épidémies, contrôle autoritaire des naissances) pour atteindre une telle réduction démographique. Voir Stan Rowe, « From Reductionism to Holism in Ecology and Deep Ecology », in The Ecologist, n° 4, juillet-août 1997. Pour une critique du néomalthusianisme, voir Michel Husson, Sommes-nous en trop ?, op. cit. ↩︎
- Écologie et Politique, n° 15, automne 1995. Voir aussi Pierre Rousset, le Rouge et le Vert, fascicule n° 9 pour le bicentenaire du Manifeste communiste, Espaces Marx, 1998. Ainsi que les précieux dossiers de la revue Arguments pour une écologie sociale. ↩︎
- Ignacy Sachs, l’Écodéveloppement, Paris, Syros, 1997. ↩︎
- Voir Philippe Chailan, in Arguments pour une écologie sociale, n° 33, novembre 1999. ↩︎
- Le Monde diplomatique, octobre 1999. ↩︎