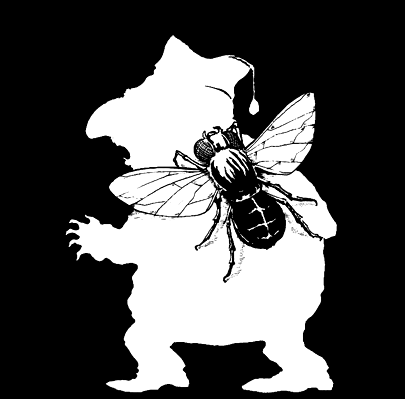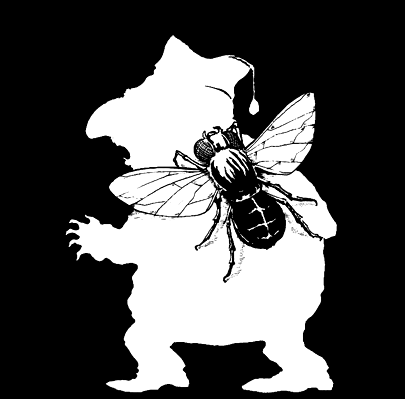
Le défi démocratique
Santiago Carrillo et le PCE s’étaient engagés à placer Juan Carlos devant un fait accompli en ouvrant des locaux et en faisant surface. Pour maintenir ce défi, il faudrait être prêt à aller plus loin, beaucoup plus loin.
Il ne faudra que quelques jours pour connaître les intentions de Juan Carlos. Il dispose d’une semaine seulement avant l’investiture, d’une semaine pour annoncer la couleur d’un règne qui, de toute façon, ne sera jamais qu’un interrègne.
Continuité et changement… En acceptant sa désignation au trône par le dictateur en personne, Juan Carlos a promis la continuité : il a prêté serment au « mouvement », c’est-à-dire à la Phalange. Mais il devra donner au moins l’illusion du changement. Son second intérim en annonce les limites : le prince a promis d’accorder certaines concessions aux provinces basques de Biscaye et de Guipuzcoa ; il a reconnu l’usage des langues minoritaires.
Mais, en même temps, les intimidations, les arrestations, les sévices se sont multipliés ces derniers jours. Les groupes d’extrême droite opérant en liaison directe avec la police se permettent de rosser des journalistes étrangers, d’entrer l’arme au poing dans les universités, de malmener les familles de prisonniers ou d’exilés politiques.
L’actuel Premier ministre, Arias Navarro, a déjà fait l’expérience des limites de l’ouverture dans le cadre du régime actuel. Le décret du 16 décembre 1974 sur les « associations politiques » en administre la preuve : le décret pose comme condition à la reconnaissance desdites associations l’acceptation des principes fondamentaux du Mouvement qui constituent une sorte de code politique résultant de la guerre civile.
En novembre 1974, les deux ministres considérés comme les plus libéraux du régime, Pio Cabanillas (Information) et Barrera de Irimo (Finances) démissionnaient. Enfin, début août 1975, Franco lui-même décidait de prolonger la législature en cours jusqu’au 15 mars 1976, alors que le renouvellement des Cortès devait avoir lieu cet automne : en cas de passation des pouvoirs, Juan Carlos se verrait ainsi solidement contrôlé par une assemblée résolument ultra. D’emblée, la voie de l’après-franquisme s’annonce donc comme des plus étroites.
Trois solutions qui n’en sont pas
Très vite, Juan Carlos devra se prononcer sur le sort de l’actuel gouvernement. Trois possibilités s’ouvrent à lui :
1. Il s’appuie sur une équipe gouvernementale inchangée (ou même sur une équipe plus liée encore à l’appareil de la Phalange). Dans ce cas, il ne tire pas le moindre parti de la passation des pouvoirs pour tenter d’élargir une popularité déjà compromise par les serments d allégeance au dictateur et par sa présence à ses côtés, il y a quelques semaines encore, sur la place d’Orient. Il court le risque d’une épreuve de force rapprochée, non seulement avec le mouvement ouvrier, mais avec des secteurs significatifs de la bourgeoisie qui ne croient plus en la viabilité d’un système qui survit aux conditions qui l’ont vu naître, en entravant l’entrée de l’Espagne dans la communauté européenne, au moment où les effets de la crise dans la péninsule prouvent qu’il serait illusoire de croire encore aux vertus du miracle espagnol : le pays a bénéficié depuis 1959 des retombées de l’expansion capitaliste généralisée. Il a connu un taux de croissance moyen de 7 % par an, au deuxième rang après le Japon. Il a profité du boom touristique et des mandats d’une main-d’œuvre émigrée qui masquait les risques de chômage en allant chercher du travail en France, en Suisse ou en Allemagne. Il a reçu de forts investissements de capitaux étrangers attirés par les bas salaires et les juteux profits. Déjà les avantages temporaires montrent leurs revers. Le tourisme se ralentit. Les investissements se raréfient, les émigrés, chassés par le chômage, regagnent le pays (en 1974, le chiffre des retours a équilibré celui des départs).
2. Il constitue une « coalition de centre gauche », accorde une amnistie, et promet des élections. Cette hypothèse paraît vraisemblable. Non parce qu’elle est contraire au serment de fidélité prêté par Juan Carlos au caudillo. Mais parce qu’il n’a plus les moyens d’une telle opération.
Tout l’intérêt d’une telle formule, du point de vue de la bourgeoisie, consisterait à mettre en place les forces d’une possible majorité électorale tout en maintenant le PCE à l’écart. En quelque sorte de confier à une coalition comparable à celle du PPD et du PS au Portugal la tâche de préparer des élections. L’impasse d’une telle formule, c’est qu’elle implique précisément la perspective d’élections et qu’en cas d’élections les embryons de partis démocrate-chrétien et socialiste qui existent à l’heure actuelle ne seraient pas assez forts pour rejeter le PC dans l’opposition, à plus forte raison pour l’exclure du processus électoral ! On peut dire que l’adoption récente d’un document commun signé par la Junte démocratique et par la Convergence démocratique entérine l’irréalisme de cette perspective, l’incapacité pour les partisans de l’ouverture au sein de l’ancien régime d’arracher un PS encore débile à l’attraction d’un PC qui est de loin la principale force d’opposition.
3. Il appelle au gouvernement les représentants de ce que Santiago Carrillo appelle la « droite évolutive ». C’est l’hypothèse la plus vraisemblable. Du moins le principal intéressé, Fraga Iribarne, chef de file de la tendance, ancien ministre de l’Information, et jusqu’à ces derniers jours ambassadeur à Londres, semble y croire puisqu’il a de lui-même abandonné son poste pour se trouver sur place à Madrid. Mais cette solution, si elle permet temporairement d’élargir les bases du régime et de restaurer en partie la confiance de la bourgeoisie, ne fait que retarder les problèmes sans les résoudre. Elle donne l’illusion de l’ouverture… Le gouvernement se retrouvera confronté aux mêmes choix que Juan Carlos : accepter l’amnistie et les élections au risque d’être débordé à droite et à gauche ; ou n’offrir que des concessions de pure forme et courir le risque d’un affrontement social ouvert, d’autant plus violent que la désillusion succéderait aux espérances entretenues par la mort du dictateur. Le flou et les incertitudes d’une telle entreprise apparaissent clairement dans une interview récente accordée par Fraga en personne. À la question « Avec quelles forces seriez-vous prêt à collaborer », il répond : « Je suis disposé à collaborer avec les forces politiques qui vont de concert avec le mouvement, y compris avec celles qui veulent s’auto-exclure avec la gauche. Avec l’intention en quelque sorte de réaliser un pacte historique de compromis qui finira par se cristalliser en un programme minimum commun, programme que, pour simplifier, je présenterai ainsi : réforme de tout ce qu’il est nécessaire de réformer, utilisation de la voie légale pour le faire, accomplissement d’une évolution démocratique très précise et concrète vers des libertés civiles dans des délais “déterminés”, qui soient réalistes, sans précipitation, et sans incursion du Parti communiste dans l’opération. » On ne peut pas dire que tout cela soit très clair, ni très franc : on parle de délais « déterminés » qui excluent la « précipitation » ; comprenne qui pourra. Une chose est certaine : l’engagement à respecter la légalité héritée du franquisme et l’exclusion du PCE. Autrement dit, le projet se ramène dans ses grandes lignes à l’hypothèse précédente et en répète les contradictions.
Leur dernier recours
Ces contradictions, si elles traînent, peuvent vite devenir explosives. Tous ceux qui refusent le renversement révolutionnaire de la dictature, qui refusent d’en appeler à l’action des masses pour briser le cercle vicieux, s’en remettent à l’armée comme ultime arbitre.
C’est le cas de Don Juan, père de Juan Carlos, comte de Barcelone dont le programme constate : les forces armées sont « depuis notre guerre le véritable pouvoir. Son général en chef, concentre en sa personne depuis lors la souveraineté nationale. Aussi, à sa mort ou incapacité, l’héritage de cette souveraineté par une oligarchie ou par un individu tout puissant ne sera viable que si les militaires soutiennent l’opération. D’eux dépendra aussi le moment où enfin le peuple espagnol assumera sa souveraineté ». C’était le cas de Dionosio Ridruejo ancien de la Phalange, créateur de son hymne, fondateur de l’Union social-démocrate espagnole, groupe lié à la social-démocratie allemande et au PPD portugais, qui déclarait dans une interview récente, peu avant de mourir : « Franco est mort, c’est l’armée qui prendra le pouvoir, car c’est elle en dernier ressort qui le possède puisqu’elle peut le conserver ou le concéder. Le problème est de savoir comment l’armée rendra le pouvoir à son propriétaire légitime, au peuple espagnol, mobilisé par le suffrage universel… » C’est aussi le cas du PCE qui, dans sa proclamation, « demande » aux militaires « une neutralité active, c’est-à-dire un appui à l’opposition civile et non un coup d’État… ».
Le hic, c’est que cette armée n’est plus coulée d’un même bloc, que ses cadres ne sont plus majoritairement issus de la guerre civile. Les jeunes étudiants et travailleurs qui combattent le régime sur leurs lieux d’études et de travail, se retrouvent au coude à coude dans les casernes. L’insubordination menace, malgré une répression sauvage qui se veut dissuasive. Quelques comités de soldats sont même apparus au Pays basque ; on en a annoncé au Sahara. Plus généralement, il n’est pas exceptionnel de voir les enceintes intérieures des casernes se couvrir d’inscriptions nocturnes.
Dans un contexte où la classe ouvrière rassemble ses forces, où elle se sait assez puissante pour refuser de patienter trop longtemps encore, ces brèches dans la citadelle militaire sont comparables aux petites fuites qui finissent parfois par emporter les robustes digues de Hollande.
Le fait accompli
Tout le monde en Espagne sait que la mort du dictateur annonce le changement inéluctable. Juan Carlos peut gagner quelques semaines, quelques mois peut-être, mais les échéances sont inéluctables.
Il faut les préparer en parlant clair dès aujourd’hui. D’autant plus que la droite traditionnelle, celle de la phalange, est affaiblie mais pas décomposée au point où l’était la droite portugaise à la veille du 25 avril. Il y a encore en Espagne des gens nourris de l’idéologie de la guerre civile prêts à vendre chèrement leurs places et leurs privilèges.
Les tergiversations, les atermoiements ne peuvent que les encourager tout en semant le doute dans les rangs de la classe ouvrière. Nous avons déjà exposé dans Rouge n° 319 et 321) en quoi la politique du PC et du PS espagnols nous semble faite de reculades, de concessions qui annoncent de plus graves capitulations.
Pourtant, le Parti communiste, craignant d’être laissé pour compte dans le cadre d’une démocratisation limitée, n’a pas ménagé ses rodomontades. En octobre, lors d’une conférence de presse à Paris, Santiago Carrillo déclarait : « Que fera la junte si Juan Carlos prend la succession ? Il y aura le peuple dans la rue pour exiger l’amnistie et la libération des emprisonnés. Il arrivera aussi que les travailleurs reprendront en main les syndicats. Il arrivera que les partis politiques ressurgiront à la surface sans attendre l’autorisation d’un décret ou d’une loi. Le Parti communiste est prêt à ouvrir des sièges partout […]. Le problème démocratique va être posé dans la rue, dans la vie réelle, et personne ne pourra s’y opposer. » Le moment est donc venu de passer des paroles aux actes. En effet, les propos de Carrillo ne relevaient pas d’une improvisation individuelle. La proclamation déjà citée du PCE tient le même langage : « Avec ou sans la permission de Juan Carlos, les partis de l’opposition se montreront au grand jour, mobiliseront les masses et descendront dans la rue pour exiger un gouvernement provisoire démocratique qui restitue la souveraineté au peuple ».
Ce gouvernement, s’il doit être d’ample coalition avec la « droite civilisée », ne dit rien qui vaille. Mais avant d’en venir là, il faut prendre le PCE au mot et montrer du même coup son irresponsabilité. Ou bien ses propos ne sont que de creuses fanfaronnades et préparent d’amères déceptions aux travailleurs qui les prendraient au sérieux… ou bien ils sont sincères et dans ce cas le PCE lui-même manque totalement de sérieux : on ne peut appeler les masses à créer un fait accompli démocratique sans en envisager toutes les conséquences, sans tenir compte des réponses possibles de la droite « non civilisée » (pour parler comme Carrillo), sans préparer les travailleurs à toutes les éventualités, y compris et surtout l’affrontement violent pour le renversement effectif de la dictature.
Il y a des années maintenant que le PCE brandit la perspective toujours lointaine de la « grève nationale » pour en finir avec le régime. Plus nuancée, la plate-forme de la Junte démocratique annonçait une « action démocratique nationale » qu’elle lancerait « au moment opportun, convaincue qu’elle est que la liberté ne sera pas offerte gratuitement au peuple espagnol et qu’il devra lutter pour la conquérir ». Quant au Parti socialiste (PSOE), il justifiait il y a un an son refus d’adhérer à la junte, en lui reprochant sa tiédeur : « Les grèves multiples et importantes et les mouvements de protestation qui se produisent en tout point du pays, démontrent que les prémices nécessaires à la préparation de la grève générale politique existent déjà. La réunion de ces luttes en un seul canal, voilà le point qui nous sépare. »
Et maintenant ?
Trêve de finasseries et de faux-fuyants. Juan Carlos et les siens, acculés, ne lâcheront du lest que pour tenter de sauver l’essentiel du régime dictatorial dont ils héritent.
Au PC nous disons qu’il faut appeler un chat un chat : s’il faut arracher les droits démocratiques et les revendications ouvrières par les grands moyens – et il le faudra – parlons franchement de la grève générale qu’il faut préparer pour jeter bas le régime et non de la grève nationale ou d’action démocratique qui laissent planer le doute et l’incertitude. Au PSOE nous disons : si les conditions d’une grève générale politique étaient mûres il y a un an, elles le sont d’autant plus aujourd’hui, à l’heure de la mort du dictateur et après les cinq grèves générales d’Euskadi qui ont montré la voie. Le moment est venu de régler les vieux comptes.
P.-S. : Dans les précédents numéros de Rouge, nous avons abordé de façon plus détaillée la crise du régime franquiste (Rouge n° 320), l’alternative démocratique du PC et du PSOE (Rouge n° 319 et n° 321), la question nationale (Rouge n° 322). Dans un prochain numéro, nous consacrerons un article à la situation et aux perspectives de l’extrême gauche dans l’après-franquisme.
19 novembre 1975
www.danielbensaid.org