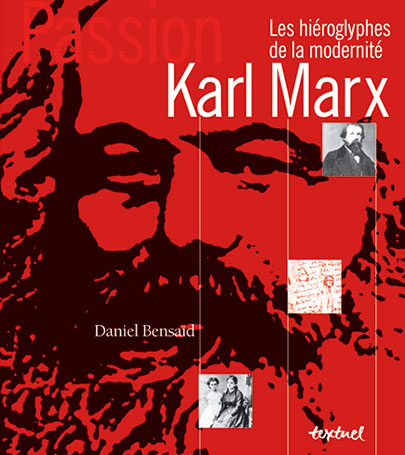
Cet ouvrage1 ne vise pas à entretenir une légende dorée. Il n’entend pas davantage réduire Marx à une psychologie de bazar, ni chercher dans les frustrations domestiques les ressorts de son action. Il prétend plutôt contribuer à le délivrer des statues de plâtre au regard vide et du culte qui trop longtemps l’ont tenu captif.
L’utilisation de la correspondance, amicale ou familiale, permet de croiser les fils biographiques et théoriques, de suivre une pensée en mouvement avec son temps, d’entrer dans l’intimité des épreuves matérielles, d’éclairer les conditions quotidiennes d’un combat et les contrastes d’une personnalité : ses émotions et ses passions, ses audaces souvent, son conformisme parfois, ses jeux d’ombre et de lumière. Elle donne accès à une tragicomédie humaine où le Marx-Jupiter de l’iconographie stalinienne s’efface au profit du visage familier du « Maure », d’« Old Nick », ou encore de « Machine-à-vapeur » (Steam-Engine), selon qu’il signe de ces surnoms les lettres à ses filles ou à ses amis politiques. Engels devient, de même, le « Général », compagnon bon vivant et alter ego facétieux ; Jennychen Marx-Longuet, la fille aînée, « l’Empereur de Chine » ou « Que-Que » ; Laura Marx-Lafargue, la deuxième fille, « Kakadou » ou « Lolo » ; Eleanor, la cadette, « Hottentot » ou « Tussy ».
Il ne s’agit donc ici ni d’un hommage pieux, ni d’un éternel retour à l’authenticité originelle d’une œuvre défigurée par les « ismes » des orthodoxies d’État ou de parti, mais de mettre en scène l’esprit critique d’une époque, en insistant sur les résonances entre la globalisation d’hier et celle d’aujourd’hui. Comme l’écrit Jacques Derrida, on peut penser notre présent avec ou contre Marx, mais certainement pas sans lui : « Pas sans Marx, pas d’avenir sans Marx. Sans la mémoire et sans l’héritage de Marx, de son génie, de l’un au moins de ses esprits. Car ce sera notre hypothèse ou plutôt notre parti pris : il y en a plus d’un et il doit y en avoir plus d’un2. »
Nous partageons ce parti pris. C’est pourquoi « ce sera toujours une faute de ne pas lire et relire et discuter Marx ». C’est aussi pourquoi son spectre continue à hanter l’âge du capital et de ses fétiches.
En 1849, les tracasseries policières et les tribulations de l’exil ont conduit Marx à Londres, capitale de l’Empire, où se noue l’intrigue de la modernité. Il y a passé, jusqu’à sa mort en 1883, les trente années sans doute les plus fécondes de sa vie intellectuelle.
Témoin privilégié de l’impétueuse vitalité du capital avide de nouveaux profits et de nouveaux espaces, il a alors sous les yeux une première grande poussée de ce que nous appelons aujourd’hui mondialisation ou globalisation. L’essor du chemin de fer et de la navigation à vapeur, le maillage de la « toile » télégraphique, sont l’équivalent pour l’époque de la révolution contemporaine de l’informatique et des télécommunications. La formation des grandes compagnies de chemin de fer, le développement du commerce et des grands magasins, la concentration industrielle et urbaine, la modernisation du crédit, l’apparition de l’agence Reuter ou de l’agence Cook participent de ce dynamisme. La spéculation sur les actions des compagnies ferroviaires préfigure celle sur les valeurs de la net-économie, avec son cortège de scandales, d’affairisme véreux, d’aventuriers sans scrupule, de parvenus et de ruffians, de krachs boursiers et de faillites retentissantes.
Marx ne se contente pas de décrire cette frénésie du gain et ce déchaînement du « calcul égoïste ». Il en cherche les raisons. Non dans la cruauté, parfois bien réelle, des individus, mais dans la logique impersonnelle des rapports marchands. Les commentateurs superficiels de la mondialisation se contentent souvent d’explications parfaitement circulaires et tautologiques : l’accélération s’expliquerait… par la vitesse ; et la globalisation…, par une vertu globalisante de la finance, aussi peu éclairante que la fameuse vertu dormitive de l’opium.
Par une simple inversion de termes, ce qu’il s’agit d’expliquer se transforme ainsi en facteur explicatif qui n’explique rien. Les hiéroglyphes de la modernité demeurent aussi impénétrables. Marx cherche au contraire dans le rapport entre l’accumulation du capital et son environnement le ressort de sa prodigieuse vitalité. Pour échapper aux limites qu’il porte en lui-même et aux crises qui le menacent d’embolie, le capital doit sans cesse dilater son espace d’opération et accélérer la ronde infernale des métamorphoses d’où jaillit le profit nécessaire au recommencement de ses cycles. Comme l’errance sans fin du Hollandais volant, la fuite en avant perpétuelle dans le temps et dans l’espace est, sous peine d’arrêt cardiaque et de folie, sa malédiction : « La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner en permanence les moyens de production3. »
Tel est bien, dès le siècle passé, le ressort caché de la mondialisation. La grande industrie a créé le marché mondial. Le marché mondial a « accéléré le développement du commerce, de la navigation, des voies de communication » : « Cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux traditionnels et figés, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui était stable et solide part en fumée. Tout ce qui était sacré est profané. Et les hommes sont enfin forcés d’envisager leurs conditions d’existence avec des yeux désabusés4. »
Rompre le charme du capital, briser les sortilèges de la marchandise, désensorceler l’humanité asservie. Telle est bien l’entreprise prométhéenne de Marx : ce désabusement et ce désenchantement sont aussi le déniaisement qui permet de regarder la réalité en face pour pouvoir changer le monde.
Il existe bien une parenté, soulignée par Walter Benjamin ou par Siegfried Kracauer, entre le flâneur baudelairien et le détective, la démarche de Marx est tout autre. Marx n’a rien d’un flâneur romantique. Installé au cœur de la féerie marchande, somptueusement illustrée par les deux grandes expositions universelles de 1851 et 1862, il ne déambule guère dans la ville pour y déchiffrer les « signes de la rue ». Pour s’attaquer aux mythes de la modernité, comme le fera avec succès Roland Barthes, il faut commencer par traverser les apparences et par percer les secrets les plus profonds de ce monde fantastique.
En 1851, à peine débarqué pour un exil qu’il croit encore provisoire, accablé par la précarité matérielle de sa situation, à l’affût d’une reprise révolutionnaire en Europe, Marx semble se désintéresser de la « Grande Exposition de toutes les nations » dont le Crystal Palace symbolise l’apothéose victorienne. Mais en 1862, il refuse la proposition de couvrir la nouvelle exposition comme correspondant de presse. Alors qu’il suit au British Muséum des cours sur l’histoire des techniques, il semble se désintéresser de cette grande messe technologique à laquelle on se presse du monde entier.
Sorte de « profileur » avant l’heure, il est trop occupé à percer le secret de son ennemi irréductible (son Moriarty5 en quelque sorte), et à pénétrer pour cela la logique intime du Capital, social killer anonyme. Si la main invisible du marché ne laisse ni empreintes digitales ni empreintes génétiques, elle n’en tue pas moins à tour de bras. Quelle est donc cette logique du capital ? Quelles sont les raisons des déraisons modernes ? Davantage qu’à la surface illusoire des choses, dans l’éclairage fascinant des vitrines ou dans le luxe racoleur des passages, la clef de cette rationalité déconcertante se trouve dans les rapports de fabrique, dans les « notes bleues » du gouvernement britannique, dans les statistiques indigestes, dans les rayonnages des bibliothèques. C’est là qu’en enquêteur méthodique il va patiemment accumuler les faits, chercher les indices, défricher les pistes.
Au cours de cette seconde moitié du XIXe siècle, le crime émerge comme un thème majeur de la littérature contemporaine. L’heure est aux énigmes policières et aux fantasmagories urbaines, aux mystères de la grande ville et aux labyrinthes marchands des grands magasins. C’est alors aussi que la police se professionnalise, que l’anthropométrie progresse avec la photographie, qu’apparaissent les limiers impitoyables de l’agence Pinkerton. Archétype de la detectiv novel, Le Capital de Marx peut parfaitement être lu comme, comme une passionnante enquête sur les lieux, l’arme et les mobiles du crime ; comme l’élucidation dialectique, à la manière des déductions logiques du chevalier Dupin d’Edgar Poë ou du Sherlock Holmes de Conan Doyle des mystères du capital : un crime a été commis ; on a volé la plus-value ; et le butin passe de main en main, se partage entre truands, receleurs, blanchisseurs d’argent sale, jusqu’à en oublier l’origine…
En 1843, âgé de 25 ans, le jeune docteur Marx avait cru que la philosophie en avait fini avec la critique de la religion. Il découvrit ensuite que la société rechutait dans une religiosité inédite, « une religion de la vie quotidienne », pleine de miracles séculiers et de mystères profanes. Prométhée reste enchaîné, à la seule différence que ses chaînes sont désormais dénudées, dures et glaciales, sans les ornements et les consolations de naguère.
Les créations d’une humanité qui produit et reproduit ses propres conditions d’existence se retournent et s’opposent soudain à elle comme des puissances étrangères et hostiles. Les prodiges du travail humain et de l’intelligence socialisée, l’électricité hier, l’ordinateur aujourd’hui, apparaissent comme des puissances fétichisées de la Science de la Technique. Les « lois de l’économie » semblent alors aussi implacables que les décrets de l’antique providence divine. Chassée des nimbes célestes, la fatalité descend sur terre perpétuer les vieilles servitudes.
« Personnifiées dans le capital », les conditions de productions subissent « une mystification qui transforme les rapports sociaux en propriété de la chose elle-même ». L’économie, l’argent, la marchandise deviennent des puissances autonomes. Les êtres humains réellement existants sont dominés par les abstractions tyranniques de l’Histoire, du Progrès, ou de l’Humanité majuscules. Véritable « dieu parmi les marchandises », l’argent est investi de pouvoirs surnaturels : il représente « l’existence céleste » des marchandises qui représentent en retour son existence terrestre.
Il en résulte un « univers magique » qui « fait du capital un être fort mystique ». Dans ce monde « enchanté et inversé », les objets semblent animés de puissances occultes et la production de l’information, sans cesse accélérée, que ce soit par le télégraphe et la rotative ou par le satellite et par Internet, sécrète plus de mythes en quelques jours que l’imaginaire religieux n’en fabriquait naguère en un siècle. Cette représentation mystifiée trouve « sa forme la plus aliénée » dans le crédit et le capital porteur d’intérêts qui prend aujourd’hui toute sa dimension avec la multiplication boursière des pains que représentent des retours sur investissement de 15 % pour une croissance productive annuelle de 3 %, ou avec la pêche miraculeuse des dividendes. Tout se passe comme si l’argent s’engrossait lui-même, par une sorte d’immaculée conception, et se multipliait sans passer par les vicissitudes prosaïques de la production et de la circulation où se noue pourtant le mystère de la valeur qui se valorise.
Pour Marx, le mauvais génie maléfique de la modernité n’est pas l’argent – l’argent maudit depuis les deniers de Judas par la morale chrétienne, l’argent vilipendé par Zola ou Péguy comme la forme par excellence de la tentation et du péché –, mais le capital, vampire insatiable, gorgé de travail vivant extorqué. À l’époque moderne, l’argent n’est plus que sa forme monétaire, parmi d’autres formes : celle, industrielle, des moyens de production, ou celle, commerciale, des marchandises attendant à l’étalage l’acheteur qui, à l’instar du prince charmant, les réveillera de leur somnolence morbide pour leur permettre de retourner à nouveau à leur forme monétaire initiale.
La valeur fait ainsi « de chaque produit du travail un hiéroglyphe » social dont il faut apprendre à « déchiffrer le sens ». La solution de l’énigme moderne commence donc par l’explication du « caractère mystique de la marchandise ». Choses ordinaires, qui tombent sous le sens lorsqu’on y prend ses repas ou lorsqu’on s’assoit dessus, la table et la chaise deviennent en effet, en tant que marchandises, aussi surprenantes que les balais automates de l’apprenti sorcier : elles se « dressent pour ainsi dire sur leur tête de bois en face des autres marchandises et se livrent à des caprices aussi bizarres que si elles se mettaient à danser ».
« Une noix ? Qu’y a-t-il à l’intérieur d’une noix ? », chantait Charles Trénet ?
Et à l’intérieur d’une marchandise ?
Le premier geste démystificateur de Marx dans Le Capital consiste à ouvrir cette chose banale et déconcertante pour en faire surgir, comme d’un chapeau magique, tout un cortège de couples contradictoires, travail concret et travail abstrait, valeur d’usage et valeur d’échange, capital constant et capital variable, capital fixe et capital circulant.
La marchandise dévoile ses tours de magie.
Un monde extraordinaire était caché dedans !
Contrairement au dicton qui veut que le commerce comme la musique adoucisse les mœurs, le grand chambardement de la mondialisation n’a rien de pacifique. Au début du XIXe siècle, les États européens et les États-Unis contrôlaient environ 35 % de la surface terrestre. En 1878, ils en contrôlaient plus des deux tiers. Le développement d’une économie mondiale allait de pair avec l’hégémonie d’un empire mondial. L’esclavage aux Amériques n’était pas le vestige d’une époque révolue, mais l’envers des bacchanales victoriennes : la condition du sacre du Roi Coton et de la prospérité industrielle britannique.
Il faut une forte dose d’optimisme ou d’aveuglement pour parler, comme l’ont fait nombre de manuels scolaires, d’un siècle de pax britannica, de 1815 à 1914. La globalisation d’hier fut une mondialisation armée jusqu’aux dents comme celle d’aujourd’hui est armée jusqu’aux étoiles. Les guerres coloniales impitoyables, les horreurs de la conquête de l’Algérie et les holocaustes de l’Angleterre victorienne6 furent aussi barbares que les génocides récents. Ces massacres, telles les guerres de Crimée et de Sécession où s’expérimenta ce qu’Engels appelait déjà « l’industrie du massacre », n’étaient pas des excès ou des bavures de la civilisation, mais la face cachée de la course planétaire à l’enrichissement au détriment des besoins du plus grand nombre.
Tels sont bien les secrets révélés des merveilles et des prodiges de la modernité, de son remue-ménage ininterrompu, de l’incertitude et de l’agitation croissantes, de l’autodestruction novatrice, de la désacralisation du monde, porteurs à la fois, de manière indissociable, de libération potentielle et de souffrance prosaïque réelle.
Il n’y a dans ce constat aucune nostalgie du paradis perdu, aucun deuil des anges auréolés et des autels nimbés d’un halo de lumière divine. Il n’y a pas, chez Marx, la moindre nostalgie du temps passé, des ruines médiévales, des « princes d’Aquitaine à la tour abolie » ; pas le moindre regret romantique du « dernier Abencérage », ni de rêverie mélancolique les « soirs de demi-brume à Londres ». Pour Herbert Marcuse, confronté aux déchaînements de la raison instrumentale du XXe siècle, Prométhée est devenu le symbole des performances productivistes et des dégâts du progrès. Conscient des ambivalences du progrès, Marx n’oppose pas pour autant l’optimisme de la volonté au pessimisme de l’intelligence. Il entend au contraire allier Orphée et Prométhée au service de l’émancipation humaine. Si Le Capital est une enquête policière, il est aussi – son auteur le revendique comme tel – une œuvre esthétique, dont la poésie n’est pas celle des apparences, mais celle des profondeurs et des choses cachées : une esthétique de la logique et du concept.
Tirant pas à pas les enseignements d’une histoire dont il est aussi l’acteur insoumis et rebelle, perçant à jour l’esprit d’une époque sans esprit, déchiffrant jusqu’à l’épuisement physique le parchemin de la grande pyramide du capital, Marx poursuit ainsi « le rêve vers l’avant » d’une autocréation profane de l’humanité.
Ce corps à corps, théorique et pratique, d’un homme avec son époque ne s’est pas déroulé dans un théâtre d’ombres ou d’idées pures, mais dans un combat obscur et acharné, fait de misères charnelles et morales, de tragédies privées et d’épreuves publiques. Œuvre d’une vie, que Marx a portée en lui pendant un quart de siècle, Le Capital l’a dévoré de l’intérieur. Il a ruiné sa santé et épuisé ses formidables énergies.
« On avait rarement écrit sur l’argent en étant aussi démuni », constatait Marx ironiquement. Il espérait en retour que la bourgeoisie se souviendrait longtemps des furoncles qui avaient tourmenté ses nuits insomniaques.
Pour s’atteler à une telle tâche, il fallut, en effet, une personnalité hors du commun. Jeune bachelier, Karl apparut, aux yeux de son père Heinrich, habité de « forces démoniaques », comme un personnage faustien dont « deux âmes sont logées dans la poitrine ». Héros shakespearien tout autant, le fils prodigue se confronta au spectre de ce père, auquel il écrivait : « Je ne pourrai pas me débarrasser du spectre qui me hante jusqu’à ce que je me trouve en votre chère présence. »
Le père étant mort sans que se soit produite la réconciliation espérée, il découvrit un autre spectre à sa mesure, un spectre libérateur qui, à l’instar d’antiques hérésies ou à la manière d’une vieille taupe fouisseuse, minait les fondations de l’empire. Un spectre qui hantait déjà l’Europe, et qui, depuis, hante le monde.
© Éditions Textuel, 2001, danielbensaid.org
Documents joints
- Daniel Bensaïd, Les Hiéroglyphes de la modernité, éditions Textuel, collection Passion, livre illustré, 2001.
- Jacques Derrida, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993, p. 36.
- Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti communiste, 1848.
- Karl Marx et Friedrich Engels, Ibid.
- Adversaire emblématique et irréductible de Sherlock Holmes dans les romans de Conan Doyle.
- Cf. Mike Davis, Late Victorian Holocausts, Londres, Verso, 2000.