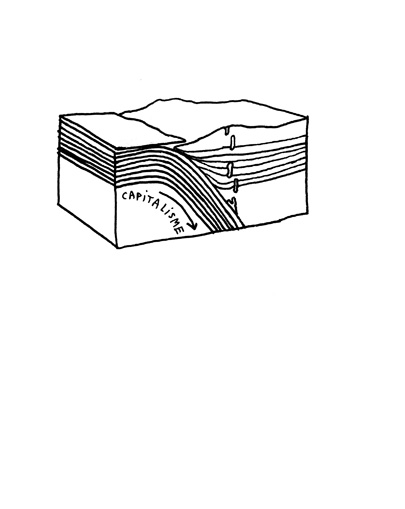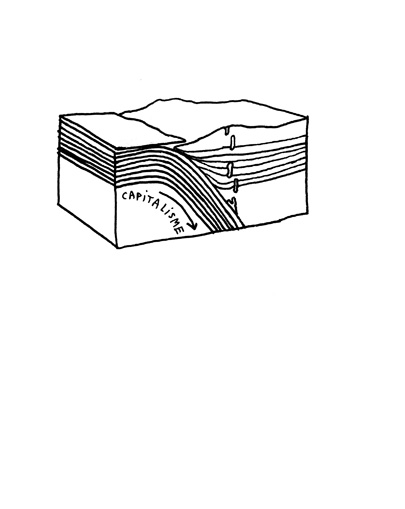
« L’Humanité au-delà du capital » : le thème proposé sans point d’interrogation par les organisateurs de ce IIIe congrès Marx international pour cette séance de clôture comporte trois présupposés optimistes : qu’il existe d’ores et déjà une Humanité singulière et majuscule ; qu’il y aura un au-delà du capital ; que cet au-delà ne sera pas aussi un au-delà de l’humain, contrairement à ce que les tendances à l’autodestruction de l’espèce peuvent faire redouter.
Ces présupposés sont à mettre à l’épreuve du malaise grandissant dans la mondialisation et de l’ensauvagement du monde, dont les attentats du 11-Septembre et la guerre illimitée au terrorisme, décrétée par G.W. Bush dans son discours du 20 septembre, constituent les derniers développements.
Médiatiquement et symboliquement, l’attaque suicide contre le Pentagone et le World Trade Center apparaît comme le jour J du nouveau siècle, un événement pur qui défie toute interprétation. Or, l’événement absolu n’existe qu’en théologie, sous forme du miracle. En histoire et en politique, « les événements ne sont jamais absolus ». Ainsi, écrivait Balzac dans César Birotteau, « les accidents commerciaux que surmontent les têtes fortes deviennent d’irrémédiables catastrophes pour les petits esprits ». Si les bombes volantes qui se sont abattues sur les Twin Towers sont bien venues du ciel, elles n’ont pas surgi du néant. Depuis la fin de la « guerre froide », le monde, contrairement aux promesses de George Bush senior, n’a connu qu’une longue décennie de guerres chaudes, du Golfe à l’Afghanistan, en passant par les Balkans et par l’Afrique des grands lacs. Dès le 2 août 1990, avant même la crise du Koweït, les dirigeants états-uniens tentaient de tirer les conséquences de la nouvelle situation en annonçant à Aspen une réorientation de leur dispositif stratégique : la maîtrise aérienne devenait prioritaire par rapport à la Navy ; la priorité passait de la course atomique avec le camp dit socialiste aux forces de déploiement rapide et aux missions de maintien de l’ordre dans les turbulences du Sud.
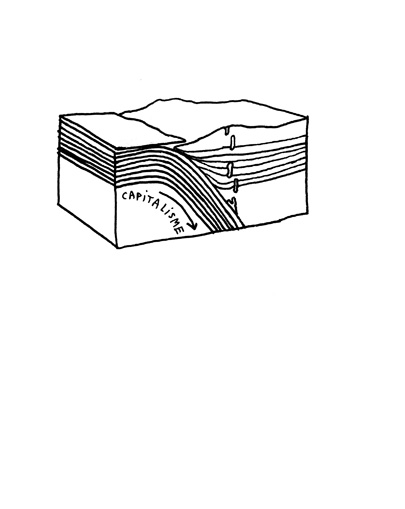 La démence du fétiche
La démence du fétiche
En ce début de siècle ténébreux, les vaches ne sont pas seules à devenir folles. Le sentiment de déraison qui s’empare de l’époque prend sa source dans les délires du capital lui-même. Confronté à la récession américaine de 1857, Marx avait senti souffler ce vent de folie né des tendances schizoïdes du capital : « Dans sa fixation suprême, l’argent redevient lui-même marchandise et ne se différencie, en tant que tel, des autres marchandises que parce qu’il exprime plus parfaitement la valeur d’échange, mais c’est justement pour cela qu’il perd en tant qu’argent sa détermination immanente de valeur d’échange et devient simple valeur d’usage, même si c’est une valeur d’usage servant à fixer les prix, etc., des marchandises. Les déterminations coïncident encore immédiatement, en même temps que, tout aussi immédiatement, elles se dissocient. Lorsqu’elles se comportent de manière autonome l’une par rapport à l’autre, et de manière positive comme dans la marchandise qui devient objet de la consommation, celle-ci cesse d’être un moment du procès économique ; lorsque c’est de manière négative, comme dans l’argent, elle devient folie ; mais la folie comme moment de l’économie déterminant la vie des peuples. »
Cette folie qui détermine plus que jamais la vie des peuples l’enracine dans le divorce entre valeur d’usage et valeur d’échange, entre travail concret et travail abstrait, entre production et reproduction, entre socialisation accrue du travail et privatisation de la propriété. L’« actionnariat salarié » reproduit ce dédoublement généralisé : le travailleur devra-t-il aller en tant qu’actionnaire jusqu’à se licencier comme salarié pour satisfaire en lui l’homme égoïste privé ?
La double vie de la marchandise comme celle de l’homme moderne porte donc en elle le risque permanent de la scission : « cette double existence distincte doit nécessairement progresser jusqu’à la différence, la différence jusqu’à l’opposition et la contradiction […] entre la nature particulière de la marchandise en tant que produit et sa nature universelle en tant que valeur d’échange ». Dès lors que la production et la circulation, l’achat et la vente ont acquis « des formes d’existence spatialement et temporellement distinctes l’une de l’autre, indifférentes l’une à l’autre, leur identité immédiate cesse ». Et la crise manifeste au grand jour ce malaise identitaire. Elle manifeste « l’unité des moments promus à l’autonomie les uns par rapport aux autres. […] elle n’est rien d’autre que la mise en œuvre violente de l’unité des phases du procès de production qui se sont autonomisées l’une vis-à-vis de l’autre ». L’unité est donc rétablie par la violence. C’est bien là le secret de « violences structurelles » qui ravagent le meilleur des mondes marchands, dont les violences armées sont l’expression extrême et spectaculaire.
Inscrite dans cette perspective, la crise actuelle n’est pas seulement une crise économique du cycle industriel, c’est une crise « politique et morale » (aurait dit Renan), une crise de civilisation inhérente aux contradictions de la loi de valeur. Ainsi que Marx l’avait prévu, la réduction de toute chose et du rapport social lui-même au temps de travail abstrait est devenue de plus en plus misérable et irrationnelle au fur et à mesure de la socialisation accrue du travail et de l’incorporation d’une part croissante de travail intellectuel dans le procès de travail. Cette crise se traduit aussi bien par les phénomènes d’exclusion et de chômage massifs (au lieu que les gains de productivité profitent à l’épanouissement de tous), que par l’incapacité du marché à organiser sur la longue durée les rapports de l’espèce humaine à ses conditions naturelles de reproduction.
Cette mal-mesure sociale se combine au dérèglement des espaces et des rythmes de la politique sous l’effet de la mondialisation marchande, de la reproduction élargie du capital et de l’accélération endiablée de ses rotations. Le temps de la démocratie est débordé aussi bien par le temps bref de l’urgence et de l’arbitrage instantané des marchés, que par le temps long de l’écologie. Les espaces économiques, politiques, juridiques, écologiques sont désaccordés. Les coutures de l’État-nation craquent, les souverainetés territoriales se défont. Le droit interne cède sous la pression d’un droit externe lui-même incertain sans qu’apparaissent les nouvelles échelles de souveraineté populaire et les nouvelles procédures de décision démocratique.
Dans ce passage périlleux entre « déjà-plus » et « pas-encore », l’injustice prospère. L’économie mondialisée, loin d’aboutir à une homogénéisation de la planète, est plus que jamais régie par la loi du développement inégal et mal combiné. Les dominations impérialistes, que d’aucuns prétendaient solubles dans l’espace communicationnel et dans l’universalité des droits de l’homme, sont plus impitoyables et brutales que jamais. Le double mouvement, d’extrême concentration des moyens militaires et de dissémination des violences non étatiques, débouche sur une situation de guerre chronique, ouverte ou larvée, de guerre civile aux contours incertains, dont les « cosmopirates » annoncés par Carl Schmitt sont à la fois le vecteur et le symptôme.
Globalisation des résistances
Après les manifestations de Gênes, faute d’être parvenue à criminaliser le mouvement de résistance à la mondialisation capitaliste ainsi que l’aurait voulu Berlusconi, la rhétorique libérale s’est employée à le disqualifier, ironisant sur ces nouveaux militants ringards qui s’opposeraient à un monde sans frontière et voudraient faire tourner à l’envers la roue de l’histoire. Ainsi est-il devenu courant dans les médias de désigner les manifestants comme des « antimondialistes », voire comme des « souverainistes ». Nous ne nous reconnaissons dans aucun de ces deux épithètes.
Si l’on entend par « souverainisme » une crispation nationaliste sur les États, les frontières, et le pré carré, nous n’avons rien à voir avec ce souverainisme. Il suffit de rappeler que la grande majorité des manifestants de Prague, de Gênes ou de Nice sont en première ligne pour soutenir les sans-papiers contre les lois discriminatoires et le harcèlement policier. En revanche, le souverainisme des puissants se porte bien, qu’il s’agisse de dicter leur loi au commerce mondial, de refuser la ratification des accords de Kyoto, de claquer la porte de Durban. Les gazettes ne parlent plus alors de « souverainisme » mais pudiquement d’unilatéralisme.
Quant à la mondialisation, nous ne sommes pas opposés à la mondialisation tout court, mais à la mondialisation réellement existante, marchande, financière, capitaliste, celle des paradis fiscaux, de l’endettement du tiers-monde, des plans d’ajustement dictés par le FMI (qui ont conduit l’Argentine à la ruine), de la privatisation des services ou de l’accord multilatéral d’investissement. Il s’agit en réalité d’une lutte entre deux mondialisations contraires : leur mondialisation et la nôtre. Il est en effet frappant de constater que les paysans, si souvent présentés comme spontanément corporatistes et bornés à l’horizon de leur village, sont aujourd’hui, à travers une organisation internationale comme Via Campesina, à la pointe du renouveau internationaliste. Plus largement, de même que la mondialisation de l’époque victorienne a contribué à la naissance de la Ire Internationale, les sommets alternatifs de Porto Alegre, de Gênes, de Seattle, loin d’exprimer un repli sur les frontières nationales, tissent des liens planétaires entre mouvements sociaux et nouvelles gauches radicales.
Avec l’extension planétaire du domaine de la lutte, une nouvelle étape commence. Une grande transformation se dessine, où les formes de domination du capital changent sans s’effacer. Les visages possibles de l’humanité future s’esquissent à peine, non plus en position de maîtrise vis-à-vis des conditions naturelles de reproduction, mais dans un agencement systémique de relations sociales complexes, où la notion de métabolisme utilisée par Marx prend tout son sens. La socialisation accrue du savoir et l’incorporation massive du travail intellectuel à la production exigent une métamorphose du travail et une révolution radicale de la mesure sociale permettant d’évaluer les richesses, d’organiser les échanges, de déterminer et de satisfaire les besoins. Les biotechnologies et la génétique permettent pour la première fois de déterminer non seulement le monde dans lequel nous souhaitons vivre, mais l’humanité que nous voulons devenir. Un tel choix est beaucoup trop important pour être délégué à l’arbitrage aveugle des marchés et à la jungle des intérêts privés.
Un au-delà du Capital est bel et bien pensable. Il ne tombe pas du ciel de l’arbitraire utopique, mais se laisse entrevoir dans les contradictions logiques du capital lui-même. Mais cet au-delà est-il encore envisageable selon la catégorie classique du progrès ? Le siècle ténébreux sur lequel nous tournons la page aura mis en évidence la redoutable dialectique du progrès et de la catastrophe, de la civilisation et de la barbarie, si bien perçue déjà par Flaubert dans Salammbô, et si bien exposée par Michaël Löwy dans son commentaire des thèses de Benjamin sur le concept d’histoire.
Nous ne sommes pas nostalgiques du silex et de la lampe à huile. Nous ne récusons pas, bien sûr, le potentiel émancipateur des sciences et des techniques. Ce que nous redoutons et combattons, ce sont précisément les noces barbares de la technique et du marché, des OGM et de Novartis, de la République positiviste et du Medef.
Décider l’indécidable
Il nous revient de décider non seulement s’il y aura une humanité au-delà du capital, et plus précisément si le procès historique d’humanisation peut aboutir à ce que l’humanité comme espèce culturelle rejoigne l’humanité comme espèce biologique, mais aussi laquelle nous voulons devenir. Cette décision ne relève pas d’un caprice ou d’un coup de force décisionniste. Elle est historiquement déterminée et conditionnée. En quoi il s’agit bien d’une décision politique. Or, comme l’avait prévu Hannah Arendt, nous en sommes au moment où la politique risque de disparaître complètement du monde, laminée entre les automatismes marchands et les consolations d’un moralisme compassionnel. C’est ce risque qu’il est désormais urgent de conjurer. Deux grandes questions sont désormais posées, après les défaites et les désillusions d’un siècle enténébré.
La première est de savoir s’il existe un logiciel opposable au logiciel catastrophique des marchés. Car, avant même de rêver ses formes lyriques et institutionnelles, la révolution est d’abord affaire de contenu : de changement de logique sociale. Changer le monde ! Nous en sommes toujours là. D’aucuns pensent que la banqueroute des régimes bureaucratiques nous laisse orphelins d’un modèle. Nous sommes plutôt débarrassés d’un anti-modèle, et, enrichis de ces expériences désastreuses, nous y gagnons la possibilité inestimable de recommencer et d’inventer. Non en imaginant d’autres cités parfaites avec leurs appartements témoins, livrables clés en main, mais en partant de la logique de la chose : de la logique du capital, de déchirures intimes, de ce en quoi il est à lui-même sa propre barrière.
« Le monde n’est pas une marchandise ! Le monde n’est pas à vendre ! » Ces cris poussés à Seattle, à Porto Alegre, ou à Gênes, ont fait le tour du monde. C’est un bon départ. Par le biais du négatif, comme toujours. Mais que veut dire au juste que le monde n’est pas une marchandise : que la terre, l’eau, l’air ne sont pas des marchandises ? Ni la santé alors, ni l’éducation, ni le logement ? Ni le vivant, ni le savoir social ? On voit bien que l’exception au despotisme marchand ne concerne pas que les biens culturels. C’est toute la conception des besoins, de l’individu et du lien social qui sont en cause.
Si nous ne voulons pas que le monde soit une marchandise, il faudra bien en venir à la négation de la négation, et dire ce que nous souhaitons qu’il soit. Non dans le détail, non en réglant à la place de ses acteurs la marche de l’émancipation. Mais en développant la logique de la lutte, une pédagogie du bien public, qui oppose les besoins sociaux à l’intérêt privé, l’appropriation sociale à la confiscation sociale, le droit de détresse dont parlait Hegel au droit du profit.
La seconde grande question est celle de l’échelle politique du monde, de l’agencement des espaces et des temps où puisse s’exercer un contrôle démocratique sur les procès de production et de reproduction sociale. Même si on exagère parfois l’impuissance à laquelle seraient rendus les États-nationaux (le droit international reste pour l’essentiel de l’ordre des traités interétatiques et ce sont bien les gouvernements qui siègent au conseil de l’Union européenne), il n’en demeure pas moins que la constellation conceptuelle de la politique moderne (souverainetés, peuples, nations, frontières) s’estompe et décline. Cette crise entraîne une tendance inquiétante à l’ethnicisation et à la confessionalisation de la politique. La nation citoyenne ne se défait pas au profit de solidarités de classe et de liens internationalistes, mais la plupart du temps de régressions généalogiques vers une légitimité des origines, ou de nouvelles constructions impériales.
La nouvelle rhétorique de la guerre sans fin répond à cette déterritorialisation/reterritorialisation des conflits. Dans la guerre sans fin censée, selon G. Bush et ses alliés, administrer au monde une justice illimitée, le droit se dissout dans la morale, l’ennemi est miniaturisé, bestialisé, ramené au rang d’insecte et de dommage collatéral. Dans cette situation de guerre permanente, il n’y a plus ni de but de guerre définissable, ni de proportion raisonnée entre la fin et les moyens. Si, comme le disait Hegel, l’arme est l’essence des combattants, de quels combattants la faucheuse de marguerites ou la bombe à neutrons sont-elles l’essence, et de quel monde futur les cyber-guerriers sont-ils les hérauts ? Ces questions imposent de mettre un point d’interrogation, et même plusieurs, à l’idée d’une humanité après le capital : la barbarie hélas, est en train de prendre plusieurs longueurs d’avance.
Un dernier mot devant « ce malaise interne à tout ce qui existe ». Moins que jamais la pensée ne peut se résigner au commentaire contemplatif du désordre réellement existant. Plus que jamais, il importe de renouer le lien entre théorie et pratique. Nous pouvons nous réjouir de la débâcle des orthodoxies d’État et de parti, de l’éclosion de ce qu’André Tosel appelle « les mille marxismes ». Nous pouvons profiter pleinement de ce moment de liberté hétérodoxe. Mais à condition de ne pas nous en tenir là. De ne pas en rester à une aimable coexistence académique et pacifique entre ces marxismes. D’en profiter pour fourbir les nouvelles armes de la critique.
Actuel Marx, n° 31, Puf, 2002
www.danielbensaid.org