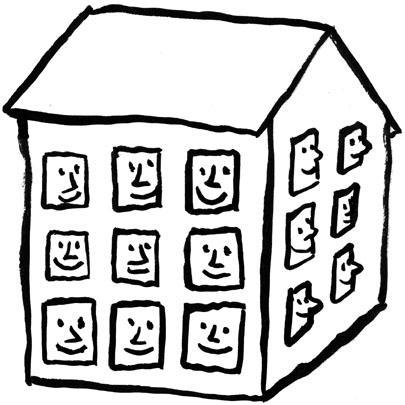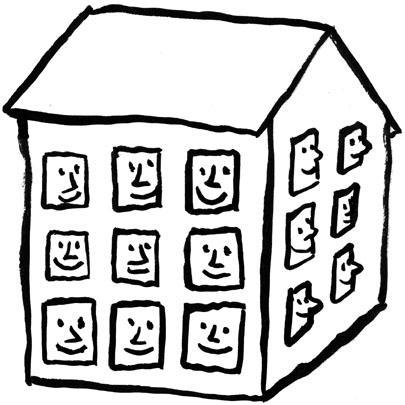
Après 1968, il était presque à la mode d’être révolutionnaire et de partager l’illusion selon laquelle la révolution serait facile (un « dîner de gala »). On exigeait « tout et tout de suite ». Cette conscience heureuse s’expliquait en partie par les trente (« glorieuses ») années de croissance pratiquement ininterrompue depuis la guerre. Aujourd’hui, après les désastres à l’Est, beaucoup se demandent si la révolution et le socialisme sont encore souhaitables. D’autres, convaincus qu’il faut toujours changer le monde, doutent que ce soit encore possible1.
I. Remettre le problème à l’endroit
Nous ne sommes pas orphelins d’un modèle de société. Nous le sommes d’autant moins que les régimes qui se sont effondrés avec le mur de Berlin et la désintégration de l’URSS n’ont jamais été à nos yeux les modèles de quoi que ce soit. La lutte pour l’émancipation humaine ne consiste pas à opposer un modèle à un autre. Elle part de la résistance aux injustices, aux humiliations, au mépris généralisé dans un monde où les 20 % les plus riches accaparent 85 % des richesses, alors que les 20 % les plus pauvres s’en partagent moins de 2 %. Cet ordre planétaire marchand, porteur d’inégalités et de violences, n’est tout simplement pas acceptable.
Le chômage et l’exclusion massifs sont l’illustration éclatante de l’absurdité du système. Les formidables gains de productivité, permettent de produire autant et plus de richesses en cinq fois moins de temps qu’il y a cinquante ans. Ce temps économisé pourrait être consacré à autre chose :
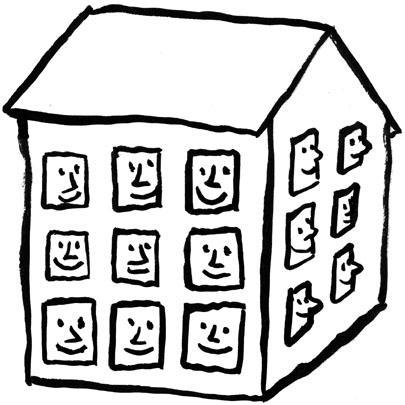 – à une réduction massive du temps de
travail et à une transformation du travail
même, condition d’une participation active
de tous et toutes à la vie de la cité ;
– à une réduction massive du temps de
travail et à une transformation du travail
même, condition d’une participation active
de tous et toutes à la vie de la cité ;
– à satisfaire des besoins sociaux (logement, éducation, santé, culture). Qui et selon quels critères se permet de décider que l’on s’instruit trop et que l’on se soigne trop ? Pourquoi l’achat d’automobiles serait-il bon pour l’économie et les dépenses de santé mauvaises ?
Cette irrationalité croissante de la logique du capital (où la création de 700 000 emplois peut faire chuter la bourse de New York), qui mesure tout et organise la société sur la base de l’échange de temps de travail, témoigne des limites de cette mesure misérable. Dès lors que le travail incorpore davantage de connaissances, de plus en plus complexes, il devient irréductible à un travail abstrait.
– Les ravages sur l’environnement et le pillage insouciant des énergies non renouvelables représentent une autre manifestation de cette irrationalité inhérente à la mesure misérable des rapports sociaux. La recherche effrénée du profit à court terme conduit à ignorer le moyen et le long terme (pollutions diverses, déforestation, recyclage des déchets…). « Après moi le déluge » apparaît comme la devise de la course au profit. Elle détruit la solidarité entre générations si nécessaire à la reproduction de l’espèce. Seule une économie politiquement maîtrisée et contrôlée, intégrant les impératifs de la longue durée, serait à même de satisfaire les principaux besoins sociaux sans dévaster la nature.
– La crise actuelle dure depuis les années soixante-dix sans que les brefs épisodes de reprise ne parviennent à faire reculer le chômage y compris dans les pays riches. Il ne s’agit pas d’un simple problème de rentabilité des entreprises. Les profits se sont redressés sans favoriser pour autant l’investissement productif et la création d’emplois. C’est la spéculation financière qui en a profité. En réalité, cette crise est une crise globale de l’accumulation du capital et de la reproduction des rapports sociaux. La bourgeoisie peut surmonter cette crise, mais ce serait au prix fort pour les exploités et les opprimés. Déjà, sous prétexte de mondialisation, un nouveau partage des territoires et des espaces (économiques, juridiques, communicationnels) est à l’œuvre. Cette grande mutation ne saurait être pacifique. Elle s’accompagne d’ores et déjà de tragédies (Bosnie, Rwanda, Tchétchénie). Loin d’être des guerres « d’un autre âge », elles s’inscrivent logiquement dans cette réorganisation planétaire.
Guerres, chômage et exclusion, périls écologiques annoncent un avenir qui n’en est plus un. Déjà, les illusions du progrès selon lesquelles les futures générations vivraient nécessairement mieux que les précédentes, tendent à s’effriter. Il est plus que jamais nécessaire de changer le monde. Le rôle des révolutionnaires est de faire en sorte que cette nécessité devienne possible.
II. Une autre idée du progrès
En effet, le formidable développement des connaissances et des capacités techniques n’entraîne pas mécaniquement des progrès sociaux et culturels correspondants. Sous le règne du capital, progrès et régression demeurent indissociablement liés. Nous devons donc concevoir des critères de progrès qui ne se réduisent pas aux performances de la grande industrie ou de la « conquête de l’espace ». Au risque de simplifier, nous en retiendrons trois essentiels :
– La réduction massive du temps de travail (rendue possible par les énormes gains de productivité). Elle implique un changement radical du rapport au travail et du contenu du travail lui-même. Cette réduction de la part de vie consacrée à un travail contraint et aliéné, est la première condition du développement démocratique de la société, où tous et toutes auraient les moyens d’exercer pleinement leurs responsabilités et leur contrôle sur les lieux de pouvoir. Elle est aussi la condition du libre épanouissement de tous et de chacun(e). L’admirable diversité des individus constitue en effet une chance à saisir, non pour célébrer l’individualité illusoire et mutilée par l’uniformisation marchande, mais pour développer réellement un individu créatif aux besoins personnels et collectifs de plus en plus riches et diversifiés. Les êtres humains pourraient retrouver ainsi le sens du jeu et les plaisirs du corps aujourd’hui soumis au principe du rendement et à l’hébétude du grand spectacle sportif.
– La qualité des rapports entre l’homme et la femme (et réciproquement) est bien un autre critère de progrès, dans la mesure où il constitue la première expérience simultanée de l’autre (et de la différence entre les sexes) et de l’universalité de l’espèce. Plus généralement, partout où subsisterait un rapport de domination et d’oppression des femmes par les hommes, l’étranger, le métèque, le venu d’ailleurs, l’autre en un mot, serait aussi menacé. Le soutien à la lutte des femmes pour l’égalité des droits, contre les violences, pour le droit à disposer de son corps, s’inscrit dès aujourd’hui perspective.
– Il s’agit d’œuvrer à l’avènement d’une humanité réellement universelle et solidaire, à travers un essor réellement planétaire de la production et de la communication, à travers l’enrichissement de tous par l’apport des différences. L’universalisation marchande soumise aux impératifs du capital reste une universalisation abstraite, contradictoire et mutilée. Sous la dictature du FMI, de la Banque mondiale, et autre OMC (notamment par l’utilisation de la dette), elle nourrit à l’autre bout de la chaîne les paniques identitaires, les replis communautaires, les craintes religieuses, la xénophobie et le racisme en général. L’Internationalisme généreux et solidaire reste au contraire une idée neuve.
III. Quel socialisme voulons-nous ?
Il ne s’agit pas de chercher un modèle de rechange ou de tracer les plans d’une cité parfaite. L’avenir s’invente en marchant, à partir des contradictions réelles de l’ordre existant. Mais tout projet révolutionnaire a sa part de rêve. Il faut rêver pour explorer le champ des possibles.
Imaginer un monde où le travail serait réduit à une demi-journée. Ce qui implique de travailler autrement, d’avoir le temps de se cultiver et de s’éduquer tout au long de sa vie, d’échapper aux spécialisations définitives, de pouvoir être à la fois travailleur, mais aussi poète, peintre et musicien. Il y a aujourd’hui, dans « l’art » professionnalisé une minorité de « professionnels » qui n’ont pas toujours quelque chose à dire, alors que la grande majorité, qui a tant à dire, n’a jamais l’occasion ni les moyens de s’exprimer. La réduction du temps de travail est la condition d’une métamorphose et d’un dépérissement de la division sociale du travail, dans la production comme entre les sexes.
Produire d’abord pour les besoins du plus grand nombre et non pour une course aveugle au profit et aux privilèges : c’est travailler, habiter, vivre autrement. Une telle perspective est inconcevable sans toucher à la sacro-sainte propriété privée des grands moyens de production et de communication. Comment en effet adapter la production aux besoins, ménager sur le long terme l’environnement naturel, coordonner les efforts et libérer la recherche fondamentale de critères immédiats de rentabilité, laissant la concurrence et le marché (ou encore les fameux marchés financiers) décider à court terme dans le dos des citoyens ? Comment prétendre garantir le droit au logement sans remettre en cause la propriété foncière ? Comment, sans s’attaquer au despotisme de l’entreprise, assurer le transfert des gains de productivité dans le développement d’une santé, d’une éducation, non pas étatisées mais socialisées ? En dépit des discours récents sur l’entreprise citoyenne et malgré des droits syndicaux toujours menacés, la réalité de l’entreprise soumise à la loi du profit est le despotisme patronal et non la démocratie. Les polémiques à propos des privatisations et du service public illustrent la question : s’agit-il de rentabiliser à tout prix pour grossir les bénéfices de firmes privées qui en feront ce qui leur chante, hors de tout contrôle de la collectivité, ou de garantir à tous un accès égalitaire à certains biens de base (droit à la nourriture, au logement, à la culture) ? Le droit à l’existence doit l’emporter sur le droit de propriété. Cela n’implique pas une étatisation totale des grands moyens de production et d’échange, mais de donner à la collectivité les moyens de choisir et de contrôler son propre avenir.
– Promouvoir la démocratie la plus large. Qui doit décider ? Les citoyens associés ou les marchés financiers, selon quels critères et quelles priorités ? Le sort de l’humanité ne saurait se jouer à la corbeille !
La démocratie la plus large suppose le temps de s’informer des grands problèmes, le temps de délibérer directement, et les moyens de se prononcer sans s’en remettre à la compétence exclusive des experts. Il s’agit donc de réhabiliter l’idée même de politique et d’étendre la démocratie de la sphère institutionnelle à celle de la production et de la culture, en généralisant l’autogestion et le contrôle des représentants par les représentés. Ce qui suppose la libre confrontation pluraliste des projets et des programmes, avec pleine souveraineté et indépendance des organisations syndicales, associatives, envers les partis, l’extension d’une démocratie non seulement politique, mais sociale et autogestionnaire.
– Développer enfin une solidarité internationale contre tous les esprits étroits de clocher et de chapelle. Se penser et agir comme citoyens du monde, conformément à l’ambition initiale de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Ceci implique notamment une solidarité de tous les jours envers les peuples des pays dépendants et dominés qui ont subi des siècles de pillage et de domination. Ce pillage prend aujourd’hui notamment la forme de la dette. Elle permet aux créanciers d’imposer leurs conditions et leur diktat, de renvoyer les pays dits en voie de développement sur la voie du sous-développement. Dans cette perspective générale, quelle est l’Europe que nous voulons ? Celle de Maastricht, celle des marchandises et de la monnaie, celle des juges et des banquiers joue en réalité contre l’idée même d’une Europe ouverte et fraternelle, d’une Europe sociale et démocratique.
Il ne s’agit là que de pistes qui dessinent les contours d’un avenir différent et vivable. Demain commence en effet dans les luttes d’aujourd’hui. Vous connaissez la formule célèbre de Bertolt Brecht : ceux qui luttent un jour sont bons, ceux qui luttent plusieurs années sont très bons, mais ceux qui luttent toute leur vie sont indispensables. C’est cela aussi le socialisme que nous voulons : faire que le plus grand nombre d’êtres humains deviennent « indispensables ».
Inprecor n° 404, juillet 1996