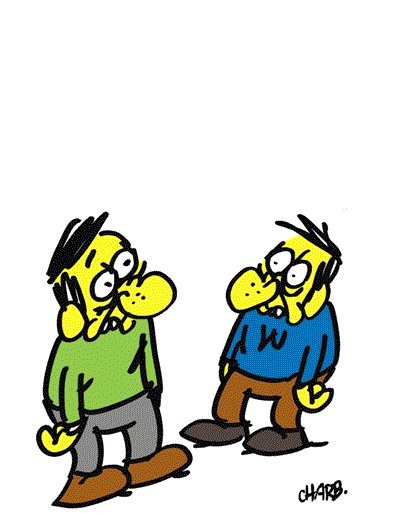
Après les grandes turbulences des années soixante et soixante-dix, les années quatre-vingt, celles de la contre-réforme libérale, ont été marquées par une négation de « la question sociale ». L’heure était à l’économie (de marché) triomphante et à la démocratie (institutionnelle) conquérante.
Depuis trois ans, changement de décor, changement de discours.
Retour du social ? Renaissance des mouvements sociaux ?
Les grandes grèves de novembre-décembre 1995 ont ainsi donné lieu à une furieuse bataille d’interprétation sociologique et politique. Il est pourtant difficile de déchiffrer le sens d’un événement sans l’inscrire dans la durée d’une mémoire collective, sans l’éclairer par les antécédents – lointains, comme la grève générale de Mai 68 ou, plus proches, comme les grèves de 1986 – et par ses effets.
Le sens n’est pas donné dans l’instant. Il se dévoile après coup, en fonction des possibilités retenues et de celles qui auront été abandonnées. Ce choix n’est pas écrit d’avance. Il fait précisément l’objet d’une lutte, dont les interprétations contraires sont partie prenante.
Mouvement social ou pas ?
Un fait de langage retient l’attention. La notion de « mouvement social » est sortie, ces dernières années, du vocabulaire de la sociologie universitaire. Elle s’est propagée dans la presse comme dans la parole des acteurs eux-mêmes à proportion que déclinait l’usage du vocable « mouvement ouvrier ».
Ou plus importante substitution de sens ?
Curieusement, les « sociologues de l’action » se sont empressés de contester le terme de « mouvement social » sous prétexte que la réalité n’était pas conforme au concept par eux dûment déposé1.
« S’agissait-il d’un mouvement social ? », s’interroge ainsi Alain Touraine.
Réponse : « Cette grève a-t-elle favorisé l’expression de revendications qui mettent en cause, au-delà d’intérêts particuliers, si importants soient-ils, l’orientation de la société tout entière, non pas pour défendre une contre-culture utopique, mais au contraire pour en appeler, contre un adversaire, à des orientations culturelles considérées comme essentielles par l’ensemble de la société ? Un mouvement social ainsi défini combine un conflit social et un projet de gestion sociétale. La question étant ainsi précisée, je suis obligé de lui apporter une réponse négative. Non, la grève de novembre-décembre, si importante qu’elle ait été, n’était pas un mouvement social. »
Ce fut donc, simplement, « un grand refus », ou encore « l’ombre d’un mouvement »2. La démarche, furieusement normative, consiste à convoquer le réel devant le « tribunal sociologique » : « Ma définition du mouvement social me conduit à ne pas en reconnaître la présence dans un conflit qui a dénoncé une politique et qui n’est pas allé au-delà du rejet des initiatives gouvernementales3. »
Même son de cloche, plus péremptoire encore, chez Fahrad Khoroskavar : « Pour résumer, on peut dire qu’il s’est agi d’un non-mouvement social, sans projet, sans utopie, sans acteur central, non politique, hétérogène et sans expression propre4… » Grèves et manifestations sont ainsi réduites à de banales « conduites de crise ». Même ton, même approche, même verdict chez Michel Wieviorka : la lutte « a-t-elle exprimé un mouvement social au sens précis, sociologique de l’expression, c’est-à-dire une contestation de haut niveau de projet portée par un acteur identifiable mettant en cause les principales orientations de la vie collective ? N’a-t-elle pas plutôt été avant tout une conduite de crise5… »
Décidément, le tribunal parle d’une seule voix.
Déficit de projet, déficit d’utopie, pas assez « haut niveau ».
Le mouvement de décembre 1995 est recalé à l’unanimité du jury à l’examen de passage des mouvements sociaux. Certains objecteront sans doute avec bon sens qu’à requérir autant de critères, autant de conscience, à exiger de lui un tel niveau, à lui réclamer d’emblée un projet « sociétal » alternatif, le « mouvement social » risque fort de devenir un objet « sociologiquement introuvable ». Il est rare en effet que la conscience précède l’action, qu’un mouvement naisse d’un modèle ou d’une idée, et non pas d’une lutte, d’un conflit d’intérêts. La conscience vient en marchant. N’importe quel promeneur le sait.
D’autres verront là une futile querelle de mots.
Relevons seulement au passage que, pour Touraine, l’affaire au contraire est sérieuse, révélatrice d’une implacable bataille d’écoles : « En fait, deux sociologies s’opposent ici : celle qui croit à l’existence d’une logique implacable des systèmes sociaux et qui déchiffre les conduites des acteurs comme des signes de la logique de domination qui s’y exerce et, de l’autre côté, celui où je me place, celle qui croit aux acteurs et les définit par leurs orientations culturelles et, plus profondément, par la représentation d’eux-mêmes comme sujets autant que par les conflits et les rapports sociaux où ils sont placés6. »
Soit donc une « sociologie [tourainienne] de la liberté » contre une « sociologie [marxienne ou bourdieusienne ?] de la nécessité » : « L’idée même de mouvement social n’est-elle pas entrée dans la sociologie avec celle des acteurs sociaux, en s’opposant au concept de lutte de classe associé à celui de contradictions sociales7. »
Voici enfin le mot de l’énigme, le pot aux roses dévoilé !
L’acharnement à définir le mouvement social, à lui imposer des normes inaccessibles, vise tout simplement à empêcher que sa réalité et sa dynamique ne soient lisibles selon les catégories de contradictions et de classes sociales. Il ne s’agit pas alors, comme le dit Alain Touraine, de deux sociologies qui s’opposent, mais de deux théories, de deux stratégies et de deux politiques.
Si nous constatons au contraire, sans a priori méthodologique, l’usage croissant de l’expression « mouvement social » (dont la sociologie de l’inaction n’a pas le monopole), il exprime plusieurs phénomènes combinés :
1. Tout d’abord, un changement de paysage sociologique. La notion de mouvement ouvrier s’est imposée à une époque précise, celle de la grande industrialisation de la fin du siècle dernier, lorsque le prolétariat industriel est devenu la composante centrale du prolétariat et l’ouvrier d’usine (mineur, cheminot, métallurgiste) sa figure emblématique. Avec le recul, depuis le début des années quatre-vingt, en pourcentage et en effectifs absolus, de ce prolétariat industriel, celui-ci ne constitue plus le point de repère, visible de tous, d’une identité collective. De vastes secteurs salariés et exploités ne se vivent pas comme « ouvriers ».
2. Ensuite, un changement de contexte économique et social. La crise, la montée du chômage et de la précarité, la sous-traitance et la déconcentration des grandes entreprises, les métamorphoses mêmes du travail, l’importance des réseaux, la crise urbaine et scolaire, entraînent un redéploiement de la résistance sociale aux offensives libérales, dans et hors de l’entreprise, sur les terrains du logement, de la santé, de l’école, de l’exclusion. Soulignée par de nombreux observateurs, la massivité des manifestations de rue (la combinaison grève/manifestation), dans les villes moyennes notamment, en novembre-décembre 1995, traduit aussi cette tendance à la socialisation du conflit qui déborde les lieux de production pour embrasser tous les domaines de la reproduction sociale8.
3. Enfin, un changement de rapport entre les luttes sociales et la représentation politique. Alors que, dans les années soixante-dix, grèves et manifestations s’inscrivaient dans une relation explicite aux partis de gauche (Une seule solution, le programme commun !), la notion de mouvement social souligne au contraire une distance et une méfiance envers la sphère politique. Les frustrations du double septennat mitterrandien, et plus généralement l’impuissance de la représentation politique à maîtriser la mondialisation marchande, sont passées par là.
Singulier ou pluriel ?
On parle tantôt du mouvement social, tantôt des mouvements sociaux.
Le débat entre singulier et pluriel est largement un faux débat. Il y a bien, d’un côté, un phénomène général de remobilisation limitée, inégale et combinée, autour d’enjeux sociaux.
D’autre part, cette remobilisation demeure fragmentée, diversifiée, difficile à unifier, pour des raisons profondes tenant à la nature même de la crise.
C’est pourquoi il importe de considérer ces mouvements dans leur potentialité et leur dynamique, plutôt que de s’ériger en juges. C’est pourtant ce que fait quotidiennement le discours libéral lorsqu’il dénonce le corporatisme des cheminots en 1995, des routiers en 1996, voire des médecins en 1997. Dans le Figaro du 1er décembre 1995, Franz-Olivier Giesbert dénonçait ainsi « les corporatismes et les archaïsmes qui ankylosent le pays ». Dans les mêmes colonnes, le 11 décembre, Daniel Cohn-Bendit opposait le « mouvement de modernisation de 1968 » au mouvement conservateur de 1995, résumé par le slogan « touchez pas à nos acquis ». Dès 1982, François de Closets, appelant à briser le « gros tabou des droits acquis » avait sonné la charge contre les « privilèges »9. Le « privilège » devenait ainsi, comme le dit Philippe Corcuff, « l’inégalité immorale de la société libérale idéale » face à l’inégalité morale, naturelle, produite par le marché et la concurrence10. Ce « prêt-à-penser anticorporatiste » visait en réalité à remplacer la représentation du conflit en termes de classes par une représentation en termes de catégories.
Ce qui nourrit les réflexes de défense catégoriels et peut aboutir à des replis corporatistes au sens péjoratif du terme, ce sont précisément les politiques libérales qui défont les solidarités et déchaînent la compétition de tous contre tous au détriment des réponses collectives. Les mêmes qui font volontiers l’apologie de ces politiques ne manquent pas de culot lorsqu’ils viennent reprocher aux victimes de défendre ce à quoi elles peuvent encore s’accrocher.
Dès le début de la campagne idéologique contre la « syndicratie », la « privilégiature », et les corporatismes, Suzanne de Bruhhoff en avait fort justement démonté la fonction, en rappelant simplement que « les corporatismes sont aujourd’hui avant tout une des formes prises par la concurrence de crise entre ouvriers lorsque fait défaut une issue collective11». On place les travailleurs en situation d’individualisation et de concurrence accrue sur le marché du travail, et on leur demande en outre une « conscience de classe » et une solidarité envers les plus vulnérables, faute de quoi ils seront culpabilisés pour cause de corporatisme égoïste ! « On peut, conclut de Brunhoff, inverser la critique de l’État-providence faite au nom de la régulation par le marché, et montrer que c’est la pression de la concurrence qui engendre des réactions “corporatistes”. Elle tend à faire de chaque travailleur un individu économique responsable des risques et des gains liés à son emploi. S’il touche moins que d’autres pour le même travail, ou s’il est licencié, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Isolé, il ne peut rien. La critique actuelle du corporatisme des syndicats vise le principe même de l’organisation d’un mouvement ouvrier de défense des travailleurs pris dans leur ensemble : elle entretient ainsi les réactions corporatistes qu’elle critique12. »
La représentation et l’énoncé de « l’intérêt général » ne sont pas une donnée naturelle et spontanée parmi les opprimés et les exploités. Ils supposent que soient surmontés l’aliénation quotidienne et le fait que les salariés soient d’abord des marchandises rivales, opposées les unes aux autres, par la loi de l’offre et de la demande sur le marché du travail. L’obstacle n’est pas mince. Seule l’expérience répétée des luttes, leur mémoire collective, l’organisation collective de résistance quotidienne permettent de le franchir. La notion de l’intérêt général n’est donc pas un point de départ inné, mais un aboutissement, le résultat d’une construction, qui s’impose malgré la tendance récurrente à la division.
Si l’on veut bien admettre que cette notion, vue par « ceux d’en bas », ait quelque chose à voir avec ce qu’on appelait, hier encore, une conscience de classe, il faut donc souligner que cette conscience, fruit d’une expérience sociale et historique, est le contraire d’une conscience abstraite octroyée. Elle se développe à travers le conflit même et, précise Denis Segrestin, « elle ne se développe qu’à partir de la conscience d’appartenance à des groupes concrets13 ». La trajectoire du syndicalisme confédéré est ainsi le résultat d’un long processus d’organisation autour de métiers, de branches ou d’entreprises, qui constituent à une époque donnée le noyau identitaire unificateur du mouvement. L’intérêt général se coagule ainsi autour de groupes moteurs et de figures symboliques, dont le mineur de Zola, le cheminot de Renoir, le métallo de Carné ou de Visconti ont pu constituer tour à tour l’image emblématique.
Ces noyaux ont précisément été dissous ou durement malmenés par la crise et les restructurations : fermetures d’usines, cassage de la sidérurgie, de la construction navale. Ceux qui ont disparu n’ont pas vraiment été remplacés, malgré les luttes massives des employés de banques dans les années soixante-dix, des instituteurs-institutrices ou des infirmières en 1988. Ce n’est pas par hasard si les cheminots, participant encore de cette culture ouvrière d’hier, ont pu constituer un puissant catalyseur en décembre 1995. La dignité d’une appartenance se construit principalement dans la lutte. Bien des enquêtes ont ainsi souligné la fierté retrouvée de se dire « cheminot » – mot chargé de tradition et porteur d’un métier – plutôt que simplement « agent de la SNCF ». De même, les grandes grèves de 1988 ont forgé une image populaire de l’infirmière en tant que salariée.
À l’encontre des accusations de corporatisme, ce qui est frappant, dans les luttes de 1995 et les suivantes, c’est plutôt le mouvement logique qui va du particulier au général. On est passé ainsi de la défense du statut de la fonction publique à celle du service public. Alors que l’élargissement du mouvement s’était avéré problématique en 1986 et 1988, y compris entre roulants et non-roulants chez les cheminots, entre infirmières et aides-soignantes dans les hôpitaux, le fameux « Tous ensemble » est devenu le mot de passe de décembre 1995. Alors que certains reprochaient aux grévistes leur insouciance du lendemain et leur indifférence aux générations futures, les traminots de Marseille, en menant une lutte acharnée contre le double statut, s’opposaient à une dégradation des conditions d’emploi et de salaire pour les nouveaux embauchés. Dans la foulée, les routiers en grève de 1996 ne se battaient plus, comme en 1992, aux côtés de leurs patrons contre les taxes, mais contre leurs patrons, en défense de leurs propres conditions de travail. Où est le corporatisme dans tout cela ? La défense de revendications catégorielles, oui, bien sûr, mais elles ont souvent été le point de départ d’un rapide travail de conscience et d’un élargissement de l’horizon.
Quant à la tentative d’opposer les nantis du secteur public au monde des « exclus » et des « sans » en tous genres, elle a également fait long feu. Les différences existent certes. Elles sont même profondes. Lors de l’arrivée à Amsterdam de la marche européenne des chômeurs, en juin 1997, on a vu les marcheurs rejeter l’idée d’une tête de manifestation commune avec une délégation des futurs chômeurs de Vilvorde. Ils défileraient les uns à la suite des autres et non pas mélangés. C’est parfaitement compréhensible : leur marche, pour les exclus, est aussi une manière d’exister. Mais, par-delà ces réalités, il faut constater que les mouvements se sont plutôt nourris les uns des autres, que l’appel des « sans » dit de Beaubourg est né dans le sillage des grèves de décembre 1995, que dans les grandes occasions (manifestations de décembre, mobilisations contre les lois Debré et pour les sans-papiers, soutien à Vilvorde, marches contre le chômage) on a généralement retrouvé côte à côte une partie du mouvement syndical (FSU, Sud, CFDT-en-luttes, CGT parfois) et la nébuleuse des mouvements associatifs (Dal, AC !, APEIS, Droits devant, Cadac, Ras l’Front, Act-Up…).
Mouvements sociaux et luttes des classes
Pour bien des commentateurs hâtifs, la floraison des mouvements sociaux serait le signe d’un dépérissement ou de la disparition de la lutte des classes. Chez Touraine, la polarisation de l’antagonisme de classe se dissout ainsi dans la croissance envahissante de la classe moyenne : le nouveau clivage ne passe plus alors entre exploiteurs et exploités mais entre classe moyenne (plus ou moins nantie et privilégiée) et underclass des exclus. Cette classe moyenne devient du même coup le moteur exclusif de la modernisation possible ou au contraire de la régression corporative du salariat : « La France est-elle capable de réussir la mutation d’une classe moyenne dépendant de l’État en un réseau d’innovateurs, de chercheurs, d’entrepreneurs, de négociateurs et de critiques ? Est-elle capable de substituer, en son cœur même, l’esprit de changement au corporatisme, le service de la société à celui de l’État, et le goût de la diversité à l’application de la règle, la compréhension de la diversité à la rationalisation ?14 ». Toute la conflictualité devrait dès lors être interprétée à travers cette grille opposant le réseau à la centralisation, la modernité sociétale à l’étatisme républicain, les intellectuels saint-simoniens tempérés aux démagogues inconditionnels du mouvement social, la sociologie tourainienne de la liberté à la sociologie bourdivienne de la nécessité en somme.
Pour soutenir une telle thèse, il faut une théorie ad hoc. Ainsi, les classes, si elles jouent encore un rôle, ne sont plus déterminées par leur place dans les rapports de production et de reproduction d’ensemble de la société, mais de manière privilégiée « par rapport au marché », autrement dit à la consommation. Cela permet d’identifier le « noyau central des salariés des entreprises plutôt à une classe moyenne vaguement définie par un niveau de revenu et un genre de vie15 ». Très vaguement, en effet ! Mieux encore, cette grille d’interprétation permet au sociologue de l’action, de démasquer la mystification du « tous ensemble » de décembre, tendant à accréditer une renaissance des solidarités de classe : « Le “tous ensemble” des manifestations voilait une mosaïque d’intérêts disparates, de différences de “rang” et de dignité qui forment la structure des organisations publiques fort inégalitaires. La protection partagée n’est pas l’égalité de traitement, et cette “lutte des classes” fut aussi une lutte des rangs, des petits avantages et des petits concours contre les grands. L’autre lutte des classes, la “vraie” [sic !], a regardé passer les défilés16 » Des intérêts disparates et des différences de rang, on en retrouve dans tous les mouvements massifs, à commencer par la grève générale de 1968. Ce qui distingue 1995 par rapport aux luttes précédentes, c’est au contraire la recherche d’une unité, où Dubet voit pourtant essentiellement une mystification et une diversion : on ne trompe pas le nez d’un sociologue !
Encore plus explicite, Michel Wievorka s’empresse de faire ses adieux, non seulement au prolétariat, mais encore au conflit de classe en général : « Tout ceci est terminé. Le conflit de classe s’est déstructuré et les luttes ouvrières, si légitimes qu’elles soient, ne peuvent plus prétendre incarner un principe universel. À la place de l’ancien conflit de classe, à côté de ses débris plus ou moins catégoriels ou corporatisme [il y a au moins ici de la suite dans les idées !], ou de ses expressions désormais institutionnalisées, s’élargit la béance de ce que l’on désigne en France par deux expressions plus complémentaires que concurrentes : l’exclusion, la fracture sociale17 » Exit donc le conflit de classe. Place aux nouvelles frontières (aux nouveaux fronts) de l’exclusion et de la fracture sociale, passible, comme son nom l’indique, d’un traitement médicalisé, d’une thérapie de réduction des fractures par la potion de l’équité à la mode Alain Minc. Comme le disent fort pertinemment Christian Baudelot et Stéphane Israël, « la fausse opposition “exclus”/classes moyennes sert le conservatisme social le plus strict ; de même que l’humanitaire ne saurait faire office de politique étrangère, l’abbé Pierre, si fondé que soit son combat, ne saurait incarner à lui seul la question sociale18 ».
Cette thèse du dépérissement du conflit de classe se complète et se renforce parfois du discours sur la disparition ou la fin du travail, dont la fonction idéologique est tout aussi limpide. L’une et l’autre sont pourtant plus que contestables.
Adieu au travail ?
Crise du travail, disparition du travail ? Comme le dit avec quelque soulagement Bernard Perret dans sa contribution aux dossiers de la revue Esprit sur le sujet, « la question du travail est en train d’émerger derrière l’obsession de l’emploi ». Après les adieux au prolétariat, ceux au conflit de classe, voici donc les adieux à l’emploi. L’enchaînement ne manque d’ailleurs pas de logique. Oublions donc l’emploi, puisqu’il n’y en aura plus, et songeons plutôt à jouir intelligemment du temps libre ainsi que nous y invite Olivier Mongin : « La conscience que le plein-emploi, loin d’être la règle, correspondait à une période exceptionnelle, à une parenthèse historique aurait dû être prise beaucoup plus tôt19» Le travail, c’est donc désormais ringard, anti-moderne.
D’un point de vue anthropologique, si l’on considère le travail comme un processus historique d’échange organique entre la nature et la société humaine, de conversion d’énergie, de transformation réciproque, l’argument est à l’évidence absurde. A fortiori si l’on considère que les besoins individuels et sociaux ne sont pas donnés une fois pour toutes, mais eux-mêmes historiques, évolutifs, et que leur développement et leur diversification, grâce à l’accumulation d’un surproduit social, peuvent être considérés comme des critères de progrès authentique. La transformation des besoins appelle sans doute des métamorphoses du travail, non sa disparition.
Le déplacement de la question de l’emploi à celle du travail en général contribue en réalité à masquer un problème et une crise plus spécifiques : ceux du travail salarié, exploité, contraint et aliéné ; ceux du temps de travail comme mesure universelle du lien social, de l’échange des richesses et des rapports des individus entre eux ; ceux de la réduction par le marché du travail concret, composé, complexe, au travail abstrait, simple, « sans qualité ». Plus le travail, précisément, est élaboré, plus il incorpore de savoirs accumulés, plus il s’individualise, plus cette commune mesure devient « misérable » et irrationnelle, ainsi que Marx l’avait prévu. C’est bien là le fin mot de l’énigme, le secret dévoilé des paradoxes d’une économie qui, produisant davantage de richesses en moins de temps, ne parvient plus à garantir ce qu’elle garantissait hier, produit de l’exclusion au lieu de promettre du temps libre ou de satisfaire de nouveaux besoins.
Parce que le temps de travail abstrait, convertible en plus-value et en profit, reste, malgré tout, la mesure universelle (la plupart des conflits tournent autour de cette question, qu’il s’agisse du système des retraites, de la réduction du temps de travail, de la flexibilité, de l’aménagement des horaires, etc.), les gains de productivité réalisés dans les secteurs de production industrielle ne sont pas directement convertibles – à conditions de rentabilité capitaliste équivalentes – en emplois dans les services : on peut diviser par dix le temps de production d’une automobile ou d’un ordinateur ; on ne divisera pas par dix le temps nécessaire à une infirmière pour soigner un patient ou à une institutrice pour éduquer des enfants.
Tant que les règles restent ce qu’elles sont, l’emploi doit être considéré comme un droit et un dû qui commande d’autres droits à l’existence20. On peut imaginer que les modalités évoluent avec les techniques et l’organisation sociale, que se multiplient les « intermittents du travail » comme il y a des intermittents du spectacle, à condition bien sûr d’en définir le statut et les garanties. On peut imaginer de nouvelles combinaisons et interpénétrations entre le temps de travail et le temps dit libre, étant entendu toutefois qu’un loisir libéré est difficilement imaginable à côté d’un travail restant aliéné : À travail aliéné, loisir aliéné ! À travailleur assujetti, meutes sportives et bouchons dominicaux sur l’autoroute ! À exploitation dans le travail, inégalité dans le loisir !
Devant la transformation de l’organisation et de la division du travail est apparue l’idée d’une dissociation du revenu et de l’emploi. Au niveau de tous ceux et celles qui souffrent de l’exclusion, la revendication d’un revenu de citoyenneté ou d’une allocation universelle peut en effet apparaître comme une réponse de bon sens : si la société n’est plus capable de garantir un emploi, qu’elle assure au moins un revenu permettant de (sur)vivre sans travailler. Il y a en réalité des façons fort différentes d’aborder la question.
On peut dire en effet que le droit à l’existence était reconnu par la Constitution de 1793 et le droit à l’emploi par celle de 1945. Si ce droit n’est pas respecté, tout(e) citoyen(ne) devrait, à défaut, avoir accès à un revenu permettant de vivre décemment. En bonne logique, ce revenu ne saurait être inférieur au salaire minimum. On ne vit pas à mi-temps ou à demi-revenu : un « smic-chômeur » ou un « smic-exclu » ne serait pas plus acceptable qu’un « smic-jeune ». En attendant, on peut s’appuyer sur tous les dispositifs d’amortissement, tels que les allocations-chômage ou le RMI pour se battre pour leur revalorisation à la hausse, sans renoncer pour autant à une lutte d’ensemble pour le plein-emploi.
La logique des fervents défenseurs du « revenu de citoyenneté » ou de « l’allocation universelle » est généralement autre. Pour eux, la nécessité de l’allocation universelle serait inséparable de l’émergence d’un « secteur quaternaire » non mécanisable, de « travail libre » et « d’intégration sociale par des activités socialisantes par excellence » : « Il existe un lien fonctionnel entre l’allocation universelle, la troisième révolution industrielle et l’essor d’un secteur quaternaire d’activités postconventionnelles non standardisables », qui « serait à la fois un secteur utopique dans la mesure où il prétend honorer les anciennes utopies de travail non aliéné, de travail libre et sensé, et un secteur de bon sens21 ».
Le fil conducteur est alors celui d’une dissociation progressive entre la contrainte de travail et le droit au revenu, sanctionnée par un « droit au revenu inconditionnel et universel », à un « revenu social primaire distribué égalitairement et de façon inconditionnelle ». Une proposition aussi hardie et novatrice se heurterait selon Jean-Marc Ferry à deux résistances symétriques. Celle, d’une part, d’une « crispation travailliste » sur la revendication du plein-emploi et des droits acquis. Celle, d’autre part, de la foi moderniste dans les vertus du progrès automatique.
Au risque d’encourir l’accusation disqualifiante de « crispation travailliste », force est de constater que l’affaire ainsi présentée comporte deux inconvénients majeurs du point de vue de l’intérêt général des salariés :
– elle tend à justifier le renoncement à la lutte pour le droit à l’emploi (au plein-emploi) et à la réduction massive du temps de travail ; Jean-Marc Ferry ne mâche d’ailleurs pas ses mots : « L’idéologie du plein-emploi salarial est le plus grand obstacle à un dénouement positif de la crise actuelle22 » ;
– elle tend à faire sauter le verrou du smic en salariant (ou plutôt en indemnisant bien au-dessous du smic) une exclusion institutionnalisée et constitue paradoxalement du même coup une machine de guerre contre le système de protection sociale ; en effet, le revenu social primaire ne serait pas financé par la Sécurité sociale, mais par des prélèvements bancaires automatiques sur la consommation des ménages (une super TVA !).
L’idée d’une allocation universelle est donc bien à double tranchant. Elle oscille entre la séduisante utopie maximale d’un revenu sans travail et la réalité prosaïque d’une charité minimale (« du RMI et des jeux télévisés » pour la nouvelle plèbe). Malheureusement, lorsqu’on passe aux travaux pratiques et aux tentatives de chiffrage, c’est l’interprétation libérale qui prévaut. Directeur honoraire du projet Delta et chercheur au CNRS, François Bourguignon propose de prendre pour base de calcul du revenu de citoyenneté le RMI, soit 30 000 F par an et par adulte, soit une masse à financer de 1 200 000 dont il faudrait retrancher 250 milliards de prestations actuelles (action sociale, aide à l’emploi, allégements de charges). Il resterait donc environ 900 milliards à financer, soit 30 % du revenu net des ménages, ce qui exigerait un impôt proportionnel supplémentaire de 30 % sur les revenus : « difficile à imaginer à court terme », mais « défendable », conclut le chercheur. Tellement difficile pourtant qu’il envisage une solution alternative d’un revenu non plus égal au RMI, mais de 15 000 F par an (soit 1 250 F par mois !). Cela « pose un sérieux problème », admet-il : cette allocation « permet-elle de remotiver ceux qui touchent déjà le RMI et dont certains sont difficiles à réintégrer dans le marché du travail23 ? ». « Par ailleurs, conclut-il, tout dépend de l’analyse que l’on fait du phénomène du chômage ». En effet !
Dans le même numéro du Monde, Yoland Bresson, économiste enseignant à Paris XII, se livre à un exercice parallèle de chiffrage du revenu d’existence. Pour un revenu de 1 600 F mensuels, il faudrait trouver 1 100 milliards. Il propose pour cela un grand emprunt et la suppression pure et simple des allocations familiales, du minimum vieillesse et du RMI ! Le « revenu d’existence » ferait éclater ainsi toutes les rigidités et les protections dont se plaint le patronat. Il offrirait une armée de main-d’œuvre de réserve en haillons, corvéable à merci.
Ces élucubrations – non innocentes au demeurant – ne doivent pourtant pas servir de prétexte à enterrer un vrai problème. Il est en effet possible, par-delà les fluctuations temporaires liées à une réorganisation de la production et à une nouvelle révolution technologique, qu’apparaisse durablement une nouvelle division du travail dans laquelle l’emploi à durée indéterminée tendrait à diminuer au profit d’emplois intermittents ou discontinus.
La question d’une permanence du revenu malgré l’intermittence du travail se poserait alors (comme elle se pose déjà par exemple pour les intermittents du spectacle). Un tel revenu ne pourrait alors relever du seul contrat salarial entre l’employeur et le salarié. Il devrait être garanti par la collectivité, soit par l’État, soit par un fond mutualisé de répartition, qui reviendrait à une super-Sécurité sociale. Inutile de préciser que la conquête d’une telle garantie supposerait un rapport de force qualitativement différent entre le travail et le capital. C’est d’ailleurs pourquoi les meilleures intentions du monde à propos du revenu de citoyenneté et de l’allocation universelle, ont toutes chances, dans le monde réellement existant, de se traduire pratiquement par une obole minimale de survie, d’un côté, et par un démantèlement accru des acquis sociaux, de l’autre.
La citoyenneté dont il est souvent question ces temps-ci ne se partage pas. Elle vaut au travail comme ailleurs. D’où l’enjeu, non seulement économique, du débat sur la réduction radicale du temps de travail à 32 ou 30 heures, du passage à la semaine de quatre jours ou à la demi-journée de travail. Non seulement elle va dans le sens de la réduction historique du temps de travail (4 000 heures par an en 1850, entre 1 600 et 2 000 aujourd’hui, bien que la durée hebdomadaire légale n’ait été réduite que de 40 heures en 1936 à 39 heures en 1981 malgré des gains de productivité énormes), non seulement elle constitue un élément central de réponse à la question du chômage, mais encore elle appelle une transformation radicale de l’organisation et de la division du travail. De sorte que l’utopie de Marx, de l’individu polyvalent qui pourrait être travailleur le matin, peintre ou pêcheur à la ligne l’après-midi, citoyen actif et philosophe critique le soir, puisse un jour prendre corps24.
Si l’on considère la question de l’emploi et du travail dans sa spécificité historique comme question du travail salarié et exploité, alors la question du conflit de classe se repose avec force.
Adieux au prolétariat ?
À l’encontre des constats ou prédictions sur sa disparition, nous serions tentés de dire d’abord : la preuve des classes, c’est qu’elles luttent. Leur composition sociologique en revanche varie considérablement, avec les techniques et l’organisation du travail. Le prolétariat artisanal dont parle Marx en 1848 n’a pas grand-chose à voir avec le grand prolétariat industriel de la fin du siècle, avec celui de l’Allemagne des années vingt ou de l’Amérique des années trente. Il n’y a aucune raison pour que ces mutations cessent. Si le déclin du prolétariat industriel est indéniable ces vingt dernières années dans les pays capitalistes développés, il est beaucoup moins évident à l’échelle internationale où la prolétarisation massive continue dans les villes et les campagnes, à tel point que Michel Aglietta considère « la généralisation du salariat au niveau mondial » comme un trait majeur de la phase actuelle de développement capitaliste25.
Au sein même des pays industrialisés, le recul du prolétariat industriel s’accompagne d’une extension du salariat (plus de 80 % de la population active), dont la majeure part est constituée par les employés prolétarisés des services, dont les conditions de travail, de revenu, d’exploitation sont souvent alignées sur ceux des ouvriers.
Comme l’écrit Michel Cahen en saluant l’irruption d’un nouveau prolétariat dans l’action sociale, le vocable « classe ouvrière » est « conceptuellement tout à fait impropre à désigner ce qu’il représente ; le prolétariat ouvrier n’est pas une classe sociale, il est l’un des milieux sociaux de la classe prolétarienne aux côtés d’autres milieux sociaux prolétariens comme les employés, les infirmières, les instituteurs, etc.26 ».
Vigoureusement opposé aux thèses libérales et saint-simoniennes, Philippe Corcuff soulève une objection d’un autre ordre. Il redoute que les phénomènes partiellement nouveaux, divers et complexes, à l’œuvre dans le renouveau des mouvements sociaux ne soient hâtivement reconduits à des schémas d’interprétation simplificateurs et unilatéraux, au détriment d’un examen attentif et ouvert. L’interprétation se jouerait alors entre des « grands types » connus : « régression corporatiste, retour de la lutte des classes, ou retour de la nation ». Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’interprétations, mais de tendances à l’œuvre dans le mouvement réel, sans quoi l’interprétation serait bêtement arbitraire.
Il y aurait bien des présupposés théoriques à la discussion, sur ce que l’on entend par classes, sur la façon de les déterminer. Nous ne pouvons y revenir dans les limites de cette introduction. Allons donc à l’essentiel. Philippe Corcuff insiste, « dans une perspective post-marxiste » sur l’héritage de la sociologie de Pierre Bourdieu : la diversité des champs sociaux, d’espaces de relations asociales autonomes les uns par rapport aux autres, associés à des formes de domination et de capitalisation des ressources plus ou moins spécifiques (capitalisation économique, mais aussi culturelle, politique, technocratique, médiatique, etc.). Conclusion : « On n’aurait donc pas, au sein d’une société comme la nôtre, un capitalisme économique structurant a priori le reste des rapports sociaux (comme dans les schémas marxistes), mais bien des capitalismes. »
Nous ne contestons pas la pertinence de ces remarques et la fécondité de la démarche à laquelle elles invitent. Nous sommes tous et toutes, de quelques manières, des nœuds de conflits et d’appartenances divers, d’âge, de sexe, de religion, de nation, de classe, de rang. Reste à savoir si, dans une époque donnée, un fil permet de commencer (de commencer seulement) à démêler cette pelote embrouillée. Car les trois grandes interprétations relevées par Philippe Corcuff sont aussi des orientations. Il écrit en effet : « Dans les approches dites constructivistes [qu’il revendique], les classes et les clivages sociaux sont appréhendés non comme des “nécessités objectives” (comme chez nombre de marxistes), ni comme des “illusions idéologiques” (comme pour certains libéraux), mais comme des construits sociaux, dotés d’une épaisseur historique plus ou moins activée dans la vie quotidienne ; le double travail symbolique – la constitution de représentations du monde et d’un langage communs – et politique – à travers des porte-parole et des institutions parlant au nom du groupe – apparaît alors central dans ce qui n’est qu’une unification relative d’expériences et d’intérêts plus ou moins disparates. »
Il semble, par-delà des traditions et des formations différentes, que nous puissions nous accorder sur l’essentiel. Nous le dirions sans doute autrement. Le rapport salarial d’exploitation structure un conflit de classe. Les classes ne sont pas pour autant homogènes. Pas plus que le capitalisme ne se réduit à un « capitalisme économique » : il organise et structure de manière relativement cohérente l’ensemble des rapports de production et de reproduction (y compris, la santé, l’éducation, la ville, le travail domestique, le rapport entre générations). Enfin, la conscience d’appartenance (de classe), la constitution d’une mémoire collective, la production d’une culture politique ou syndicale ne sont pas des produits mécaniques de la lutte. Elles supposent une élaboration spécifique dans un champ spécifique de lutte idéologique et politique. Une « construction » en somme, ce que Philippe Corcuff appelle un « double travail symbolique et politique ». Nous en sommes bien d’accord.
Reste alors à savoir, parmi les diverses constructions possibles, dont le chantier est ouvert par la lutte, laquelle choisir et laquelle travailler. Si l’on renonce, parmi les « grandes interprétations », à celle en termes de lutte de classes, il y a de fortes chances que l’emporte la représentation en termes corporatifs (particulier contre universel) ou en termes nationaux (selon le clivage national/étranger). Philippe Corcuff insiste au demeurant fréquemment et à juste titre sur les dangers d’un glissement du « clivage de la justice sociale » à un « clivage national/racial » bénéfique au Front national. Mais parler de « clivage de la justice sociale », entre pauvres et riches, entre ceux d’en bas et ceux d’en haut, ne revient-il pas, dans un langage sans doute moins marqué, plus populaire et plus accessible, à retrouver et activer le clivage de classe contre le clivage national.
C’est en tout cas notre choix. Non parce que ce clivage irait de soi. Ou parce que sa conscience en viendrait spontanément et facilement aux manifestants et aux grévistes, mais précisément parce qu’il s’agit de construire une conscience collective antinomique aux appartenances exclusives et vindicatives. Walter Benjamin soulignait jadis que l’Allemagne nazie était le pays où il était devenu interdit de nommer le prolétariat par son nom. Hannah Arendt soulignait après lui l’importance et la signification du jargon des « masses » et des « gens » en lieu et place de la lutte des classes. Cette guerre des mots participe précisément du travail symbolique invoqué par Corcuff. C’est pourquoi nous n’entendons pas y renoncer.
L’enjeu est quotidiennement vérifiable. Corrélativement à l’affaissement de la référence de classe, on voit apparaître un jeu d’oppositions, de fausses alternatives, plus ou moins confuses, douteuses, ou mystificatrices : modernes contre archaïques, démocrates contre républicains, modernes contre anciens, girondins contre jacobins, deuxième gauche contre première gauche. Périodiquement, les uns et les autres enterrent la hache de guerre, se retrouvent pour gouverner ensemble. Il est d’ailleurs logique que, si la lutte de classe n’a plus de sens ni de réalité, l’opposition entre la droite et la gauche, qui est depuis un siècle son effet diffracté, n’en ait plus non plus. Et les uns et les autres s’accusent mutuellement de faire le jeu du Front national, les uns parce qu’ils flatteraient les sirènes nationalistes, les autres parce que leur libéralisme débridé alimenterait en retour un repli national.
Dans cet écheveau de contradictions bien réelles, le front de classe fournit du moins un fil conducteur qui est un fil d’universalité, opposé aux esprits de clocher et de chapelle. De l’autre côté de la frontière, de l’autre côté de la foi, de l’autre côté du mur, il y a toujours un travailleur, un autre soi-même.
Ce « principe universel », que Michel Wieviorka déclare caduc, est à la base de l’internationalisme, à l’opposé de l’escalade ethnique, nationale, ou religieuse, vers l’anéantissement d’un ennemi absolu. Il ne garantit pas la disparition automatique de toutes les oppressions (de sexe notamment), mais il permet du moins de s’orienter dans les labyrinthes du monde.
C’est pourquoi nous sommes attachés à sa « construction ».
Le mot nous convient. En revanche, en dehors des trois grandes interprétations, certainement simplificatrices, relevées par Philippe Corcuff, une quatrième, qui se contenterait de l’inventaire d’une conflictualité en miettes, constituerait une digue bien fragile face à la montée des périls. La force du « clivage national/racial » est en effet directement proportionnelle aux reculs du clivage social, du « clivage de la justice sociale » si l’on veut, ou du clivage de classe tout court.
La véritable difficulté de l’époque réside donc dans les obstacles et les difficultés de cette construction, dans les incertitudes du procès de déconstruction-reconstruction aujourd’hui à l’œuvre. Les nouvelles formes d’organisation du travail, les modes privatisés de consommation, l’atomisation sociale face aux grands flux de richesses et d’information permettront-elles encore la formation d’une conscience collective ? La disjonction du social et du politique peut-elle trouver une solution dans un monde en mutation où le politique perd son emprise sur le bien commun, où l’espace public est livré à la privatisation, où les anciennes échelles de souveraineté sont dépassées sans que de nouvelles régulations cohérentes apparaissent ? La perte relative de centralité du conflit capital/travail dans la sphère productive ne peut-elle produire qu’une « conflictualité ponctuelle et épisodique », incapable d’unifier les mouvements autour de grands projets communs et de construire une mémoire collective cumulative de l’expérience ?
Ces questions sont ouvertes. Inquiétantes à plus d’un titre.
Il est trop tôt pour y répondre. Et l’évolution même de leur énoncé dépend précisément des luttes engagées, de leur issue provisoire, des leçons qu’elles permettent.
1997
Extrait de l’introduction au Retour de la question sociale27ublié
Documents joints
- Voir, le Grand Refus, réflexions sur la grève de décembre 1995, Alain Touraine, François Dubet, Didier Lapeyronnie, Fahrad Khosrokhavar, Michel Wieviorka, Paris, Fayard 1996.
- Alain Touraine, <em>op</em>. <em>cit</em>., p. 47.
- Alain Touraine, <em>op</em>. <em>cit</em>., p. 49.
- Fahrad Khoroskavar, op. cit., p. 204.
- Michel Wieviorka, op. cit., p. 247.
- Alain Touraine, op. cit., p. 52.
- Ibid.
- Nicolas Le Strat dans Futur Antérieur n° 33-34) parle à ce propos de « reterritorialisation politique » ou de réinvention de la « territorialité politique ». Alain Bertho (ibid.) souligne la redécouverte d’une « identité locale », des notions de « solidarité publique » et d’« intérêt général ».
- François de Closets, Toujours plus, Paris, Grasset, 1982.
- Philippe Corcuff, « La France malade de ses corporatismes, un prêt-à-penser libéral pour les élites de droite et de gauche », in la Pensée confisquée, Club Merleau-Ponty, Paris, La Découverte, 1997.
- Suzanne de Brunhoff, l’Heure du marché, Critique du libéralisme, Paris, Paris, Puf, 1986, p. 76.
- Ibid., p. 78.
- 13/ Voir Denis Segrestin, « Du syndicalisme de métier au syndicalisme de classe, pour une sociologie de la CGT », in Sociologie du travail, vol. 17, avril-juin 1975.
- Alain Touraine, op. cit., p. 31.
- <em>Ibid</em>. p. 64.
- François Dubet, op. cit., p. 115.
- Michel Wievorka, op. cit., p. 252.
- Le Monde, 28 décembre 1995.
- Le Travail, quel avenir ?, ouvrage collectif, présentation d’Olivier Mongin, Paris, Folio-actuel, 1997.
- La discussion concrète (et chiffrée) sur les différentes formules de revenu de citoyenneté ou de revenu universel inconditionnel, plaidées par Jean-Marc Ferry ou Philippe Van Parijs, mettrait en évidence les effets perversement démobilisateurs d’une utopie sociale d’apparence radicale. Il en va souvent ainsi, hélas, des rêves libéraux à double tranchant.
- Jean-Marc Ferry, l’Allocation universelle, pour un revenu de citoyenneté, Paris, Cerf, 1996.
- Ibid.
- Le Monde, du 8 avril 1997.
- « Supposons que nous produisions comme des êtres humains : chacun de nous s’affirmerait doublement, dans sa production, soi-même et l’autre. 1. Dans ma production, je réaliserais mon individualité, ma particularité ; j’éprouverais en travaillant la jouissance d’une manifestation individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. 2. Dans ta jouissance ou ton emploi de mon produit, j’aurais la joie spirituelle de satisfaire par mon travail un besoin humain de réaliser la nature humaine et de fournir au besoin d’un autre l’objet de sa nécessité. 3. J’aurais conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d’être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même, d’être accepté dans ton esprit comme dans ton amour. 4. J’aurais dans mes manifestations individuelles, la joie de créer la manifestation de ta vie, c’est-à-dire que réaliser et d’affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l’un vers l’autre. » (Karl Marx, Œuvres, Pléiade, tome II, p. 22.)
- Voir Alternatives économiques, numéro hors série : 500 ans de capitalisme.
- Le Monde, 7 décembre 1997, reproduit dans Mouvements sociaux et exclusions, Cahiers de l’IRSA (Institut de recherches sociologiques et anthropologiques), n° 1, Montpellier, mars 1997.
- Extrait rédigé par Daniel Bensaïd. Voir Christophe Aguiton, Daniel Bensaïd, le Retour de la question sociale, Lausanne, éditions Page 2, 1997.