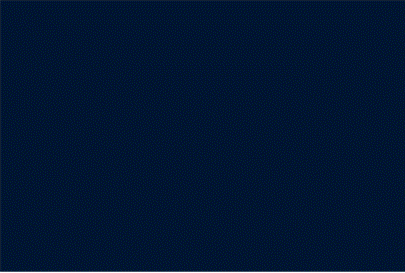
« Certains se sont affligés récemment, écrit Alain Brossat, de la manie compulsive de juger les événements passés. » Il apparaît que j’occupe une place de choix parmi ces « certains ». Je serais pris en flagrant délit « d’inconséquence » : « curieusement, celui qui sonne cette charge contre cette tendance à la judiciarisation du domaine historique et politique se sentit parfaitement à l’aise pour porter dans l’instant un jugement péremptoire et définitif sur l’intervention de l’Otan contre Milosevic ». Je ne vois pourtant ni inconséquence ni contradiction dans l’affaire : ce jugement sur l’intervention de l’Otan, dans l’instant de l’événement, au risque de l’erreur, est un jugement (une responsabilité) politique, et non pas judiciaire1.
Dans Qui est le juge ? (livre auquel Alain Brossat fait constamment allusion sans la moindre référence précise), je me suis, en effet, inquiété de la manie de juger, de « faire le dieu » en jugeant2, qui témoigne d’un renoncement au jugement politique devant les automatismes marchands, d’un côté, les sermons moralisateurs, de l’autre. J’en ai pris pour exemple la convocation des historiens au prétoire où, cités comme témoins (jurant donc de dire toute la vérité… historique !), ils apparaissent en réalité dans le rôle ambigu d’experts apportant leur caution scientifique à un jugement pénal.
La table ronde, réunie il y a quelques années par le journal à propos des accusations portées contre Lucie et Raymond Aubrac, est parfaitement exemplaire de cette dérive, où les historiens-experts se métamorphosent spontanément en procureurs, sans les règles ni les garanties de la procédure. Cette judiciarisation du « métier d’historien » a d’ailleurs pour contrepartie un étrange ton réquisitorial, dont Stéphane Courtois donne l’exemple dans sa préface au Livre noir du communisme. Que le Juge et l’Historien aient en commun la pratique de l’enquête ne justifie nullement la confusion des genres. Je m’en tiens sur ce point au sage constat de Marc Bloch : « Réduire l’historien au juge, c’est simplifier et appauvrir la connaissance historique ; mais réduire le juge à l’historien, c’est pervertir irrémédiablement l’exercice de la justice. » Entre les deux, la tension n’est pas nouvelle. Elle requiert une médiation : celle du tiers exclu (ou caché), celle du jugement politique que je n’entends nullement éluder. Je veux au contraire l’expliciter et la mettre en lumière dans toute son inévitable fragilité.
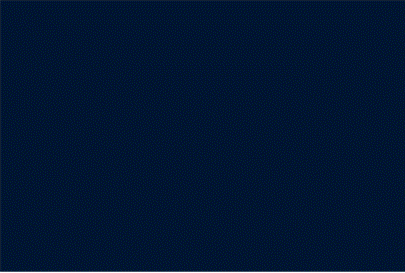 La confusion des rôles et des discours, judiciaire (et plus particulièrement pénal) et historique, accompagne une confusion croissante des temporalités respectives du droit et de l’histoire. Par la prescription, le droit s’interdisait de remonter au-delà d’un certain point le temps historique. Inversement, en gardant ses distances par rapport au présent immédiat, l’historien s’imposait une sorte de délai de réserve. L’imprescriptibilité du « crime contre l’humanité » autorise désormais la justice à remonter le temps et, réciproquement, l’histoire s’empare du présent. Alors que la première a pour fonction de classer une affaire au nom de la chose jugée, la seconde reste dans l’interprétation d’affaires inclassables et ne peut se détacher des guerres de mémoire. Souligner les implications et les dangers de cette nouvelle temporalité, peut-être inévitable, où le droit et l’histoire se confondent, ne me conduit nullement à refuser, au nom d’un scepticisme blasé, la responsabilité du jugement, mais à réfléchir au contraire sur la nature et la multiplicité des jugements en question.
La confusion des rôles et des discours, judiciaire (et plus particulièrement pénal) et historique, accompagne une confusion croissante des temporalités respectives du droit et de l’histoire. Par la prescription, le droit s’interdisait de remonter au-delà d’un certain point le temps historique. Inversement, en gardant ses distances par rapport au présent immédiat, l’historien s’imposait une sorte de délai de réserve. L’imprescriptibilité du « crime contre l’humanité » autorise désormais la justice à remonter le temps et, réciproquement, l’histoire s’empare du présent. Alors que la première a pour fonction de classer une affaire au nom de la chose jugée, la seconde reste dans l’interprétation d’affaires inclassables et ne peut se détacher des guerres de mémoire. Souligner les implications et les dangers de cette nouvelle temporalité, peut-être inévitable, où le droit et l’histoire se confondent, ne me conduit nullement à refuser, au nom d’un scepticisme blasé, la responsabilité du jugement, mais à réfléchir au contraire sur la nature et la multiplicité des jugements en question.
Penser l’événement dans l’entre-deux
« Il n’est pas nécessaire que nous soyons engagés dans une situation, que nous y ayons des intérêts directs, pour que nous ayons néanmoins à en porter la responsabilité », rappelle Brossat, qui voit là une caractéristique de « notre condition de modernité ». Soit. Cette affirmation fait référence au Conflit des facultés de Kant. Le sens de la Révolution française y est défini du point de vue des spectateurs, dont l’émotion désintéressée révèle une tendance éthique de l’humanité. Alain Badiou estime au contraire que la vérité qui se manifeste dans l’événement, à la fois singulière et universelle, est perçue du point de vue des acteurs et de leur subjectivité. Ainsi, la Révolution française ne peut pas être comprise à partir de Taine ou de Furet, mais de Robespierre et de Saint-Just ; de même la Révolution russe ne s’entend pas du point de vue de Courtois ou de d’Encausse, mais de Lénine et de Trotski.
Je ne suis d’accord ni avec le désintéressement distancié des spectateurs ni avec la subjectivité engagée des acteurs. Penser politiquement l’événement, c’est le penser dans l’entre-deux, s’installer dans la tension d’une histoire critique ou stratégique. À la différence de l’histoire historienne (antiquaire ou monumentale), elle ne se contente pas d’enregistrer et de conserver les faits. Elle fait la part des possibles dans les bifurcations de l’événement. Cette approche impose de croiser en permanence le regard du spectateur et celui de l’acteur.
Brossat revendique le jugement du spectateur dans la problématique kantienne du jugement de goût, qui fournirait le modèle du « sens commun » auquel adosser notre exercice du jugement. Dans Qui est le juge ?, j’ai développé à ce propos une critique des thèses d’Hannah Arendt et de Dick Howard. S’agissant d’événements et de situations historiques, donc de jugement politique, il semble plus pertinent d’invoquer l’autre modalité du jugement réfléchissant kantien, celle du « jugement téléologique ». C’est précisément ce que fait à juste titre John Dewey dans sa grande Théorie de l’enquête : « Puisque le sens commun ne s’intéresse directement et indirectement qu’à des problèmes d’utilisation et de jouissance, il est téléologique en soi. » Concevoir le jugement politique comme téléologique, c’est assumer pleinement sa part d’incertitude dans une histoire profane, où, comme le dit Blanqui, « l’appel est toujours ouvert ». Plutôt que d’accepter cette fragilité du jugement humain en tant que jugement politique, la tentation est toujours forte de s’abriter sous l’autorité de fétiches majuscules – l’histoire hier, l’humanité aujourd’hui – et de glisser ainsi du jugement historique, toujours révisable, au verdict définitif de l’histoire.
Cette idée d’un « appel toujours ouvert » préoccupe Brossat, au point de m’accuser de dérive subreptice, d’un relativisme historique sceptique à un révisionnisme rampant : « D’une part, la dépréciation du modèle juridico-judiciaire dans les applications à l’histoire et à la politique inclut une critique des nouvelles pratiques du droit face au crime contre l’humanité, au génocide, aux actes de barbarie, aux crimes de guerre… Le livre de Bensaïd abonde en formules blasées et dubitatives dès lors qu’il est question du jugement des dictateurs, de la qualification de crimes spécifiques comme les disparitions comme “crimes contre l’humanité”, de juger les complices de la Shoah comme Maurice Papon. Si on le suit bien, même un Hitler, même un Staline seraient susceptibles de voir un jour leur procès révisé en appel. » Pour avoir été lui-même victime d’amalgames scandaleux, Brossat devrait manier l’insinuation avec plus de précaution et de précision.
Oui, je me suis interrogé (je ne suis pas le seul) sur le sens du procès Papon et le rôle qu’y ont joué les historiens. Je reste perplexe devant la contradiction entre un crime (contre l’humanité) déclaré « incommensurable » et son évaluation à l’aune de la machine à mesurer qu’est la balance judiciaire. Oui, je me suis interrogé sur le verdict, sur la disproportion entre l’incommensurabilité invoquée et les dix ans tarifaires infligés à Papon, puisqu’au prétoire on ne juge pas un crime collectif ou une idéologie, mais un individu singulier. Ce procès n’avait donc ni la valeur réparatrice pour les victimes ni la valeur pédagogique qu’on lui attribue. Il fallait cependant que ce procès ait lieu pour une tout autre raison, aux antipodes de la fonction judiciaire alléguée : pour entretenir le litige politique et empêcher de clore l’affaire : « Par rapport à cet enjeu primordial, la sentence est secondaire, forcément décevante, ou forcément frustrante, dans la mesure où elle prétend contribuer à la cicatrisation du crime3. » Décidément, le « crime absolu » se plie mal aux exigences de la mensuration pénale.
Jugements pluriels…
Je me suis aussi interrogé – dois-je l’avouer ? – sur l’inculpation de crime contre l’humanité avancée par le procureur Garzon pour obtenir l’extradition de Pinochet. Ce dernier est un dictateur et un assassin avéré. Je me réjouirais tout à fait qu’il fût jugé et fusillé par le peuple chilien. Mais la légitimité d’une cause ne justifie pas tous les accommodements avec le droit. Pour pouvoir juger Pinochet en Espagne, on pouvait étendre la jurisprudence du crime contre l’humanité aux disparitions (comme on l’a fait du viol systématique). La qualification du crime perdrait alors en précision ce qu’elle gagnerait en extension, au risque de voir le droit se dissoudre dans la morale. D’où ma conclusion : « Juger, oui, mais sans céder aux étourderies du lyrisme médiatique. Le jugement qui importe est celui des peuples contre leurs despotes. Le jugement politique ne s’y dissimule pas derrière le jugement judiciaire. Il est assumé pour ce qu’il est. À défaut, à défaut seulement, il faut juger “judiciairement” Pinochet4. »
Enfin, je ne vois pas pourquoi ces interrogations et ces perplexités devraient me condamner à accepter la révision du procès fait à Hitler ou à Staline. Dans ce cas, il ne s’agit justement pas de procès judiciaire, mais d’enquête historique et de jugement politique. Dans l’enquête historique, à moins de décréter une histoire officielle et de menacer d’une quelconque loi Gayssot quiconque s’en écarterait (le juge deviendrait alors l’arbitre de la vérité historique !), la révision est nécessairement permanente. Le jugement politique sur Hitler ou Staline relève non d’un tribunal mais d’une prise de parti et d’un engagement.
Pour m’intenter avec autant de légèreté un tel… procès en révisionnisme, Alain Brossat doit être déjà victime lui-même de la manie judiciaire ! Ma position est pourtant claire : « Le procès politique du nazisme, du stalinisme, de Vichy est toujours actuel, toujours possible et nécessaire, mais c’est un procès au présent pour le présent ; sa règle est d’annoncer la couleur et de prendre parti, au risque permanent de l’erreur ou de l’injustice5. » Le savoir historique n’est jamais catégorique. Les grands procès historiques portent sur des faits ouverts à un « à-venir » incertain. C’est pourquoi, dit Merleau-Ponty, « en un mot, ce sont des actes politiques ». Je n’en tire aucunement la conclusion relativiste, désabusée ou blasée, que m’attribue Brossat. J’affirme seulement que la ligne de partage, souvent mince et poreuse, entre le vrai et le faux, le juste et l’injuste, le bien et le mal, n’est pourtant pas nulle, n’est pourtant pas rien, et qu’elle est néanmoins suffisante pour établir une démarcation avec l’indifférence sceptique d’un jugement qui pourrait tout se permettre, comme avec la certitude dogmatique d’un jugement qui pourrait tout interdire. En politique, qui juge sera forcément jugé. « Une vérité, dit encore Merleau-Ponty, c’est toujours quelqu’un qui juge », mais « qui jugera de la vraie situation et de la vraie histoire ? » Qui est le juge ? Les jugements doivent s’y mettre, au moins, à trois : juridique, historique, et politique ; car le jugement n’est pas une compétence professionnelle ni un ministère de la vérité, mais un art profane.
Les motifs de l’acrimonie dont fait preuve Alain Brossat apparaissent en introduction et en conclusion de son article. Il établit à juste titre un lien entre la problématique du jugement et les positions opposées que nous avons prises devant l’intervention de l’Otan dans les Balkans. Il me reproche de ne concevoir l’événement que comme lever de soleil fondateur, comme « le fait du militant », et de rester aveugle à son envers obscur, l’événement-rupture qui ne se présente « pas comme un miracle mais comme un désastre ». Ce sont ces événements génocidaires qui permettraient la « mise en concept de l’histoire totalitaire et posttotalitaire ». L’histoire, il est vrai, avance souvent par son mauvais côté. Ses désastres n’en contribuent pas moins à élaborer ce que Brossat range sous la rubrique du sens commun, et que, reprenant un terme des Lumières, j’appelle « les mœurs ». Mais ce sens commun, loin de se confondre avec une simple majorité d’opinion, est divisé contre lui-même. Enracinées dans les conflits d’une société de classe, les mœurs demeurent un champ de bataille. Les références répétées de Brossat aux notions consensuelles de « vie civilisée » ou de « condition civilisée » semblent fort problématiques, dès lors qu’on oublie l’isomorphisme entre nos barbaries modernes et notre civilisation. Ces barbaries ne sont pas la barbarie éternelle, mais la barbarie déterminée de cette civilisation, son autre et son double. Si Milosevic (ou Poutine) est un monstre, il est le monstre de ce monde. Le crime contre l’humanité prend une allure particulière au fur et à mesure de l’industrialisation et de la technicisation des guerres, de l’effacement de la distinction entre combattants et civils, etc. L’ethnicisation et la confessionalisation de la politique ne sont pas l’avatar exclusif ou les ultimes convulsions de régimes poststaliniens, mais l’effet planétaire de la mondialisation marchande, de l’émiettement du monde, de ce qu’Hannah Arendt envisageait avec horreur comme la disparition de la politique.
Le moralisme d’Alain Brossat s’inscrit ici, à son corps défendant, dans la logique générale de la dépolitisation. La politique se dissout dans le droit et le droit dans la morale. Dans une tribune collective de soutien aux bombardements de l’Otan, il dénonçait l’an passé « l’anti-impérialisme pavlovien » de ceux qui refusèrent l’enrôlement volontaire dans la croisade otanienne. Il décrétait péremptoirement « la fatale préemption des catégories et systèmes dans lesquels ils pensent la politique6 ». Cette exécution d’une « catégorie » au riche passé théorique (de Rosa Luxemburg et Lénine à Samir Amin, Gunder Frank ou François Chesnais) apparaît bien sommaire au moment où la mondialisation impériale bat son plein, de Seattle à Davos. Les modes de domination impérialiste se métamorphosent sans disparaître : domination monétaire, conquête des marchés, suprématie d’armement, hégémonie scientifique et technologique, nouvelles formes de dépendance commandés par la dette et les plans d’ajustement du Fonds monétaire international, dollarisation des économies subalternes, nouvelle division internationale du travail, privatisation du bien commun par le brevetage du vivant… Si elle apparaît fort désinvolte, la liquidation conceptuelle sans inventaire est idéologiquement fonctionnelle : il faut bien que l’impérialisme soit soluble dans le marché mondialisé pour que l’opposition entre les démocraties (sans adjectifs) et les totalitarismes des « rogne states » (ou États délinquants chers à la rhétorique du Pentagone) devienne le clivage pertinent de la nouvelle vision libérale du monde. Les guerres impériales n’ont alors même plus besoin d’être déclarées, puisqu’elles deviennent de simples descentes de police, ou des « guerres éthiques », selon Tony Blair, menées au nom de la « souveraineté éthique », selon Daniel Cohn-Bendit.
… bataille à sens unique ?
Alain Brossat termine logiquement sa charge par la justification de la sainte guerre laïque faite à Milosevic et par la stigmatisation de « ceux pour qui la purification ethnique ne valait pas une bataille ». Est-ce à nous que ce discours s’adresse ? La purification ethnique valait certainement une bataille et même une triple bataille : contre Milosevic, les déserteurs serbes avaient raison et leur courage devait être soutenu ; les francs-tireurs kosovars avaient droit à la solidarité et aux armes pour résister à l’épuration et conquérir leur droit à l’autodétermination ; pour les citoyens et contribuables européens, qui n’ont pas élu Milosevic, mais Jospin, Blair, ou Schröder, le devoir était en revanche de s’opposer à cette guerre non déclarée, menée en leur nom sous la bannière de l’Otan.
La bataille au singulier exigée par Brossat se mène à sens unique, du point de vue de Dieu rebaptisé Humanité, suivant l’impératif éthique, « absolu et illimité », dont Bernard-Henri Lévy a célébré avec lyrisme les noces barbares avec la suprématie douhétiste aérienne. Il n’y a pas en réalité de bataille unique, mais des guerres combinées, où les batailles se déclinent différemment selon les lieux, les intérêts, et les positions des protagonistes. « Une » bataille était-elle nécessairement cette bataille, avec ces moyens, sous cette forme ? C’est sur ce point précis que portait le litige politique. En dépit des affirmations répétées de Madeleine Albright, on ne nous a pas convaincus que toutes les voies diplomatiques avaient été épuisées à Rambouillet ; a posteriori les révélations et les informations démontrent plutôt le contraire. On ne nous a pas convaincus davantage que le retrait des observateurs de l’OSCE à la veille des bombardements, au lieu du renforcement de leur effectif et de leurs moyens, était la façon la plus efficace de protéger les populations du Kosovo et d’éviter les massacres. Le rapport produit depuis par la même OSCE affirme au contraire dans son chapitre V sur « Le droit à la vie » : « Les tueries sommaires et arbitraires devinrent un phénomène généralisé dans tout le Kosovo avec le début de la campagne aérienne de l’Otan dans la nuit du 24 au 25 mars. Jusque-là, l’attention des forces militaires et de sécurité yougoslaves et serbes avait été dirigée sur des communautés au Kosovo dans des régions où passaient les routes de transit de l’UCK ou bien où se trouvaient des bases de l’UCK. » Embarrassé, Le Monde en est réduit à asséner sans preuves que la campagne d’atrocité « aurait eu lieu de toute façon7 ».
Pendant les bombardements, les médias sont allés jusqu’à évoquer 500 000 disparus. Jean-Pierre Pernaut informait « au conditionnel » sur TF1 que 100 000 à 500 000 personnes « auraient été tuées ». Le chiffre a ensuite été ramené à une estimation plausible de 10 000 victimes environ dont 500 à 1 000 parmi les civils serbes. Le Tribunal international a recensé très précisément 2 108 cadavres, 2 400 Albanais disparus et
1 300 détenus en Serbie. Lorsque les recherches ont été interrompues à cause de l’hiver, il évoquait une hypothèse indémontrable de 11 000 morts. C’est terrible, toujours trop, et on est gêné d’avoir à discuter cette comptabilité macabre. On y est pourtant bien obligé pour corriger la propagande fantaisiste répandue à chaud par la plupart des médias. Il y a eu guerre et guerre civile, atrocités, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Mais s’il y a eu génocide au Kosovo, comme ce fut souvent dit, alors la définition doit en être revue ! Et que dire alors du génocide bien réel en Tchétchénie ? J’attends toujours que Brossat, par souci de cohérence, réclame publiquement le bombardement de Moscou par l’Otan. À moins que le génocide tchétchène, du fait qu’il ne se déroule pas à « deux heures d’avion » de Paris, mais à quatre ou cinq heures, « ne vaille pas une bataille » ?
Dans leur tribune de Libération, Brossat et ses cosignataires, après avoir expliqué (proverbe chinois à l’appui : « Qu’importe que le bâton qui frappe le serpent soit propre ou sale, pourvu qu’il le tue ! ») que la pureté des fins éthiques justifie les moyens militaires les plus douteux, s’octroyaient une clause de sauvegarde : « Pas à n’importe quel prix, bien entendu, mais nous en sommes encore loin… » Bien entendu, et points de suspension. On ne saura jamais le « juste prix » qu’ils étaient prêts à payer. Rapporteur spécial de l’Onu pour les Droits de l’homme dans les Balkans, l’ancien dissident tchèque Jiri Dienstbier, peu suspect de complaisances « révisionnistes » envers Milosevic, estime comme nous que le compte n’y est pas : « Les bombardements ont, selon moi, provoqué beaucoup de nouvelles souffrances sans atteindre le seul objectif qui aurait pu les légitimer : assurer les conditions pour le développement d’une coexistence démocratique des divers groupes ethniques au Kosovo8. » Milosevic est toujours là. Les Kosovars n’ont toujours pas droit à l’autodétermination. Le protectorat proconsulaire va durer. L’annexion monétaire au mark allemand est consommée. Et l’avenir du Kosovo hésite entre la partition et l’indépendance mono-ethnique. En revanche, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, la guerre a servi d’alibi à la redéfinition planétaire des missions de l’Otan dans le nouveau contexte mondial. Elle a désormais vocation à intervenir partout où « nos intérêts sont menacés ». La course aux armements est relancée. L’Europe est solidement amarrée au dispositif militaire impérial. Et M. Robertson, nouveau secrétaire général de l’Otan, est heureux de pouvoir confier au Monde son « impression personnelle » sur le boucher de Grozny : « M. Poutine est ouvert, direct [le fait est !], et il ne va pas rester figé dans le passé9. »
Soutenant les bombardements de l’Otan, Alain Brossat sommait les stratèges démocrates occidentaux de débarrasser les Balkans du « régime génocidaire » de Belgrade. Sinon… Sinon, la vengeance serait terrible : « S’ils ne le font pas, nous les mépriserons et les renverrons au néant de leurs velléités et de leurs petits calculs géopolitiques. » Du fond de leur néant, Clinton, Blair, Jospin et Chirac rougissent d’un aussi méprisant mépris. Et Madeleine Albright en tremble encore.
Revue Transeuropéennes n° 18, été 2000
Repères bibliographiques
Le Sourire du Spectre. Nouvel esprit du communisme, Michalon, Paris, 2000
Qui est le Juge ? Pour en finir avec le tribunal de l’histoire, Fayard, 1999
Éloge de la Résistance à l’air du temps, Textuel, Paris, 1999
Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, Paris, 1999
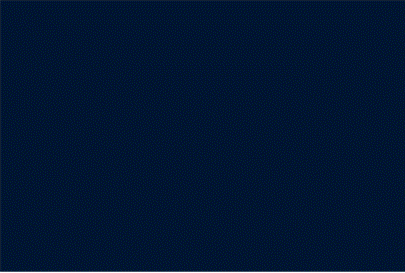
Documents joints
- Je m’en suis expliqué dans Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, Paris, 1999.
- Judiciarisation dont les tribunaux italiens donnent le plus inquiétant exemple. Voir le livre récent d’Oreste Scalzone et Paolo Persichetti, La Révolution et l’État, Dagorno, Paris, 2000.
- Daniel Bensaïd. Qui est le juge ?, Fayard, 1999.
- Ibid.
- Ibid., p. 206.
- « Ce qu’ils ne supportent pas », tribune d’Alain Brossat, Muhamedin Kullashi, Olivier Lecour Grandmaison et Jean-Yves Potel, parue dans Libération le 22 avril 1999, reprise dans le livre d’Alain Brossat et Jean-Yves Potel, Au miroir de la guerre, Éditions de l’Aube, 2000.
- Éditorial du 11 janvier 2000.
- Le Monde, 26 janvier 2000.
- Le Monde, 25 mars 2000.