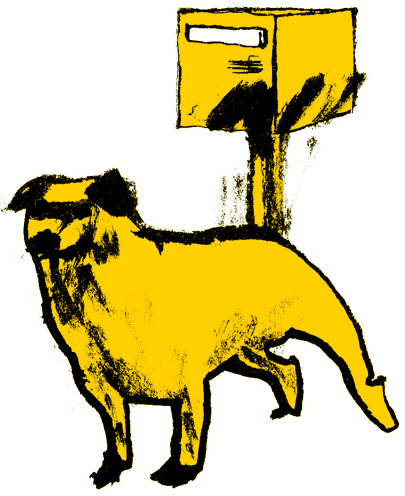
La figure de « l’intellectuel engagé » ou de « l’intellectuel de gauche » tend à s’effacer de notre paysage politique. Elle fut lourdement chargée de présupposés discutables :
1. Qu’il existât une catégorie sociale identifiable de l’intellectuel.
2. Que l’intellectuel fût libre de choisir en raison son engagement.
3. Que la gauche elle-même fût politiquement définie.
Or, la notion d’intellectuel, forgée par Brunetière dans le contexte de l’affaire Dreyfus, est historiquement située. Bien que la division entre travail intellectuel et travail manuel demeure fondatrice, elle devient aujourd’hui sociologiquement incertaine. La distinction établie par Foucault entre « intellectuel généraliste » et « intellectuel spécifique » était symptomatique de cette mutation. Le portrait dressé par Debray de « l’intellectuel terminal » (« IT ») témoigne également du doute des intellectuels quant à leur propre fonction1.
Quant à Bourdieu, il ne s’est « jamais senti justifié d’exister en tant qu’intellectuel ». Dans ses Méditations pascaliennes, il affirmait carrément détester en lui l’intellectuel, et n’envisageait de remède à ce dégoût de soi que par l’application réflexive d’une sociologie critique aux intellectuels. Au prix d’une profonde mécompréhension, il récusa l’idée de « l’intellectuel organique » en tant « qu’expression suprême de l’hypocrisie sacerdotale », dont les « intellectuels prolétaroïdes » et, au premier chef, le journaliste dilettante, étaient à ses yeux la triste illustration. Il lui opposa « l’intellectuel authentique », capable d’instaurer « une collaboration dans la séparation ». Par cette claire distribution et délimitation des rôles, Bourdieu s’enfermait dans les frontières qu’il traçait lui-même, par sanglante coupure épistémologique, entre sociologie et doxa. Il restait ainsi prisonnier de la vieille opposition entre le savant et le politique, entre la fonction de « conseiller du Prince » et celle de « confident de la providence », entre le magistère hautain et la fausse humilité au service du peuple. Dans l’un et l’autre cas, l’intellectuel se place au-dessus ou au-dessous, jamais de plain-pied avec la multitude des « incompétents » qui sont pourtant, au quotidien, les acteurs d’une politique de l’opprimé.
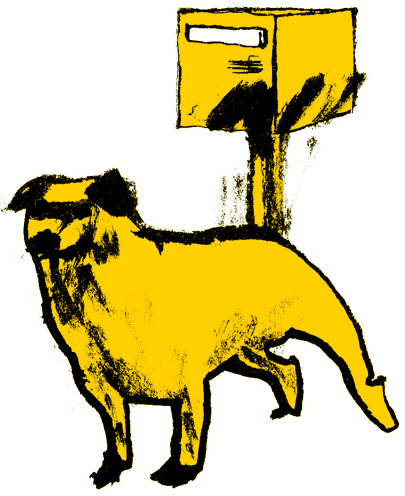 La thématique de « l’engagement » ne répond pas à ce dilemme. Breton et Blanchot manifestèrent de l’irritation devant cette notion. Le second redouta un « détournement d’influence ou d’autorité », par lequel des intellectuels mettraient au service de choix politiques et moraux une notoriété acquise au nom d’une activité spécifique. Le terme même d’engagement présupposait une extériorité originelle d’où naîtrait la décision souveraine de s’engager (de prendre part à un conflit n’impliquant pas nécessairement le sujet intellectuel). Blanchot recommandait donc à l’intellectuel de se tenir « en retrait du politique », de profiter de « cet effort d’éloignement » ou de cette « proximité qui éloigne », pour « s’installer comme un guetteur qui n’est là que pour veiller et se maintenir en éveil » ; non pour s’éloigner de la politique, mais pour s’efforcer de « maintenir cet espace de retrait et cet effort de retirement2 ».
La thématique de « l’engagement » ne répond pas à ce dilemme. Breton et Blanchot manifestèrent de l’irritation devant cette notion. Le second redouta un « détournement d’influence ou d’autorité », par lequel des intellectuels mettraient au service de choix politiques et moraux une notoriété acquise au nom d’une activité spécifique. Le terme même d’engagement présupposait une extériorité originelle d’où naîtrait la décision souveraine de s’engager (de prendre part à un conflit n’impliquant pas nécessairement le sujet intellectuel). Blanchot recommandait donc à l’intellectuel de se tenir « en retrait du politique », de profiter de « cet effort d’éloignement » ou de cette « proximité qui éloigne », pour « s’installer comme un guetteur qui n’est là que pour veiller et se maintenir en éveil » ; non pour s’éloigner de la politique, mais pour s’efforcer de « maintenir cet espace de retrait et cet effort de retirement2 ».
Intellectuel engagé ? Intellectuel guetteur et sentinelle ? C’est toujours présupposer l’intellectuel libre de choisir sa cause en toute conscience ; comme s’il n’était pas lui aussi « embarqué » à son insu, sa part de liberté consistant à penser, pour mieux s’en émanciper, les déterminations biographiques, sociales, institutionnelles, de cet embarquement. La figure même de « l’intellectuel engagé » apparaît en effet tributaire d’un contexte particulier et d’une relation tout aussi particulière entre littérature (ou théorie) et politique. Elle s’apparente à celle du « compagnon de route » (fût-il « de l’intérieur »), si impitoyablement fustigée par Dionys Mascolo3. Et par Blanchot : « Des intellectuels qui, depuis qu’ils ont reçu ce nom, n’ont rien fait d’autre que de cesser momentanément d’être ce qu’ils étaient4. » Intellectuels intermittents, défroqués du concept, intelligences pénitentes, usant tantôt de leur notoriété à des fins de propagande, tantôt abdiquant leur spécificité pour se mettre servilement au service du peuple et du parti. La méfiance de la gauche stalinisée envers ses intellectuels les a réduits à un rôle d’accompagnement subalterne ou de faire-valoir ornementaux. Si la thématique de l’engagement avait, chez Sartre, des fondements philosophiques, elle répondait aussi à une situation d’alliance inorganique et de défiance mutuelle.
Elle scellait l’échec de l’intellectuel partisan, tel qu’il avait pu exister avant 1914 dans le mouvement ouvrier (avec les Jaurès, Durkheim, Herr, Mauss, en France ; Mehring, Rosa Luxemburg, Kautsky, en Allemagne ; Pannekoek en Hollande ; Labriola, en Italie, etc.) ; puis, dans le sillage de la révolution d’Octobre et dans l’entre-deux-guerres (avec Lukacs, Gramsci, Victor Serge, Istrati, Plisnier, Daniel Guérin et tant d’autres). En France, les avatars du groupe « Philosophies » et le cas tragique de Nizan (posthumement insulté par Aragon comme archétype du traître dans la première version, sinistrement policière, des Communistes) sont emblématiques de ce rendez-vous, saboté plutôt que manqué5. La bureaucratisation et la caporalisation de la pensée par la réaction stalinienne ont suscité en retour un souci d’indépendance souvent illusoire. L’affirmation d’une coupure épistémologique, qui assurerait un partage des domaines entre théorie (où l’intellectuel exercerait sa liberté critique) et politique (où régnerait la compétence du parti) en fut une expression : à l’intellectuel, la quête des vérités éternelles ; au parti, l’administration temporelle des opinions6.
Si la question du lien problématique des intellectuels (encore faudrait-il distinguer parmi eux les créateurs – peintres, poètes, écrivains – des universitaires) à l’action politique est récurrente, la controverse à distance entre Benda et Nizan, lorsque s’obscurcissait l’horizon du siècle, apparaît comme un de ses moments fondateurs.
En 1927, dans sa Trahison des clercs, Benda, opposait à ce qu’on n’appelait pas encore « l’engagement » militant dans le siècle, la sauvegarde des « valeurs cléricales », statiques, rationnelles, et « abstraites7 ». Il dénonçait « les clercs de forum » (sophistes, journalistes, utilitaristes), ces hommes, « dont la fonction est de défendre les valeurs éternelles et désintéressées », la trahissaient « au profit d’intérêts pratiques ». Cette « trahison » était revendiquée au nom de l’histoire, du progrès, de l’écoulement, au prix d’un relativisme des valeurs. Pour Benda, le royaume du clerc n’était pourtant pas de ce monde, et les valeurs cléricales menacées n’étaient autres que le souci de la vérité contre l’opinion, de l’éternité contre les inconstances de l’histoire.
Il n’est pas difficile de reconnaître dans ce plaidoyer le discours récurrent du philosophe face au sophiste et « au réalisme de la multitude ». Les clercs, adhérant aux « passions des laïcs », se seraient mis à « faire le jeu des passions politiques ». Ils voudraient désormais que « l’utile détermine le juste » et réclamaient avec Barrès « une justice adaptée à la France ». Humiliant les « valeurs de connaissance » devant celles de l’action, ils en étaient réduits à célébrer l’instinct, l’intuition, et le désir. La cause en était que « le monde moderne a fait du clerc un citoyen », soumis à toutes les charges de ce titre. Il accompagnait désormais le réalisme des peuples au lieu de le contrarier. À l’instar du « clerc total » incarné par Socrate, le clerc authentique subirait au contraire les lois de la cité sans leur permettre de « mordre sur son âme ».
Selon Benda, l’époque souffrait encore des méfaits du romantisme qui avait incité les peuples à se vautrer dans leur passé, à chercher leurs ambitions « dans les entrailles des ancêtres », à opposer le droit de la coutume à celui de la raison, la sensibilité artistique à la sensibilité intellectuelle, Dionysos à Apollon, à faire « vibrer l’attachement à des droits historiques » remontant à l’Empire romain ou au Saint Empire germanique. La mode était venue des « graves professeurs d’esthétique belliciste », de l’esthétisation mortifère de la politique, accompagnée de l’air martial des Walkyries, de la quête dégoûtante d’enracinement dans une origine mythique, Alésia ou le Champ des Merles.
Les dernières pages de Benda étaient plus amères encore. Il en venait à se demander s’il s’agissait encore d’une simple trahison, ce qui serait un moindre mal, et non d’une disparition pure et simple : le clerc n’était plus seulement défait, il était « assimilé ». Alors qu’hier encore il honorait le bien tout en faisant le mal, et que l’absence de valeur pratique faisait l’honneur de son enseignement, il faisait à présent le mal et l’honorait avec délectation : « Le laïc a vaincu. »
C’est précisément ce que contesta Nizan, cinq ans plus tard, dans ses impitoyables Chiens de garde8. Le fétichisme clérical de Benda n’était pour lui qu’un nouvel avatar du vieux postulat spéculatif idéaliste : « la permanence des conditions de la pensée », insensibles au changement. Contre cette célébration de l’être immobile face au devenir, Nizan assumait fièrement sa propre trahison de la bourgeoisie pour l’homme, de la cléricature pour la militance. En 1932, il écrivait déjà dans l’urgence et dans le pressentiment de la catastrophe. La charge était féroce. Alors que Benda s’obstinait à juger ses pairs « du fond de l’éternité », cette Éternité n’existait pas plus que l’Universel et le Vrai majuscules. « Nous serons temporels jusqu’aux os », s’insurgeait Nizan face à la cléricature laïque qui avait pris la relève de la cléricature ecclésiastique, qui la complétait et la complémentait. Il se dressait contre cette République fragile et apeurée, contre ses fabricants de morale et ses réparateurs de l’ordre social, contre sa théologie laïque et ses « penseurs d’État ». Il y avait de l’outrance, sans doute, et de l’injustice dans ces imprécations, mais l’époque elle-même était terriblement excessive, et l’on ignorait encore à quel point.
Mieux valait donc « abattre que réfuter », « se battre que persuader », même si les combats quotidiens étaient parfois plus obscurs et douteux que l’épopée d’Octobre et les charges de la cavalerie rouge. Les clercs, dont Benda déplorait la trahison, n’étaient au fond que « des philosophes fantômes », échangeant « des coups fantômes ». Pas de regret, donc. Place à une nouvelle fidélité de classe. Il fallait devenir « une voix parmi les voix » de tous les opprimés, ce qui excluait « toutes les attitudes du clerc » et la prétention de son magistère. L’intensité et l’enjeu du combat ne laissaient plus aucune place à l’impartialité dont ils prétendaient encore se réclamer : « Les philosophes rougissent encore d’avoir à avouer qu’ils ont trahi les hommes pour la bourgeoisie. Si nous trahissons la bourgeoisie pour l’homme, ne rougissons pas d’avouer que nous sommes des traîtres. »
Si l’imminence de la catastrophe justifiait l’incandescence de ces pages, il n’en demeure pas moins qu’elles furent proférées au moment où se préparaient aussi les grandes purges staliniennes, sous prétexte de démasquer d’obscurs complots et de faire avouer des traîtres partout infiltrés. Une sinistre ruse de la déraison bureaucratique fit ainsi que Nizan devint à son tour l’objet de cette chasse aux sorcières et la victime d’un procès expéditif, dont il avait bien involontairement contribué à monter le mécanisme9.
Au-delà de l’enjeu directement politique, la controverse sur les clercs et les Chiens de garde présente un véritable enjeu intellectuel. Pour Benda, les valeurs cléricales sont universelles et statiques, aux antipodes des vérités relatives, de race, de classe ou de nation, de ce qui serait « vrai en France ». Pourfendant ses contemporains, postmodernes avant la lettre, il dénonce « la religion du particulier et le mépris de l’universel, la célébration du contingent au détriment de l’éternel, la vénération de l’individuel, la prédication du particularisme et d’un devenir réduit à “une succession d’états particuliers”, sans queue ni tête10 ». En devenant populaire, le sentiment national devenait nationaliste, populiste, chauvin, le chauvinisme n’étant que « la forme du patriotisme proprement inventée par les démocraties ». Le temps était aux « clercs nationalistes », à la poésie, plus volontiers nationale que la raison. On perçoit dans ce désespoir la nostalgie d’une République de la raison interdite aux poètes, du philosophe roi, de l’universel géométrique. L’acharnement de l’élitisme clérical à protéger la raison des passions populaires et de leur déchaînement démocratique.
L’universel est pour Benda la patrie du clerc, en butte aux assauts du viscéral et du prétendu concret. Il prévoit même l’avènement d’un universalisme frelaté, d’un universalisme du particulier, d’une « fraternité universelle qui, loin d’abolir l’esprit de nation avec ses appétits et ses orgueils en sera au contraire la forme suprême, la Nation s’appelant alors Homme et l’ennemi s’appelant Dieu ». À l’heure des guerres éthiques et des croisades humanitaires, nous y sommes presque. À la nuance près que cette Humanité annexée par les intérêts impériaux particuliers prend soin, au lieu de s’opposer à Dieu, de l’enrôler à sa cause.
Sept ans avant que Husserl n’écrive sa Crise des sciences européennes, deux ans avant le Malaise dans la civilisation de Freud, Benda jouait donc à fond la Raison contre l’Histoire ; non seulement contre l’Histoire, mais aussi contre « le rationalisme moderne » qui serait une négation de la raison, un « principe non de pensée mais d’action », avec son culte du flexible, du fluide, et du variable, au contraire d’une pensée relevant de la raison, qui est « une pensée raide » exposée au risque de la réfutation. Le dogme du concept fluide, serait in fine l’absence de concept. Car la vérité n’a pas d’histoire, et la totalité dialectique n’est pas une idée de savant, mais une idée métaphysique, le propre de la raison étant « d’immobiliser les choses dont elle traite ». Cet assaut pathétique de la logique formelle contre la raison dialectique est bien le signe de sa panique devant la débandade du rationalisme classique et le déchaînement des folies et du mythe, prophétisé jadis par Heine et dénoncé par Benjamin.
Alors que Benda, ignorant la notion d’idéologie, manifeste une foi inébranlable dans le pouvoir d’éclaircissement et de pacification de la raison, Nizan récuse au contraire l’idéalisme et l’universalisme abstraits en tant que fétiches idéologiques11. Les philosophes seraient ainsi devenus en tant que cléricature de simples agents de l’institution (de « l’appareil idéologique »). La charge est radicale : « il n’y a point de matière philosophique », mais seulement des « soupes éclectiques », servies au titre de la philosophie. Henri Lefebvre dira plus tard, et autrement, que la philosophie dépérit au profit d’un vulgaire « philosophisme » académique. Nizan se contente de constater qu’en des temps où les philosophes s’abstiennent, démissionnent, ou désertent, « la philosophie est en fuite » ; et, qu’avec elle, tombe en ruine l’orgueil de croire qu’elle puisse mener le monde (tout comme aujourd’hui les gens de médias veulent croire qu’ils fabriquent l’opinion à leur guise). Il est donc grand temps de « les mettre au pied du mur », de les sommer de se prononcer sur la guerre, sur le colonialisme, sur l’organisation du travail, sur le suicide, sur les avortements. Il n’est pas seul à lancer alors ce défi. Simone Weil, Pierre Naville, Georges Friedman (entre autres) lui font écho. Pour les deux derniers ce sera la raison d’un tournant décisif vers les sciences sociales et la sociologie du travail.
À cette épreuve, la philosophie, pour Nizan, se divise en deux. Il y a désormais celle des oppresseurs et celle des opprimés. Après l’Art pour l’Art, la Philosophie pour la Philosophie est sans nul doute du côté des premiers. Frères ennemis, Bergson et Benda communient à son enseigne. Représentant éminent de la corporation, le premier n’est que le « Théophile Gauthier de la philosophie ». Contre La Philosophie contemporaine en France de Parodi, Nizan appelle donc à « une anti-histoire de la philosophie » réduite à une pratique de « rebouteux » pour les âmes malades du malaise de la civilisation. Cette fonction hygiéniste du philosophe thérapeute revient aujourd’hui à la mode avec les philosophies des menus plaisirs et de l’art de réussir sa vie, sous la douche ou dans sa baignoire12.
Pour Benda, le rôle des clercs serait de « proclamer l’idéalité » des « valeurs abstraites ». Car, si la vie n’est pas neutre, la vérité l’est bel et bien. Il regrette ainsi la belle conception grecque qui fit de la connaissance le « type parfait de l’activité désintéressée », dieu étant plus juste que fort, sa force n’étant que la forme de sa justice. Il critique l’usage désinvolte, par des « littérateurs en vogue », d’affirmations gratuites et brillantes empruntées à la légère au domaine rigoureux de la science. Cette critique n’est pas sans évoquer des controverses récentes sur l’abus des métaphores et le vagabondage conceptuel entre des savoirs différents, au risque de constituer une rhétorique méta-philosophique, réduite à des jeux de langage et dégagée de toute responsabilité envers des objets spécifiques (ou la « logique de la chose »).
Mais Benda va plus loin, jusqu’à libérer un souci de vérité pure de toute servitude prosaïque. La science ne serait une valeur cléricale que « dans la mesure où elle cherche la vérité hors de toute considération pratique ». Axiologiquement neutre, ni française ni allemande, elle n’aurait ainsi à servir ni la paix ni la guerre. Cet attachement désespéré à la neutralité de la science apparaît bien dérisoire en un temps où se préparent le zyklon B et la bombe atomique, où se mettent en place les dispositifs d’un complexe militaro-scientifico-industriel promis à un prospère avenir. Il n’en a pas moins valeur d’avertissement contre les tentations d’annexion des vérités scientifiques, si relatives et provisoires soient-elles, aux présupposés idéologiques, illustrées par la désastreuse affaire Lyssenko.
Nizan admet lui aussi la possibilité d’une « logique générale », « purement cléricale », qui ne concernerait pas la philosophie ou la sagesse humaine. Il retient l’hypothèse de « pensées techniques sur lesquelles les savants seuls auraient leur mot à dire ». Quand un chimiste invente un explosif, il ne trahit pas la chimie. Nizan reste ici fidèle à l’héritage de Weber et de Poincaré, dont il reprend presque mot à mot la formule : « Pas question de tirer de la science des impératifs qu’elle ne saurait donner. » Mais il existe une « seconde philosophie » qui ne « se contente pas de formuler des jugements d’existence », mais « prétend exprimer des volontés » : « Les sciences fournissent la mesure des actions possibles, mais il n’y a point de passage rigoureux de la science qui ne veut rien d’autre que son propre mouvement, à cette philosophie ambitieuse toujours censée vouloir quelque chose. » La responsabilité et la liberté résident dans ce passage périlleux. Nizan ne fait donc pas le procès de la pensée scientifique attachée à des domaines spécifiques, mais celui de sa « généralisation imprudente, conduisant à l’illusion d’une raison éternelle ».
L’opposition entre Benda et Nizan débouche sur la querelle de l’engagement. Le premier récuse une démarche intellectuelle où tout s’évaluerait en termes d’histoire et de situation. Il pressent, dans la volonté de ne vivre qu’en situation, de servir une justice concrète et une vérité historique, de « s’engager dans le présent », la possibilité d’une dérive relativiste. À vouloir à tout prix « prendre position dans l’actuel en tant qu’actuel », la pensée s’avilit, acceptant de boxer dans « une échauffourée de carrefour » : « Le rôle du clerc n’est pas de changer le monde, mais de rester fidèle à un idéal », de descendre sur la place publique pour y défendre des intérêts de classe, de race, ou de nation, mais de veiller comme « officiant de justice » sur des valeurs et des idéalités. Il justifie ainsi son engagement dans l’affaire Dreyfus par le fait que de telles valeurs universelles, et non des intérêts particuliers, y étaient précisément en jeu. Le déchiffrement de l’universel dans le particulier demeure cependant un exercice incertain. Ainsi, la justice abstraite de Benda ne l’empêcha pas de fermer lui aussi les yeux sur les procès de Moscou, et sa prétention à l’universel abstrait de céder à la « laïcisation des clercs » en donnant dans le patriotisme tricolore. Infidèle à l’état clérical, il devient alors le « clerc casqué », impitoyablement débusqué par Jean Malaquais : « Ce « régulier dans le siècle » sera irrégulier jusque dans son âme, tout en appelant traîtres ses confrères dont beaucoup n’avaient jamais prétendu au sublime désintéressement […]. Entre plongé tout entier dans le bain et prétendre ne point y être, c’est la suprême tromperie13. »
Le désaccord de Nizan est catégorique : « Le type vers lequel tend le philosophe des exploités est celui du révolutionnaire professionnel. » Il s’oppose « aussi brutalement qu’il peut au clerc contemplatif » pour s’identifier pleinement « à la classe qui porte la révolution ». Le cœur du différend est là. Pour Nizan (comme pour Trotski face à Dewey) il n’y a pas, dans le monde historique et social, d’universalité pure, pas d’universel concret sans médiations. Et la médiation de l’époque est celle de la lutte des classes. Faute d’un « commerce pratique avec les institutions du prolétariat », le clerc serait ainsi condamné à se muer soit en chien de garde, soit en « technicien de la révolution », en « homme de parti », « spécialiste des exigences et indignations des exploités ». Nulle place n’est plus laissée à « l’impartialité des clercs ». Entre deux complicités, il faut choisir. Entre la bourgeoisie et le prolétariat, « le philosophe prendra ouvertement parti ». Non pas sournoisement, honteusement, à mi-voix, mais « ouvertement », en annonçant sa couleur, en s’exposant au grand jour, là où il y a « des coups à prendre et des coups à porter ». La colère, l’enragement de Nizan concentre les passions et les contradictions d’une époque. Lucide devant la montée des périls, pressé par la barbarie sur ses talons, il s’exaspère d’un monde qui s’enveloppe frileusement de peur et de médiocrité. « Tout se joue, dit-il, entre la bourgeoisie et le prolétariat, l’impérialisme et la révolution. » La brutalité de la crise simplifie certes les lignes. Il faut choisir son camp, sans réserves, selon l’implacable logique binaire du tiers exclu. L’urgence a ses propres lois. Mais cette exigence de troquer, comme le fit Marx, l’épingle de la polémique intellectuelle pour la massue de la lutte des classes, et de philosopher à coup de marteau, ne rencontre pas la révolution prolétarienne espérée mais sa contrefaçon.
Au même moment survient en effet le troisième larron bureaucratique imprévu ; paré du masque révolutionnaire pour compliquer le jeu. La « troisième période » de l’Internationale communiste, celle de la rhétorique radicale, « classe contre classe », est en effet celle aussi de la collectivisation forcée et de l’industrialisation à coup de knout, celle des purges et des procès, celle des intellectuels procureurs, dont Nizan sera victime. Dès 1930, le congrès de Kharkov aurait dû donner l’alerte. Rares furent, il est vrai, les intellectuels qui surent résister à l’injonction de choisir son camp et au chantage du moindre mal ; rares ceux qui eurent le courage de se battre à double front, au risque d’une tragique solitude : Naville, Péret, Rousset, Serge, Plisnier. Et quelques autres.
Transposant dans le champ littéraire et théorique, sans précaution ni médiation, cette ligne générale « classe contre classe », Nizan perçut bien avec lucidité les trajectoires idéologiques de Heidegger, Céline, ou Drieu, mais, par une sorte de campisme idéologique il épousa la cause de l’Union soviétique comme incarnation du communisme réel, au moment même où se déchaînait la réaction stalinienne, ainsi qu’en témoigne sa lettre de mai-juin 1934 à l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires, lui donnant pour mission de « lutter contre toutes les idéologies oppositionnelles : trotskisme, souvarinisme », et de « démasquer les représentants de ces idéologies14 ». Alors que Staline est à ses yeux le défenseur exemplaire des progrès de l’individu, il traque impitoyablement « l’oppositionnel » chez Victor Serge, chez Panaït Istrati ou chez les surréalistes.
Suivant les zigzags de la politique bureaucratique, Politzer qui écrivit en 1925 la Critique des fondements de la psychologie, écrivit en 1939 un article en forme de verdict sur La Fin de la psychanalyse, accusée d’apporter de l’eau au moulin de l’irrationalisme15. Lui, qui avait publié en 1929 La Fin d’une parade philosophique, célébrait en 1937 le tricentenaire du Discours de la méthode : « Notre Parti a ainsi pris nettement la tête de la célébration du tricentenaire du Discours16 .» À l’époque de l’alliance subalterne avec la bourgeoisie républicaine, et des Fronts populaires en philosophie comme en politique, Descartes, c’était déjà la France ! Avec le VIIe congrès de l’Internationale communiste et le tournant vers les Fronts populaires, le ton de Nizan lui-même changea. Il traita alors avec plus de mesure Benda, aux côtés duquel il intervint dans le cadre du Ier Congrès international des intellectuels pour la défense de la culture – on notera le glissement sémantique par rapport à l’Association des écrivains révolutionnaires. Dans son intervention sur l’humanisme, il opposait encore un « humanisme historique » à l’humanisme abstrait et à l’acception univoque de l’hellénisme de la part du « penseur éléatique » (Benda) qui l’avait précédé à la tribune, mais le dialogue était renoué sur un registre assez différent de la condamnation sans appel de « l’humanisme toujours bourgeois », émise en 1932 dans une critique des Propos d’Alain sur l’éducation17.
À la différence d’Aragon, apologue un jour de la Guépéou et fusilleur « troisième période » des « sociaux-traîtres » – « Feu sur Léon Blum ! Feu sur Paul Boncour ! Feu sur les ours savants de la social-démocratie ! » –, barde le lendemain de la Diane française, saluant un jour le pacte germano-soviétique qui « a fait reculer la guerre » et chantant le surlendemain le « conscrit des cent villages », girouette au gré des vents, Nizan n’avait pas l’échine assez souple pour se plier à ces méandres bureaucratiques. Le pacte germano-soviétique de 1939 fut le tournant de trop. Il eut alors le courage de rompre, au risque de se briser. Il devança par la démission une probable exclusion. Le Parti s’est vengé par une calomnie durable et une réhabilitation tardive et réticente.
Nizan s’est débattu dans la tension féconde qu’il avait cru dénouer, entre le scrupule théorique et esthétique de l’écrivain et la détermination nécessaire du militant, entre sa conscience personnelle et l’autorité impersonnelle du Parti. Soustraite à l’épreuve de la pratique, la vérité de l’intellectuel « éléatique » devient doctrinaire et son champ théorique se referme ; inversement, renonçant à une visée de vérité, l’intelligence partisane dégénère en propagande sans scrupule. Entre les deux, Nizan a cheminé jusqu’à trébucher sur une étroite ligne de crête. Sa tragédie est emblématique de bien des tragédies militantes dans le siècle.
Bien des lecteurs ont eu les yeux brûlés à la lecture d’Aden Arabie ou des Chiens de garde. Souhaitons que, de cette brûlure, il nous reste autre chose que cendre.
Contretemps n° 15, février 2006
www.danielbensaid.org
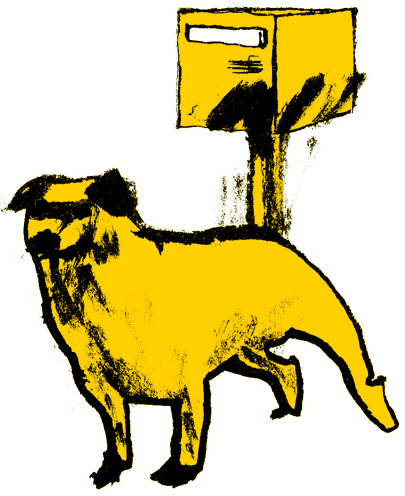
Documents joints
- Regis Debray, IF, Paris, Gallimard, 2000. Le succès des sciences humaines au cours des années 1960 aurait accéléré la métamorphose de l’IO (intellectuel originaire) en IT. Le chercheur en sciences humaines aurait alors soufflé le premier rôle aux littéraires qui l’occupaient depuis l’affaire Dreyfus : « Un sérail en a effacé un autre. » L’intellectuel nouveau serait désormais un « hors-classe », une « présence en ville », un « publiciste infatigable », un intellectuel originaire « suradapté à un milieu de communication », un « gentilhomme de la société d’opinion » en proie à « la frénésie de juger ». Or, « nul ne pouvant sauter par-dessus son temps, chacun a un taux d’IT particulier ». L’hommage incidemment rendu aux trotskistes a le ton d’une oraison funèbre : « Sauf exception notable (comme les trotskistes réfractaires impavides dont la noblesse morale survit au défraîchi des idées), l’IF [intellectuel français] a toujours eu le soin d’adosser sa critique spirituelle à la puissance matérielle » (p. 132). À la différence de Jacques Attali qui épousa résolument la fonction de conseiller du Prince, Debray lui-même n’a cessé d’osciller entre la tentation de ce rôle et celui distancié de confident de la providence.
- Maurice Blanchot, Les Intellectuels en question, Paris, Fourbis, 1996.
- Dans sa Lettre polonaise publiée en 1957 après un voyage en Pologne, Mascolo reprochait « la plus coupable des innocences » au « sombre cas du sympathisant ». Les « pires produits du stalinisme », ajoutait-il, ces « sympathisants risquent d’être les derniers déstalinisés, bien après les staliniens endurcis ». Et « les sartriens » n’étaient à ses yeux qu’une « espèce particulière de ceux que l’on nomme sympathisants » (cette Lettre polonaise est reprise dans A la recherche d’un communisme de pensée, Fourbis 1993, où l’on pourra lire aussi l’intéressante réponse « Contre les idéologies de la mauvaise conscience », publiée en 1970 dans la Quinzaine littéraire, en réaction à un article de Bernard Pingaud et à une interview de Sartre parue dans L’Idiot international).
- Maurice Blanchot, Les Intellectuels en question, op. cit.
- Voir Bud Burkhard, French Marxism between the Wars. Henri Lefebvre and the « Philosophies », New York, Humanity Books, 2000. Le groupe « Philosophies » comprenait notamment entre 1929 et 1934 Henri Lefebvre, Paul Nizan, Georges Politzer et Georges Friedman, tous membres du Parti communiste. Les épreuves de l’époque n’ont pas tardé à le disperser, Politzer assumant un triste rôle de commissaire politique contre Friedman et Nizan, tandis que Lefebvre poursuivait son travail de franc-tireur. Le sort parallèle du groupe surréaliste adhérant au Parti communiste autour de Breton confirme ces rapports difficiles entre les intellectuels révolutionnaires et le parti du prolétariat en voie de stalinisation. Un scénario analogue devait se reproduire à l’époque de la guerre froide avec le départ du parti de nombreux intellectuels sous le choc des révélations du rapport Khrouchtchev et de l’intervention soviétique en Hongrie.
- La méfiance envers les intellectuels cooptés par l’université ou les distinctions parlementaires vient de loin dans le mouvement ouvrier français. Voir à ce sujet la conférence de Paul Lafargue en 1900 sur « Le socialisme et les intellectuels » (réédition, Paris, Les Bons caractères, 2004).
- Julien Benda, La Trahison des clercs, 1927, réédition, Grasset, « Cahiers rouges », 2003.
- Paul Nizan, Les Chiens de garde, 1932, réédition, Marseille, Agone, 1998.
- Voir Aragon, Les Communistes.
- Rappelons la polémique symétrique menée presque la même année (en 1929 précisément) par Politzer dans son pamphlet contre le bergsonisme, son culte du « vécu concret » et de l’intuition, afin de donner « un peu d’animation au concret en général ». Il ne s’agissait pas en réalité de s’installer dans l’individuel concret, mais seulement « d’individualiser les produits du formalisme ». Car, ce qui existe en dehors de la nature, ce sont des « relations dramatiques » sociales. (Voir Georges Politzer, La Fin d’une parade philosophique : le bergsonisme, Paris 1929, réédition, J.-J.Pauvert, 1967.)
- Le concept d’idéologie, en dépit de la critique lukacsienne de la réification dans Histoire et conscience de classe, est alors encore peu travaillé, des pans entiers de l’œuvre de Marx, en particulier L’Idéologie allemande et les Manuscrits de 1857-1858 étant encore inaccessibles.
- Voir le cinglant article de Jacques Rancière in Chroniques des temps de consensus, Paris, Seuil, 2005.
- Jean Malaquais, « Julien Benda et la justice abstraite », <em>in</em> <em>Cahiers du Sud</em>, no 225, juin 1940, republié dans la revue <em>Agone</em> n° 23, mars 2000.
- Voir Paul Nizan, Articles littéraires et politiques, Paris, Joseph K, 2005, p. 299.
- La Pensée, novembre 1939 : « Certes, il y a eu des déclamations nazies contre la psychanalyse. Il n’en est pas moins vrai que la psychanalyse et les psychanalystes ont fourni pas mal de thèmes aux théoriciens nazis, en premier lieu celui de l’inconscient. »
- G. Politzer. « Le tricentenaire du Discours de la méthode », La Correspondance internationale n° 23, 1937.
- Paul Nizan, « Sur l’humanisme », Articles littéraires et politiques, op. cit., p. 508.