Nicole Lapierre

Daniel Bensaïd fut longtemps réticent à l’idée d’écrire un ouvrage autobiographique. Nous en avons discuté plus d’une fois. Je tentais de le convaincre qu’il y avait une nécessité de transmission entre les générations militantes, que l’expérience des uns devait être racontée aux autres, libre à ceux-ci ensuite d’y puiser ce qui leur faisait signe. Il opposait le droit à l’intime, brocardait la valse des ego, se méfiait de l’illusion biographique et, une fois, asséna : « Une autobiographie, c’est déjà un livre posthume. » L’argument, évidemment, frappait comme un interdit. En 2004 pourtant, il a écrit Une lente impatience, un témoignage plutôt qu’une autobiographie, tenait-il à préciser. Et surtout un livre vivant, personnel, alternant le « je » et le « nous », les souvenirs singuliers et les expériences partagées, pour raconter une révolte obstinée qui avait dû apprendre la durée. Après ce livre-là, il y en eu d’autres, dans une écriture de l’urgence et peut-être du sauve-qui-peut la vie.
Ferme dans ses fidélités et ses convictions, Daniel était le contraire d’un austère et si la politique tenait une place centrale dans son existence, elle ne le dévorait pas pour autant. Espiègle et bon vivant, séducteur et élégant, il pouvait passer de la Critique de la faculté de juger de Kant à la lecture de L’équipe, goûter la poésie comme la saveur d’un Côte rôti, parler vélo, voyages, polars ou cinéma, s’enchanter de l’atmosphère d’un marché comme de la douceur d’un paysage. Curieux, attentif, gourmand, il se montrait volontiers friand d’anecdotes sur la vie de ses amis, lui qui, pudique et secret, esquivait souvent les questions indiscrètes d’un « quoi ? » sonore et rigolard. Car il faisait partie de l’espèce des chaleureux qui, sous la jovialité, se livrent peu en réalité. Ainsi de cette maladie qui n’était ni cachée, ni nommée, comme pour mieux ruser avec elle. Il avait appris qu’il était atteint du sida en 1990. Le matin du 12 janvier 2010 la mort, qu’il trompait depuis plus de vingt ans, l’a finalement rattrapé.
On chantait rouge

Son histoire, celle qu’il aimait raconter, commence dans le bistro familial le Bar des Amis, à la sortie de Toulouse, sur la route de Narbonne. Daniel est né le 25 mars 1946 dans la ville rose et dans un milieu qui « chantait rouge ». Côté maternel, dans le panthéon familial, trônait le grand-père Hippolyte, communard à 14 ans. Chaque premier dimanche de mai, sous un portrait de Jean-Baptiste Clément accroché dans la salle à manger, la famille entonnait en chœur avec lui Le Temps des cerises. Il y avait aussi l’oncle Alfred, gazé dans les tranchées, qui s’était déclaré communiste dès le congrès de Tours pour « ne plus jamais voir ça ». Cadette de trois enfants, Marthe, sa mère, avait été placée comme apprentie modiste. En 1931, à sa majorité, devenue « première ouvrière » et désireuse de découvrir le monde, elle était partie travailler à Oran. Le voyage s’est arrêté là, avec la rencontre de celui qui allait devenir son mari. Haïm Bensaïd, issu d’une famille juive pauvre de Mascara, était garçon de café pour vivre et boxeur pour tenter d’en sortir. Elle brava les préjugés pour l’épouser, il raccrocha les gants, leur premier enfant, une fille, naquit en 1934.
Les temps s’annonçaient sombres. Fait prisonnier pendant la Drôle de guerre, Haïm s’évada et ils achetèrent le bar toulousain grâce à un prête-nom. Arrêté sur dénonciation par la Gestapo en décembre 1943 et envoyé à Drancy, il fut sauvé par les démarches obstinées de Marthe. Ainsi échappa-t-il à la déportation, contrairement à ses deux frères qui n’en sont pas revenus.
Par la suite, au Bar des Amis, si quelqu’un se risquait à la moindre réflexion sur les Juifs, le père de Daniel sortait l’étoile jaune du tiroir-caisse et la plaquait sans un mot sur le comptoir. Dans cette famille, le judaïsme était ténu, ni croyance, ni fêtes, ni rituels, mais il restait une fidélité têtue à la mémoire des persécutés, associée à une fierté belliqueuse face à toute manifestation d’antisémitisme. Marthe, qui s’identifiait volontiers à ce destin-là, n’était pas la moins vindicative. C’était une forte femme, combative, peu portée à « s’écouter », mais émotive aussi, parfois jusqu’aux larmes quand elle lisait à son fils un passage de Sans famille ou des Misérables.
Le bistro était fréquenté par une clientèle populaire d’habitués. Le matin, à l’heure du casse-croûte ou le soir à l’heure de l’apéro, réfugiés espagnols, antifascistes italiens ouvriers de l’Onia (la future AZF), maçons portugais, postiers, cheminots ou petits commerçants se retrouvaient. La cellule communiste du quartier y tenait ses réunions annuelles de remise des cartes. Le dimanche, on chantait au son de l’accordéon. Entre la cuisine familiale et la salle, la porte était toujours ouverte. « Le comptoir du bistro fut ma première école et mon premier observatoire sociologique » note Daniel. Récits des misères ordinaires, souvenirs des résistances du Sud, répertoire savoureux et échanges festifs, enfant, il n’en perdait pas une miette. Ce monde de socialisation première, qu’il se plaît à évoquer, a la couleur des vieux films, à mi-chemin entre le néoréalisme italien et le cinéma de Carné et Prévert.
Bien plus tard, il aura ses habitudes et donnera ses rendez-vous au Charbon, près de chez lui rue Oberkampf, un néobistro plus branché que le Bar des Amis, une atmosphère très parisienne, mais des bruits de verres et des effluves de comptoir, comme une réminiscence.
De la communale aux colos
L’autre école, structurante, fut celle de la République. Daniel dit l’avoir adoré sans réserves et n’en avoir gardé que de bons souvenirs. Des leçons de choses aux sentences d’instruction civique, des plumes sergent-major trempées dans l’encre violette au crissement de la craie sur le tableau noir, de l’instit sévère mais juste à « l’atmosphère Grand Meaulnes des cours de récré », il décrit la communale d’autrefois moitié chromo, moitié promesse. Il a, de même, aimé les colos de la CGT où il passait six semaines l’été et le lycée où les esprits s’échauffaient entre littérature, poésie et politique.

En juin 1960, quand son père est mort d’un cancer, il terminait sa quatrième. De cette perte précoce, il n’a jamais beaucoup parlé. Ce père avait « l’émotion discrète », le fils aussi.
C’était l’époque de la guerre d’Algérie, du coup d’État gaulliste, des barricades d’Alger, des attentats de l’OAS, les « événements » divisaient les élèves en deux camps. Son meilleur ami, Bernard Tauber, fils d’un médecin juif communiste et résistant dont la maison fut plastiquée par l’OAS en 1961 et Annette, fille de communistes également, dont il était épris depuis la cinquième, entreprirent sa formation politique. Les discussions étaient sérieuses, fiévreuses, entre balades à bicyclette, rencontres avec Armand Gatti, longues soirées enfumées à parler de Cuba ou de cinéma. Au lendemain de la répression de Charonne, ils créèrent ensemble un cercle des Jeunesses communistes au lycée Bellevue.
Tel fut le début d’un engagement qui continua en classe préparatoire au lycée Pierre-de-Fermat où il entra à l’automne 1964.
Les nouveaux conjurés
Sur fond de conflit sino-soviétique, de Déclaration de La Havane et de Discours d’Alger, tandis que brillait l’étoile du Che, le tiers-mondisme faisait vibrer la quarantaine de membres de leur cercle de khâgneux.
Loin de Paris et des débats de l’Union des étudiants communistes (UEC) – dont Gérard de Verbizier leur rapportait la teneur –, ils n’étaient déjà plus tout à fait dans la ligne du parti et posaient quelques questions dérangeantes. Tauber revint du congrès de l’UEC du printemps 1965 convaincu par l’Opposition de gauche. Henri Weber descendit à la Toussaint leur parler du stalinisme. L’exclusion se profilait. Elle fut effective au congrès suivant et dans la foulée fut créée la Jeunesse communiste révolutionnaire.
Le groupe, dont plusieurs initiateurs étaient liés à la IVe Internationale, « comptait deux cents conjurés à peine », le plus âgé, Alain Krivine, avait 27 ans. Daniel Bensaïd, lui, avait tout juste 20 ans et se sentait un peu en porte-à-faux, non pas à l’égard des bureaucrates du parti, mais vis-à-vis des communistes du Bar des Amis ou de son cousin Jean, ouvrier cégétiste : ceux qui pouvaient penser que, devenu étudiant, il avait changé de camp.
Ce même printemps, il était admissible puis admis au concours de l’ENS de Saint-Cloud, en Lettres modernes. À l’automne 1966, il quittait sans joie Toulouse dont, comme une sorte de talisman, il a toujours gardé intact l’accent.

L’arrivée du provincial à Paris, avec sa malle et son malaise, est un cliché, avec un fond de vrai sans doute. Daniel raconte ne pas avoir aimé cette première année, l’atmosphère engoncée, l’étouffant vase clos de l’École où communistes et maoïstes rivalisaient de formules dogmatiques, l’exaltation sous cloche de ses condisciples.
L’un d’eux, pourtant, était différent, Camille Scalabrino, un rouquin filiforme et volubile venu de Besançon, sartrien déclaré et amateur passionné du cinéma de Bergman. À la faculté de Nanterre, en philo, on voyait débarquer ce drôle de duo, Scala et ses tonitruants « Vains Dieux ! », Bensa et ses « Boudiou ! » facétieux.
L’embrasement 68
La vraie vie se passait en dehors de l’École, dans cette université située entre bidonvilles et terrains vagues d’où étaient régulièrement chassés les fascistes d’Occident, les manifestations contre la guerre du Vietnam, les débats de l’Unef et les nombreuses réunions de la JCR. La rentrée suivante fut marquée par la mort du Che en Bolivie. En Italie, en Allemagne et ailleurs, le mouvement étudiant prenait de l’ampleur, le fond de l’air était internationaliste et solidaire contre l’impérialisme.
Le 21 mars, Xavier Langlade, militant de la JCR à Nanterre, fut arrêté lors d’une manifestation contre le siège d’American Express. Le lendemain, à la fac, la protestation enfla jusqu’à l’occupation de la salle du conseil du doyen, le mouvement du 22 mars était lancé. La pression monta en avril, Martin Luther King fut assassiné à Memphis, Rudi Dutschke fut victime d’un attentat à Berlin. Manifestations et meetings se sont multipliés jusqu’à l’embrasement et la grève générale des mois de mai et juin.

La chronologie des événements de Mai a été maintes fois racontée. Daniel, comme beaucoup d’autres, a vécu ce mois effervescent au jour le jour, courant de manif en réunion « dans une confusion comparable à celle de Fabrice à Waterloo » dit-il, non sans auto-ironie. On connaît aussi l’épilogue. Fin juin la JCR et d’autres organisations furent dissoutes et plusieurs dirigeants, dont Alain Krivine, se retrouvèrent à la prison de la Santé.
Daniel Bensaïd et Henri Weber, cachés chez Marguerite Duras rue Saint Benoît, écrivaient à chaud et marche forcée un livre sur les événements, promis à François Maspero. Son titre, Mai 68, une répétition générale, dit l’état d’esprit d’alors, quand la révolution semblait se préparer et qu’un célèbre mot d’ordre appelait à « créer un, deux, trois, plusieurs Vietnam ! ».
Dans la foulée, Daniel qui avait proposé comme sujet de maîtrise « La notion de crise révolutionnaire chez Lénine 1» au très compréhensif Henri Lefebvre (il avait également accepté ma « Théorie léniniste de l’organisation »…) lui remettait son mémoire. Un salmigondis d’époque, d’inspiration lukacsienne, mâtiné de Freud, de Lacan, de Greimas, mais révélateur néanmoins : contre le règne althussérien des structures objectives, il réhabilitait le rôle subjectif de l’avant-garde consciente.
Soleil et cendres
La question du rapport entre avant-garde et parti de masse était classique et récurrente. Il me semble qu’elle n’a jamais été seulement théorique pour Daniel et qu’au fond de lui, il vivait une tension entre la nostalgie de l’univers populaire du PC qui avait entouré sa jeunesse toulousaine et la tentation de l’accélération gauchiste. Celle qu’il défendit dans un texte préparatoire au troisième congrès de la Ligue communiste (le bulletin intérieur ou BI 30 2) intitulé « Le problème du pouvoir est posé ? Posons-nous le ! » C’était pour le moins prématuré.
Les signes allaient, durement, dans le sens du reflux ici, de la répression ailleurs. En février 1972, le militant maoïste Pierre Overney était abattu par un vigile devant Renault-Billancourt, ses obsèques « furent une sorte d’apothéose mélancolique et d’adieu aux illusions lyriques ». Le 21 juin de l’année suivante, après une manifestation violente contre un meeting raciste d’Ordre nouveau à la Mutualité, la Ligue fut dissoute. Elle ne disparut certes pas pour autant et les risques pris étaient sans commune mesure avec ce qui se passait en Amérique latine.

En septembre 1973, le coup d’État de Pinochet fracassait bien des espoirs. Le mois suivant, Daniel débarquait à Buenos Aires, envoyé défendre la position majoritaire de la IVe Internationale en faveur de la lutte armée. La fuite en avant de ces petits groupes de militants armés jetés dans la clandestinité fut une tragédie, bien peu échappèrent à la torture et à la mort. Erreurs et douleurs de l’Argentine lui ont laissé un goût de cendres. Et aussi, dit-il, un sentiment de dette à l’égard des vaincus « qui dicte l’impératif de continuer, de ne pas renoncer au moindre bobo, de ne pas céder au premier coup de vague à l’âme.»
Continuer, oui, mais avec quelle stratégie ? Les résultats de la candidature d’Alain Krivine et de la campagne électorale de 1974 furent décevants et si le lancement de Rouge quotidien dans la foulée galvanisa les énergies, son arrêt faute de moyens, en janvier 1979, marqua la fin d’une époque.
« L’histoire nous mord la nuque » avait un jour lancé Daniel, la formule avait fait florès, elle n’était plus de circonstance. En France comme en Europe, « au seuil des années 1980, il était clair que la lutte finale n’était pas pour demain, ni même pour après-demain. » Ailleurs, toutefois, des perspectives semblaient se dessiner : au sortir de la dictature, entre luttes syndicales, grèves ouvrières, révoltes agraires et agitation étudiante, un mouvement se déployait au Brésil. De 1980 à 1990, entre ses cours à l’université de Saint-Denis, l’édition mensuelle d’Inprecor (la revue de la IVe Internationale) et les réunions de la direction de la « Quatre » à Bruxelles, Daniel y fit deux à trois séjours par an. Il y retrouvait les camarades du groupe Démocratie socialiste qui publiaient le journal Em Tempo. Autant ses souvenirs de l’Argentine étaient crépusculaires, autant ceux de Rio, de Belo Horizonte et de Porto Alegre étaient solaires.
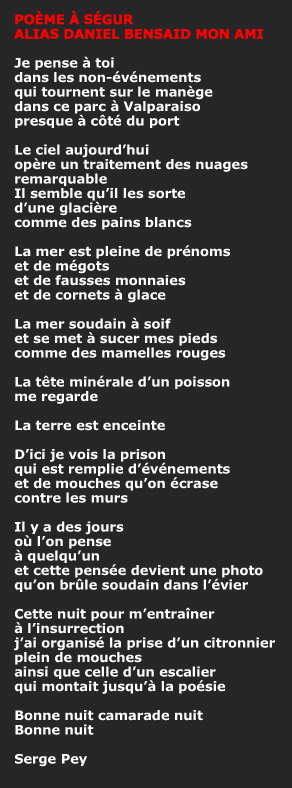
Il raconte avec jubilation comment il a passé « des heures et des jours à palabrer avec des groupes minuscules, émergeant péniblement de leur hibernation dictatoriale et à suivre l’éclosion prometteuse du Parti des travailleurs. » Là, un parti de masse naissait, des possibles s’ouvraient, vastes comme ce pays continent dont il aimait les musiques et les saveurs, où il a noué de solides amitiés, mais où, longtemps, il n’a pu retourner.
La lente impatience
Le début de la décennie suivante fut assombri par l’annonce de sa maladie. L’époque, en Europe, n’était pas non plus à l’embellie. Le capitalisme prétendait régner sans partage tandis que le socialisme semblait disqualifié. Daniel vécut dès lors dans une tension paradoxale des temps dont il fit une discordance créative.
D’un côté, le sida qui menaçait d’abréger sa vie : « Se savoir mortel est une chose. Une autre est d’en faire l’expérience et d’y croire pour de bon. Les proportions et les perspectives temporelles s’en trouvent modifiées. Les spéculations sur le lointain deviennent futiles. Le présent revêt au contraire de nouveaux reliefs. Il atteint à une sorte de plénitude. On cherche à vivre dans l’instant, selon l’inspiration et l’envie. »
De l’autre, les vents contraires et l’évidence qu’il s’agissait désormais de sauver l’essentiel, les idées de socialisme et de révolution, menacées par la débâcle du stalinisme. Il importait, pensait-il, de tenir, de savoir attendre, de continuer à militer, quand nombreux étaient ceux qui s’éloignaient ou renonçaient.
D’un côté, la morsure de l’urgence et le court terme menaçant, de l’autre, la lente impatience, la conscience qu’il fallait apprendre la durée, réinventer l’espérance, parier sur l’incertitude des possibles.
Apprendre la durée, c’était renouer avec une certaine tradition juive attachée à la mémoire des vaincus et fidèle aux espérances des perdants. Une tradition atypique, hétérodoxe, dont les hautes figures conjuguaient révolte hérétique et rationalité messianique. Contre le prétendu sens de l’histoire qui noyait toute véritable responsabilité dans son temps mécanique et vide, il fallait affronter l’incertitude, penser l’effraction de l’événement, assumer l’inquiétude du présent et l’obligation contractée à l’égard des attentes du passé.
Ce fut la rencontre de Walter Benjamin et, avec lui, de toute une constellation, de Blanqui à Péguy (ce dernier retrouvé après les lointaines lectures conseillées par le professeur de français maurassien qui l’avait pris en affection), puis de Péguy à Sorel et à Bernard Lazare. Puisque l’horizon était plombé, il fallait prendre la liberté de chercher sur des voies de traverses, sur la « piste marrane » ou celle des hérésies populaires derrière l’insoumission de Jeanne.

En trois ans, dans un moment de bascule douloureux, il écrivit trois livres profondément originaux et inspirés. Deux d’entre eux étaient consacrés à des figures féminines rebelles, la Révolution incarnée en verte bicentenaire au verbe intransigeant (Moi, la Révolution. Remembrances d’une bicentenaire indigne, 1989) et Jeanne, la pucelle indocile (Jeanne, de guerre lasse en 1991) autour de laquelle rôde la mort. Textes magnifiques, un peu ventriloques sans doute, comme le troisième, à l’unisson de Walter Benjamin, de son écriture fragmentaire, de ses fulgurances et de son sens du tragique (Walter Benjamin, sentinelle messianique, 1990).
Une lecture déniaisée de Marx
Sauver les idées, c’était d’abord et avant tout revisiter Marx, le sortir de la gangue doctrinaire qui l’avait fossilisé, l’extraire de la vulgate et des innombrables commentaires, revenir aux textes et interroger leur actualité. Pendant plusieurs années, avec un groupe d’étudiants assidus de Paris VIII, Daniel a relu et analysé Le Capital, les Grundrisse et les Théories sur la plus-value, accumulant quantité de notes dans de gros cahiers cartonnés.
Cette « lecture déniaisée de Marx » a abouti, en 1995, à deux livres importants La Discordance des temps et Marx l’intempestif. Chez l’auteur du Capital, il aimait que « l’ordre du concept s’incorpore à l’ordre charnel du combat » avec ses choix raisonnés misant sur l’ouverture des possibles. Il n’a cessé d’y revenir, obstinément, de livre en livre, avec Le Pari mélancolique en 1997, l’Éloge de la résistance à l’air du temps en 1998 et bien d’autres encore, un chaque année, voire deux, n’hésitant pas à changer de forme, comme dans le savoureux Résistances. Essai de taupologie générale, illustré par Wiaz ou encore le pédagogique Marx, mode d’emploi, illustré par Charb.

On le voyait parfois affaibli et las, mais il poursuivait entêté, attachant, forçant l’admiration sans jamais la chercher. Il allait, quoi qu’il en coûte, donner ses cours à Saint-Denis le jeudi. Il animait les « sociétés discrètes », ces cercles de débat amical et théorique qu’il avait contribué à créer : la Société pour la résistance à l’air du temps (Sprat) et plus tard, la Société Louise Michel. Sans compter d’innombrables articles, notamment pour la revue Contretemps, qu’il avait fondée en 2001 ou ses interventions dans les universités d’été de la LCR puis du NPA, jusqu’à la dernière, à l’automne 2009, quand la maladie commençait à gagner.
Le pari de l’engagement se teintait de mélancolie par gros temps et n’excluait pas les doutes. Daniel s’est parfois demandé si la politique était vraiment « son genre » ou la philosophie sa vocation. Il n’avait aucun doute, en revanche, sur la nécessité de militer pour changer le monde, sur la fidélité relayant les résistances anciennes, celles des hérétiques de toutes contrées ou celles des habitués du Bar des amis. L’avant-dernier chapitre d’Une lente impatience s’intitule « Fin et suite », comme un clin d’œil et une invite à poursuivre. Car, selon Paul Valéry, qu’il citait volontiers : « c’est en quelque sorte l’avenir du passé qui est en question. »
Juin 2012
Nicole Lapierre, socio-anthropologue. A fait la connaissance de Daniel en 1967, en philosophie à l’université de Nanterre et à la JCR. A publié son autobiographie, Une lente impatience (2004), dans la collection « Un ordre d’idées », qu’elle dirige chez Stock