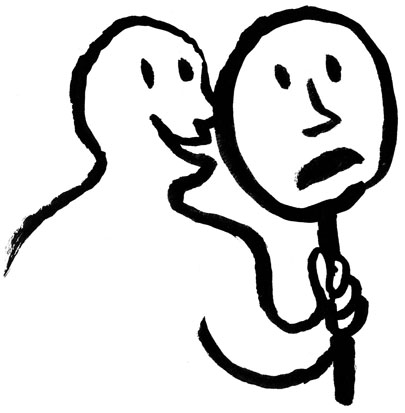
Antonia Birnbaum, Bonheur, Justice, Walter Benjamin, Payot, 2009
Le livre d’Antonia Birnbaum se propose « d’arracher Benjamin aux nouvelles figures du consensus » qui menacent de le tenir captif : « rattachement de la politique à l’éthique par le biais du droit, identification de l’histoire à l’ubiquité de la catastrophe, transformation des vaincus politiques en humanité souffrante, réconciliation avec un capitalisme qu’on prétend affubler d’un visage humain, équitable » (p. 233). Elle se propose de revisiter pour cela « le moment grec » de sa pensée, donnant à voir la Grèce telle que nous ne l’avions jamais vue, « comme une constellation inédite du tragique ». Benjamin trouverait chez les Grecs « un en deçà de l’alternative moderne qui distingue entre un sujet héroïque de la raison, dont la liberté est manifestation effective d’un devenir, et un sujet du devoir en proie à la scission de l’être et du devoir être, dont la liberté se manifeste dans l’autonomie de la conscience morale » (p. 185).
Ce détour par la théorie de la tragédie occupe toute la première partie de l’Origine du drame baroque allemand1. Il fait apparaître « une rencontre improbable entre le langage sublime, au diapason de la rudesse tragique, et le langage prosaïque, au diapason avec la dignité de l’infiniment petit » (p. 204). Il contribue ainsi à conjurer le retour du mythe en tant que « rémanence du destin » dans le monde historique, ou, comme Benjamin l’écrit dans le Livre des Passages, « à purifier le sol des broussailles de la folie et du mythe ». C’est que, dans l’entre-deux-guerres – et aujourd’hui peut-être, ces broussailles sont devenues envahissantes. Conspirant à fataliser l’histoire, mythe et destin « nomment le rapport que la modernité entretient avec le rêve de l’origine » (p. 60). Aujourd’hui encore le récit des racines, de la filiation, de l’élection originelle revient en force dans le temps de l’histoire, menaçant de refermer la porte étroite par où le possible pourrait faire irruption et interrompre la course à la catastrophe.
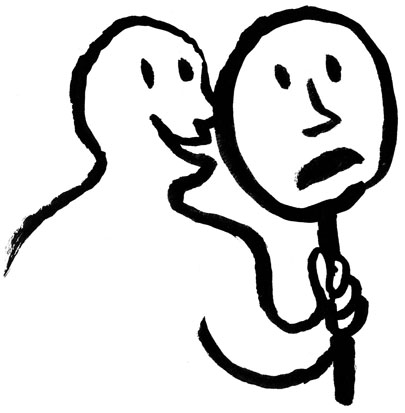 En proposant « une nouvelle théorie de la tragédie antique », Benjamin reviendrait donc sur la première tentative d’échapper au mythe réglé par l’implacable décret des dieux : « Dans la tragédie, l’homme païen se rend compte qu’il est meilleur que les dieux, mais ce savoir lui noue la langue » (p. 115). Alors que les héros épiques sont muets, « un langage moral d’avant lui-même » émerge dans la tragédie grecque qui « n’est rien d’autre que passage hors du destin ». Le héros tragique paie de sa vie son obstination solitaire à refuser la malédiction du destin, mais il n’est pas encore porteur d’un avenir indéterminé qui se décide en permanence dans les bifurcations historiques et les décisions politiques. Séparé de la communauté, il n’a aucun rendez-vous avec l’histoire et n’est encore investi d’aucune « faible force messianique ». Il puise seulement sa force « dans le pressentiment d’une parole inconnue qui reste hors de sa portée ». La tâche que s’assigne Benjamin serait alors de déterminer le rapport entre « le héros sans nom » (le héros anonyme du quotidien) du monde historique et « l’héroïsme de la justice
En proposant « une nouvelle théorie de la tragédie antique », Benjamin reviendrait donc sur la première tentative d’échapper au mythe réglé par l’implacable décret des dieux : « Dans la tragédie, l’homme païen se rend compte qu’il est meilleur que les dieux, mais ce savoir lui noue la langue » (p. 115). Alors que les héros épiques sont muets, « un langage moral d’avant lui-même » émerge dans la tragédie grecque qui « n’est rien d’autre que passage hors du destin ». Le héros tragique paie de sa vie son obstination solitaire à refuser la malédiction du destin, mais il n’est pas encore porteur d’un avenir indéterminé qui se décide en permanence dans les bifurcations historiques et les décisions politiques. Séparé de la communauté, il n’a aucun rendez-vous avec l’histoire et n’est encore investi d’aucune « faible force messianique ». Il puise seulement sa force « dans le pressentiment d’une parole inconnue qui reste hors de sa portée ». La tâche que s’assigne Benjamin serait alors de déterminer le rapport entre « le héros sans nom » (le héros anonyme du quotidien) du monde historique et « l’héroïsme de la justice
grecque » (p. 187).
Ce rapport conduit à une transformation radicale de la temporalité, de la perception de l’histoire et de son rapport à la politique. Benjamin conjoint en effet une temporalité messianique, suspendue à l’irruption rédemptrice du Jugement dernier, et une temporalité émancipatrice (liée à « la décision de ne plus tolérer l’inadmissible »), qui « s’actualise dans une division conflictuelle du présent » (p. 11). Le héros tragique se refuse au présent et ne se projette pas dans l’avenir. Dans le monde de l’histoire au contraire, le « tramage hétérogène » de la mémoire historique « fait échec à la continuité du temps ». Il constitue « la condition d’un acte possible » et d’« un nouveau savoir du temps ». La remémoration ouvre « une brèche du temps dans laquelle peut s’engouffrer une décision » (p. 171). Dans laquelle, autrement dit, se nouent indissolublement politique et histoire.
La « destitution de l’emprise mythique » inaugure une « nouvelle ère historique ». Dans ce monde nouveau, chaque déchirure conflictuelle peut se donner comme « actualisation du bonheur adamique oublié » (p. 162). Ce sont les vaincus d’hier et de toujours, et non les générations futures, qui requièrent « une décision de notre part quant à ce que nous faisons de notre rencontre avec eux ». Il s’agit alors, non d’un pieux souvenir ou d’une commémoration solennelle, mais bien d’une « remémoration profane » et active, d’une attente « qui n’est plus attente d’une délivrance mais attention à une conjoncture propice à l’émancipation » (p. 193). La référence au Jugement dernier de la rédemption ou de la restitution universelle y figure comme le point de fuite, à jamais inaccessible dans une histoire ouverte, où justice et bonheur finiraient par se rejoindre.
C’est pourquoi le temps historique est d’abord un temps politique. À l’encontre des exégèses qui esthétisent son œuvre pour mieux la dépolitiser, la lucidité de Benjamin est en effet toute entière « chargée d’une dynamique politique » (p. 28). Le dénouement de l’Orestie en appelait à la Cité contre les dieux, au renversement de leur tribunal tragique et à « l’advenue d’une communauté de parole rassemblée autour de sa division ». Mais cet avènement de la parole politique implique de pousser plus loin la démythification, jusqu’à congédier le mythe moderne du progrès et la temporalité qu’il suppose, car « tant que l’histoire nous apparaît comme enchaînement factuel, objectif, la possibilité de son interruption est remise à une perception théologique » (p. 213). C’est pour briser les chaînes du mythe et se libérer des dieux que Benjamin « appelle celui qui le lit à trancher ». Son attente messianique n’est plus celle d’une délivrance promise et annoncée mais celle du guetteur à l’affût du moment propice. Une attente stratégique, en somme.
À la lumière du lien nouveau tissé entre la mémoire et l’attente, la tragédie apparaît comme « un stade primaire de la prophétie ». À la différence de l’oracle grec, cette prophétie profane n’annonce pas ce qui doit fatalement avoir lieu, elle donne l’alerte contre le péril qui risque d’arriver mais peut encore être conjuré. Son inquiétude invite à décider et à agir, pour tirer « les ratages de l’oubli en réactivant leurs possibilités » (p. 169). Antonia Birnbaum éclaire ainsi l’assemblage du profane et du messianique, qu’il est impossible d’opposer chez Benjamin sans en annuler l’énigme. La faible force messianique dont chacun est investi s’actualise dans la vertu « éminemment profane » qu’est le courage. Le sens politique du messianisme se distingue ainsi radicalement de son sens théologique. Il se révèle à travers l’idée du bonheur et l’irruption événementielle susceptible de briser la récurrence cyclique du toujours semblable. Bien qu’elle n’y fasse guère référence, Antonia Birnbaum remonte ainsi la piste Benjamin jusqu’à ses figures tutélaires que sont Blanqui et Péguy, dont il emprunte, au premier, le thème de la bifurcation, au second, celui de la remémoration2.
La temporalité tragique dialectise non point le rapport entre nécessité et liberté mais entre bonheur et justice : « Comment une chose aussi légère que le bonheur peut-elle entretenir une relation essentielle avec une chose aussi grave que la justice ? » (p. 175). Le monde moderne n’aurait du bonheur qu’« une idée basse », « triste reflet de ce que les Grecs concevaient comme le malheur : une vie soumise à la peur et au besoin ». La philosophie de Benjamin serait au contraire « une dialectique du bonheur et de la justice dont l’enthousiasme et la gratuité transmettent une faible force aux vaincus de l’histoire » (p. 183). Le défi consiste donc à dialectiser le rapport entre bonheur et justice sans recourir à un absolu théologique. Il faut pour cela oser rouvrir la question de la justice que la modernité prétendait forclore, en commençant par admettre que la sphère juridique est « strictement étrangère à la justice »3.
La justice ne procède pas du droit, elle l’excède. Et le droit est incapable d’élucider le rapport entre justice et violence : « Les droits relatifs à l’émancipation [dont l’exemple par excellence est le droit de grève] ne proviennent jamais de la sphère du droit, mais y font effraction depuis une sphère hétérogène que Benjamin rapproche de certaines formes d’entente langagière ou de ce qu’il appelle les moyens politiques purs. D’où la question qui traverse l’ensemble de son essai Critique de la violence : quels sont les moyens purs de la justice » (p. 66). Penser une justice à propos de laquelle les hommes sont capables de se diviser, c’est la penser du point de vue de la lutte des classes : pas de justice sans discorde, ni différend. Alors que « la discorde s’étend à la remise en cause de l’instance qui porte le jugement », le conflit sur ce qui est juste ou non conteste le monopole du droit. La grève apparaît ainsi par excellence comme la « dramatisation politique d’un conflit juridique ». La justice nouvelle annoncée dans la tragédie préparerait ainsi « l’advenue d’une communauté qui parle rassemblée autour de sa division » (p. 114). L’enjeu est de taille : il s’agit de « reloger le conflit sur ce qui est juste ou non au sein même des agencements sensibles de cette simple vie, si modestes soient-ils » (p. 203).
Antonia Birnbaum l’éclaire par une lecture minutieuse du texte de 1933 Expérience et pauvreté4. Benjamin y reprend le projet du Programme de la philosophie qui vient5 : révolutionner, élargir, enrichir le concept d’expérience. Il y rappelle, à rebours des accents compassionnels de notre époque charitable, que la vie des pauvres n’est pas faite essentiellement de misère et que « personne n’a le droit de conclure une paix séparée avec la pauvreté lorsqu’elle tombe comme une ombre géante sur son peuple et sa maison » : « Il doit alors tenir ses sens en éveil pour percevoir toute l’humiliation qui leur est imposée, et ainsi les discipliner longtemps, jusqu’à ce que ses souffrances aient ouvert non la rue en pente du chagrin mais la rue montante de la révolte. »
À condition de considérer la pauvreté non pas, de manière condescendante, comme la manifestation d’un manque mais comme une ressource, l’expérience de la pauvreté recèlerait en effet une force grosse de possibilités multiples. « Tant qu’il y aura encore un mendiant, il y aura du mythe », admet lucidement Benjamin. Mais l’expérience de la pauvreté peut aussi servir d’apprentissage à la sortie du mythe, en ne travestissant pas une défaite historique réelle en victoire spirituelle imaginaire, en renonçant à la rassurante dialectique du déclin et de la renaissance, « en se débrouillant sans patrimoine à conserver, sans richesse à accumuler, sans sol à occuper, sans langage propre, sans tout ce qui contribue à alimenter la renaissance du patriotisme allemand » (p. 213).
Il ne suffit donc plus de prendre le parti des pauvres ou des misérables, à la manière du populisme romantique. Il faut « couper court à la plainte », prendre le contre-pied de la « mélancolie de gauche6 », cette tristesse historique dans laquelle a sombré un « marxisme occidental » perclus de défaites. Mais que lui opposer si ce n’est la « mélancolie classique 7 », non contemplative, celle de Saint-Just et de Blanqui, et de tous ceux qui ont osé « brosser l’histoire à rebrousse-poil », même quand le nécessaire et le possible ne jointaient pas ?
2009
www.danielbensaid.org
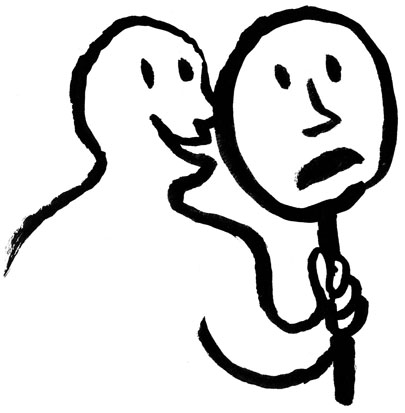
Documents joints
- Walter Benjamin, Origine du drame baroque allemand, Paris, Flammarion, 1985
- Pour évoquer la remémoration, la mémoire involontaire distincte du souvenir, Terry Eagleton utilise en anglais le mot « remembrance » qui avait cours en vieux français (cf. « Les remembrances d’un vieillard idiot » dans l’Album zutique d’Arthur Rimbaud.)
- Sur la question de la justice chez Benjamin, voir le beau livre de Massimiliano Tomba La « vera politica », Kant et Benjamin : la possibilita della guitizia, Rome, Quodlibet, 2000.
- Walter Benjamin, Œuvres II, Paris, Folio Gallimard, 2000.
- Walter Benjamin, Œuvres I, Paris, Folio Gallimard, 2000.
- Benjamin a titré son article sur Erich Kästners « Linke Melancholie ». Dans Le Spectateur émancipé, Jacques Rancière fustige aujourd’hui cette « mélancolie de gauche » qui se veut un savoir désenchanté du règne de la marchandise et du spectacle, et « nous presse d’avouer que nos désirs de subversion obéissent encore à la loi du marché ». (Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique 2009, p. 39)
- « On nous parle toujours de la mélancolie romantique. Voici pourtant de la mélancolie classique, la plus saine et la plus profonde » (Péguy, à propos du Chérubin de Beaumarchais in Clio, Paris, Gallimard, p 111).