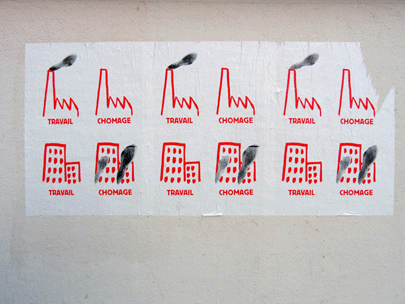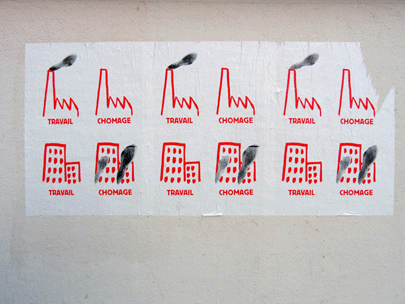
C’est avec des serrements de gorge et de poings que les travailleurs ont vécu la semaine qui a suivi le premier tour des élections législatives, et à plus forte raison les résultats du second. Leur sentiment n’est pas à proprement parlé celui d’une défaite inéluctable, mais bien plutôt celui d’avoir été trahis et bafoués par les directions auxquelles ils avaient accordé leur confiance.
Comment en est-on arrivé là ? Comment une victoire électorale qui semblait assurée voici un an, au lendemain des municipales, a-t-elle pu être ainsi gâchée ? À l’heure où nous nous retrouvons face au chômage et à l’austérité, face aux Barre, Chirac et consorts, tirer le bilan franchement, ce n’est pas se réfugier dans la rumination du passé. C’est chercher à y voir clair et à mieux comprendre pour se tourner vers l’avenir et reprendre la lutte à bras-le-corps.
Sur le terrain électoral, les travailleurs n’ont pas été battus par le programme de la droite. On n’a plus guère entendu parler du programme de Blois pendant cette campagne. Ils n’ont pas même été battus principalement par les trucages électoraux habituels, les découpages de circonscriptions, la mobilisation des caisses noires et des médias aux ordres, l’appoint du vote des Français de l’étranger. Tout cela est intervenu, bien sûr. Mais les travailleurs ont d’abord été victimes de leur propre division et de celle de leurs organisations.
Au moment où il faut régler les comptes et établir les responsabilités, nous commençons par affirmer : cette division ne date pas de la rupture du 22 septembre 1977 entre les signataires du Programme commun, pas plus que du refus du PCF, de s’engager sur le désistement lors de sa conférence du 8 janvier 1978. La division vient de beaucoup plus loin. Elle vient du refus de lancer l’offensive contre la bourgeoisie après le succès des municipales. Et elle vient de plus loin encore. De la façon dont le Programme commun a été élaboré et signé entre appareils, sur le tapis vert, sans que les travailleurs aient leur mot à dire. Du contenu même de ce programme : parce qu’il était un programme de collaboration de classe, parce qu’il enchaînait le combat de la classe ouvrière au respect du système capitaliste et de son État, parce qu’il pactisait avec ses représentants, il portait en germe la division.
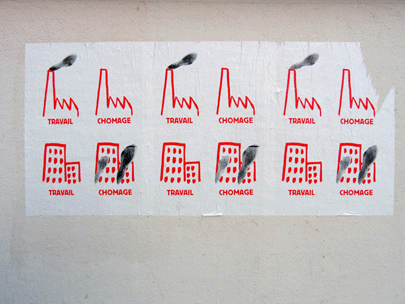 1. Après les municipales de mars 1977 : le socialisme, une idée qui fait son chemin ?
1. Après les municipales de mars 1977 : le socialisme, une idée qui fait son chemin ?
Dès la défaite de la droite aux élections municipales, nous avons posé la question : quand le moment est-il le plus favorable ? Nous disions : la droite est battue, il faut pousser l’avantage, bousculer la majorité déconfite, battre en brèche tout de suite le plan Barre, exiger la dissolution de l’Assemblée. Laisser s’appliquer plus longtemps le plan Barre, ce n’est pas faire preuve de patience, c’est supporter un an de plus une politique de chômage qui divise les travailleurs en renvoyant chez eux les immigrés, en renvoyant les femmes au foyer, en opposant jeunes et vieux, chômeurs et actifs. C’est le moment à saisir. Il serait absurde de laisser un an de plus les mains libres à la bourgeoisie pour organiser la fuite des capitaux et la restructuration de ses entreprises nationalisables. C’est tout de suite qu’il faut prendre l’initiative et engager la bataille unitaire pour la centralisation des luttes et pour porter au gouvernement le PC et le PS qui viennent d’être majoritaires et qui doivent prendre leurs responsabilités.
De leur côté au contraire, le PC comme le PS se montraient d’une remarquable discrétion sur leur propre succès, comme s’ils voulaient en minimiser la portée. Dès le lendemain du premier tour, le 15 mars 1977, Rouge titrait : « La gauche encombrée par sa victoire », et expliquait en éditorial : « Malgré leur victoire électorale, le PC et le PS sont décidés à poursuivre leur politique attentiste. Ils minimisent à dessein la signification politique de leur succès, oubliant volontairement qu’ils sont majoritaires et semblant quelque peu embarrassés par l’ampleur de leur victoire. Prisonniers de leur légalisme et de leur peur d’être portés au pouvoir par une mobilisation active des travailleurs dont ils craignent les exigences et les débordements, François Mitterrand et Georges Marchais multiplient les déclarations pour rassurer la bourgeoisie et lui dire qu’ils ne feront rien pour précipiter les échéances politiques en se portant immédiatement candidats au pouvoir. C’est toujours et encore au nom du respect sacro-saint de la Constitution qu’ils laissent l’initiative politique à la droite en déclarant que c’est au président de la République de fixer les échéances […]. Agissant ainsi, l’Union de la gauche est en train de dilapider tout le potentiel de combat qui s’est manifesté dimanche, elle laisse un répit inespéré à une droite à bout de souffle alors que jamais la situation n’a été aussi favorable pour organiser une riposte d’ensemble au plan d’austérité. »
Le même jour, Rouge publiait la résolution du bureau politique de la LCR rappelant ses consignes pour le second tour : « C’est parce que nous pensons qu’il ne faut accorder aucun répit, aucun sursis à ce gouvernement qu’il faut pousser tout de suite l’offensive, répondre à la volonté de changement des travailleurs, en chassant Barre et Ponia, Giscard et Chirac ; qu’il ne faut pas remettre au lendemain les revendications qui peuvent être arrachées le jour même… que nous appellerons les travailleurs qui ont voté au premier tour pour les listes “Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs”, à accélérer la débâcle de la droite en votant au second tour pour les listes conduites par le PC et le PS. »
Le second tour a largement confirmé la victoire sur la droite du premier. Le lendemain, Rouge du 21 mars 1977 titrait à la une : « Maintenant, il faut chasser Giscard. PC et PS doivent exiger sans attendre le pouvoir. Le plan Barre ne doit pas s’appliquer. » Il publiait en guise d’éditorial un communiqué du bureau politique de la LCR : « Il serait criminel de dilapider ce potentiel de combat en offrant un répit à la bourgeoisie. Il est possible, nécessaire et urgent d’entreprendre la contre-offensive immédiate contre le plan Barre et de répondre à la volonté des travailleurs de chasser Giscard et ce gouvernement. François Mitterrand répète qu’il “n’a ni la volonté, ni les moyens de provoquer une crise politique”, et qu’il “appartient à Giscard et à lui seul de décider d’une éventuelle dissolution du Parlement”, alors que les votes d’hier en faveur du PC et du PS signifient clairement : “Non au plan Barre ! Dehors Giscard !” Les directions ouvrières politiques et syndicales ont les moyens de répondre sans délai à cette aspiration. Les syndicats peuvent organiser la mobilisation dans une perspective de grève générale. Le PC et le PS peuvent refuser de cautionner le Parlement où trône une majorité désavouée. Le PS et le PC ont le devoir de se porter immédiatement candidats au pouvoir. Ils ont les moyens de chasser Giscard. Il ne leur manque que la volonté. »
2. 7 octobre, 24 mai, 1er décembre : on passe en revue la piétaille électorale
Que la volonté leur ait manqué, c’est le moins qu’on puisse dire. C’est en effet à cette époque que les dirigeants réformistes sont devenus les champions d’une philosophie fataliste à l’usage des travailleurs, sur le thème : chaque chose en son temps, tout vient à point à qui sait attendre… et autres balivernes prêchées traditionnellement par ceux qui possèdent à ceux qui n’ont rien.
C’est l’époque où François Mitterrand faisait couvrir les murs de son portrait grand format sur fond de dunes. « Le socialisme, une idée qui fait son chemin », disait cette affiche réconfortante qui préparait « La victoire en votant » !
Mais de leur côté, les directions syndicales n’étaient guère plus entreprenantes. « L’action revendicative en cours ne vise pas à créer une situation de blocage économique pouvant déboucher sur une crise politique. Pour aller vers les changements dont le pays a besoin, les travailleurs disposent à court terme du moyen d’élections législatives », disait Michel Warcholak (qui est aussi membre du comité central du PCF) dans son rapport du 10 mai 1977 devant le comité confédéral de la CGT, à quinze jours à peine de la grève générale du 24 mai.
Le 7 octobre 1976, les travailleurs avaient massivement réagi contre la mise en place du plan Barre. Il y eut sept millions de grévistes et les manifestations les plus importantes depuis 1968. Mais cette initiative resta sans lendemain. Au lieu de prolonger le mouvement, les directions syndicales se sont contentées de journées d’action saucissonnées, à l’image des grèves de la Fonction publique de janvier 1977, appelées sur la base d’une plate-forme édulcorée sous prétexte d’élargir l’action à Force ouvrière, et prenant soin de ne pas centraliser la lutte : l’action des cheminots s’arrêta quand commençait celle des autres catégories.
Tirant le bilan de cette tactique, la résolution du comité central de la LCR du 17 avril 1977 […] critiquait cette tactique des luttes et ses conséquences prévisibles :
« […] Que vont proposer les directions syndicales ? Un nouveau 7 octobre ? Ou bien oseront-elles continuer à lancer les travailleurs dans des journées de protestation morcelées, éparpillées, des grèves de 24 heures et des journées d’action par branches, secteurs ou régions, dont on sait qu’elles sont insuffisantes pour faire plier le patronat soutenu par le gouvernement ? Une telle tactique ne peut à la longue qu’user la combativité des travailleurs. Après l’échec de la longue grève parisienne de la Caisse d’épargne, ils ont bien conscience qu’il faudrait frapper un grand coup pour mettre en échec le plan d’austérité. Ils sentent que pour défendre le niveau de vie et le pouvoir d’achat, il serait nécessaire de s’attaquer directement au gouvernement et de recourir à des formes d’action autrement résolues. Certaines fractions parmi les plus conscientes commencent à rechigner devant des formes d’action où elles ont le sentiment de servir de piétaille électorale sans pouvoir espérer obtenir satisfaction. Si le gouvernement hausse la barre et fait monter les enchères, il faudra agir en conséquence. Au lieu de cela, les directions syndicales se sont résignées sans combat. Dès le lendemain du 7 octobre, Maire et Séguy ne parlaient plus de briser le plan Barre, mais de l’ébrécher, de lutter contre ses aspects les plus nocifs : un vocabulaire de rongeurs !… Poursuivant dans cette logique, les directions syndicales oseront-elles, au lendemain des municipales et face à la relance du plan d’austérité, proposer les mêmes journées d’action impuissantes ? Avec en plus, pour lâcher un peu de vapeur, un baroud symbolique en défense de la Sécurité sociale ?… »
Elles osèrent, et nous eûmes le baroud, avec la grève générale du 24 mai. On dénombra ce jour-là 9 millions de grévistes qui témoignaient de la volonté d’en finir avec le régime et son gouvernement, mais les cortèges furent en général plus réduits que le 7 octobre : les travailleurs subissaient le plan Barre depuis neuf mois et avaient conscience que cette action tardive, sans perspective, ressemblait davantage à un hochet qu’à une réelle mobilisation : une manière de passer en revue la piétaille électorale en la faisant patienter.
Et ce n’était pas fini. Dans leurs discours de rentrée, Maire et Séguy admirent que le plan Barre était du point de vue du patronat un certain succès, puisqu’il avait abouti à une baisse de 3 % du pouvoir d’achat et à une augmentation de 17 % du chômage. Mais ils ne s’interrogèrent pas sur leur part de responsabilité dans ce « succès ». Au contraire, confrontés à la rupture du PC et du PS, les centrales syndicales emboîtèrent le pas à la division, la CGT soutenant ouvertement le PC et la CFDT plus discrètement le PS. Au lieu de relancer l’unité par le débat à la base, par des réunions intersyndicales sur leurs plates-formes respectives publiées à la rentrée, elles campèrent chacune sur ces positions. Au lieu de favoriser l’expression des travailleurs sur les points en litige, elles laissèrent l’avant-scène à la polémique des partis pendant tous les mois d’automne.
Résultat, la grève et les manifestations du 1er décembre marquèrent encore un recul par rapport au 7 octobre et au 24 mai. En pleine discussion sur le smic, la revendication sur ce point n’était pas chiffrée dans l’appel pour le 1er décembre. Une journée sans plates-formes discutées à l’avance, pratiquement sans cortèges intersyndicaux d’entreprise, où les manifestants CFDT et CGT se regardaient en chiens de faïence, tous désorientés pour les seconds de ne plus pouvoir crier la « seule solution » du Programme commun.
À quatre mois des élections, l’absence des partis politiques, pourtant présents le 7 octobre et le 24 mai, montrait déjà le poids de la division et l’impasse de l’initiative. Il ne s’agissait pas d’une mobilisation revendicative résolue sur des objectifs chiffrés et une plate-forme précise… mais il ne s’agissait plus d’une démonstration de force politique préélectorale. Jean Dréan, membre de l’Union des syndicats CGT de la région parisienne déclarait avec embarras au comité général de l’UD-CGT du Val-de-Marne : « Les partis politiques viennent en général dans les groupes de tête. Eh bien, cette fois, nous avons décidé ensemble de leur faire savoir qu’il n’est pas utile qu’ils viennent. Vous comprenez bien pourquoi, pas besoin de vous faire un dessin. Nous voulons garder un caractère syndical à cette manifestation… »
3. Le Programme commun portait en germe la division
Quand nous disons que la division vient de loin, nous voulons dire qu’elle plonge ses racines dans la nature même du Programme commun, dans la façon dont il fut élaboré, dans le fait qu’il a servi de prétexte à détourner les travailleurs de la mobilisation immédiate au profit de chimères électorales.
Ne prenons que l’exemple de ce qui s’est passé au lendemain des municipales. Nous disions qu’il fallait créer les conditions de la mobilisation contre le plan Barre sans attendre. Certains peuvent objecter que les conditions n’étaient pas mûres, que le patronat et le gouvernement n’auraient pas cédé… Il peut y avoir sur ce point des divergences d’analyse, encore qu’il soit difficile d’apprécier exactement ce qui était possible quand on n’a rien tenté. Mais une chose en tout cas est sûre : qu’elle ait abouti ou non à une victoire immédiate, la mobilisation contre le plan Barre aurait créé de toutes autres conditions de débat dans le mouvement ouvrier et préparé l’intervention des travailleurs eux-mêmes dans la polémique PC-PS.
Imaginons qu’au lendemain du 7 octobre ou des municipales, il y ait eu mobilisation, assemblées générales, réunions intersyndicales, discutant et chiffrant les revendications des travailleurs face à l’austérité : sur le smic, le temps de travail, la Sécurité sociale… il aurait été autrement difficile ensuite aux partis réformistes de se renvoyer la balle des responsabilités, de s’accuser mutuellement de virage à droite, sans s’en remettre au verdict des travailleurs eux-mêmes. Si des réunions intersyndicales de ville ou de branche s’étaient prononcées sur le smic à 2 400 F, la discussion n’aurait pas pu s’éterniser sur ce point, masquant les arrière-pensées et les manœuvres des uns et des autres.
Et même sur des questions apparemment plus embrouillées, comme l’affaire des nationalisations et des filiales, que disions-nous, à la LCR, dans une résolution du bureau politique sur les nationalisations datée du 17 avril 1977, bien avant que Georges Marchais ne s’inquiète des positions du Parti socialiste sur les filiales ? Nous disions : « L’exercice du contrôle ouvrier est le seul moyen de définir le contour des nationalisations, par des critères de complémentarité dans la production, par des critères fonctionnels concrets et non par des critères juridiques abstraits. En effet, les entreprises nationalisables à commencer par celles qui sont citées dans le Programme commun sont souvent, de nos jours, des holdings contrôlant un grand nombre de filiales ; il existe un enchevêtrement de prises de participation croisées qui rendent floues les frontières d’un groupe. Les théoriciens socialistes cherchent à tirer argument de cette difficulté pour limiter la nationalisation aux holdings, dont les filiales resteraient alors des sociétés privées encadrées par des holdings d’État à la manière de l’IRI en Italie. La seule solution de classe consiste à trancher l’écheveau juridique au lieu de chercher à le démêler, en s’orientant grâce au contrôle des travailleurs qui connaissent les connexions et les rapports effectifs, sinon juridiques, entre sociétés, et sont par là mêmes capables de dégager les éléments des branches et des secteurs à nationaliser1. »
C’est en ce sens que la mobilisation immédiate contre l’austérité, contre les fuites des capitaux et les restructurations d’entreprises aurait créé les conditions de l’unité des travailleurs. Si les travailleurs de telle et telle usine avaient discuté alors de son statut et de son avenir, s’ils s’étaient prononcés par résolutions syndicales et votes d’assemblées, ceux de Peugeot et de la sidérurgie, ceux de Michelin et de Hachette, il aurait été autrement difficile aux experts du PC et du PS de polémiquer à coups de listes sur lesquelles des centaines d’entreprises et des milliers de travailleurs apparaissent et disparaissent au gré d’une gigantesque partie de poker, sans que jamais les premiers intéressés soient eux-mêmes consultés.
II – Pour nous l’unité des travailleurs était la condition
d’une discussion démocratique sur le programme face à l’austérité
1. L’actualisation du Programme commun
Le 29 mars 1977, dans son discours télévisé de commentaire des élections municipales, Giscard, déconfit, s’engageait à « respecter » le choix électoral des élections législatives, en même temps qu’il lançait un défi à l’Union de la gauche : « Tout devra être fait, tout devra être expliqué, tout devra être chiffré pour que vous puissiez faire votre choix en connaissant d’avance les conséquences. »
Dans un premier temps, nous avons interprété la démarche du PCF d’actualisation et de chiffrage du Programme commun comme une réponse à ce défi. Une réponse réformiste et gestionnaire. Que faut-il en penser avec le recul ?
En lançant cette initiative, le PC jouait encore sur deux tableaux. La publication de son chiffrage du Programme commun le jour même du débat Mitterrand-Barre participait déjà de l’offensive de réaffirmation du parti face au PS. Si le PCF avait été largement bénéficiaire dans l’accord des municipales qui lui permettait de conquérir certaines municipalités importantes et d’entrer en force dans nombre de conseils municipaux, la poussée électorale du PS confirmée risquait aux législatives, par le jeu des désistements, de modifier substantiellement les rapports de forces au sein de l’Union de la gauche. Les craintes réveillées par les législatives partielles de l’automne 1974 revenaient en force.
S’il était donc résolu à enrayer la poussée du PS, le PCF s’efforçait en même temps d’apparaître comme un parti de gouvernement responsable. Annonçant l’actualisation du Programme commun, Charles Fiterman insistait le 21 avril 1977 sur l’extension nécessaire des alliances : « L’alliance des partis du Programme commun doit être une alliance ouverte. Il faut une gauche ouverte. » En même temps, il soulignait qu’il ne s’agissait pas de « tout promettre à tout le monde », reprenant ainsi un thème déjà développé par Georges Marchais : « Quand nous disons qu’il faut progresser sur le chemin de la justice sociale, nous ne promettons pas la lune. »
La lune… elle ne figurait précisément pas dans les propositions d’actualisation et les chiffres avancés par le PCF. Nous leur avons consacré l’essentiel d’un numéro des Cahiers de la taupe (« Le cercle vicieux du réformisme », n° 15, juin 1977), dans lequel nous relevions que la répercussion de l’application du principe à travail égal salaire égal n’était pas envisagée, pas plus que les conditions du plein-emploi pour les femmes ; que le montant de l’indemnité chômage et les modalités de l’échelle mobile des salaires restaient dans le brouillard. Nous relevions surtout un chiffrage du smic inférieur à celui des organisations syndicales : « Le PCF avance le smic à 2 200 F pour 40 heures, ce qui est conforme à la revendication commune adoptée par les syndicats CGT et CFDT. Mais pour les syndicats, il s’agit d’une revendication immédiate, alors que pour le PCF, il s’agit d’un projet applicable par la gauche au gouvernement, c’est-à-dire éventuellement dans dix mois. Or, si le smic était indexé sur l’indice des prix des organisations syndicales, du train où vont les choses, il devrait d’ici dix mois, être relevé d’environ 10 % ; il devrait donc, en partant des 2 200 F revendiqués aujourd’hui par les confédérations, se trouver à 2 400 F à peu près au moment de l’arrivée éventuelle de la gauche au gouvernement » (Cahiers de la taupe, n° 15).
Nous relevions également le soin apporté par les responsables du PCF à délimiter l’extension du futur secteur nationalisé. Le 21 avril, L’Humanité précisait : « aux nationalisations du Programme commun, nous ne proposons en fait qu’une seule adjonction, celle de Peugeot-Citroën ». Donc une nationalisation déjà proposée par Mitterrand lui-même lors d’une conférence de presse, et rien sur les compagnies pétrolières ou la sidérurgie. Le même jour, Jean Louis Moynot rapportait à Nanterre dans un colloque de la CGT sur la démocratisation des entreprises, et se prononçait pour « une délimitation du secteur nationalisé qui tienne compte essentiellement des exigences de caractère national et non pas principalement des points de vue particuliers exprimés dans telle ou telle entreprise ou secteur. » C’était en clair donner par avance satisfaction à Robert Fabre en renonçant à la petite phrase prévoyant que les travailleurs pourraient réclamer de l’Assemblée nationale la nationalisation de leur entreprise. D’ailleurs, le lendemain 22 avril, devant le forum de L’Expansion, Georges Marchais répétait rassurant : « C’est de l’Assemblée nationale et d’elle seule que dépend la nationalisation. » Il ne saurait y avoir de coïncidence dans la convergence de ces propos modérés.
Le PCF courait au lendemain des municipales deux lièvres à la fois. Il commençait à vouloir restaurer le rapport de force face au PS, mais il soignait son image de prétendant au gouvernement et se préoccupait d’un élargissement des alliances.
2. Discussion et unité ne sont pas incompatibles, au contraire
C’est pendant l’été que le ton a changé. Et c’est à la veille de la rentrée que Georges Marchais, dans une réponse à Roger Priouret pour Le Matin a lancé sa première dénonciation explicite de l’austérité : « L’austérité quelles qu’en soient les formes est socialement intolérable et économiquement nuisible […]. L’austérité est totalement injustifiée […]. » (Le Matin du 22 août 1977). Alors qu’en juillet, la première fracture s’était produite publiquement sur une question peu sensible à la masse des travailleurs, celle de l’armement atomique, elle s’approfondissait dès lors sur le terrain revendicatif : le smic à 2 400 F pour mars 1978, la réduction de la hiérarchie, le problème des filiales. Jusqu’aux coups de poings sur la table et aux claquements de portes du
22 septembre. Pendant cette période de rentrée, à coups de tracts et suppléments de L’Humanité diffusés massivement, le PCF expliqua : la discussion porte sur le programme. Fort bien. Nous avons toujours exprimé publiquement notre critique du Programme commun. Nous ne sommes pas des partisans de l’unité à tout prix. On discute des revendications des travailleurs, et bien discutons : que chaque organisation se réclamant de la classe ouvrière apporte, sur la base de ses convictions et de son expérience, sa contribution.
Nous n’avons esquivé et fui aucun débat en ce qui nous concerne. Sur toutes les questions soulevées, nous nous sommes prononcés : dans les Cahiers de la taupe sur l’actualisation et le chiffrage du Programme commun, sur la publication à la rentrée des plates-formes syndicales. Et le matin même du sommet de la gauche de la rupture,
le 22 septembre, Rouge publiait un dossier de quatre pages centrales présentant les positions de la LCR sur les questions en discussion : le smic à 2 400 F, oui, mais quelle échelle mobile, quelle garantie du pouvoir d’achat ? La réduction de la hiérarchie, oui, mais quelle offensive contre la richesse, quel contrôle des travailleurs ? Qui et comment nationaliser ? La bombe, au service de qui, pour quoi faire ? Tous ces travaux sont à l’origine de l’élaboration collective d’un document programmatique de la LCR, publié en février dernier et qui synthétise nos positions : « Oui, le socialisme ! » Mais nous ne nous en sommes pas tenus là. Nous avons ajouté deux choses qui paraissent aujourd’hui essentielles :
– que le PC et le PS s’accusaient mutuellement de faire des concessions à droite, mais que leur débat restait un débat de dupes. En effet, le PC accusait le Parti socialiste de se préparer à gérer l’austérité en se faisant tirer l’oreille sur le chiffrage du smic et en reculant sur le nombre de filiales nationalisables. Le PS de son côté accusait le Parti communiste de pactiser avec la bourgeoisie en acceptant la bombe et l’aide à l’enseignement privé. Mais nous constations qu’ils demeuraient l’un et l’autre d’accord pour admettre un nombre limité de nationalisations (entre 250 et 700) ne remettant pas en cause le système du profit, d’accord pour s’allier avec des partis bourgeois radicaux ou gaullistes, d’accord pour garder Giscard et la Constitution de 1958, d’accord pour respecter l’alliance atlantique et la hiérarchie militaire en n’apportant pas leur soutien aux comités de soldats dans leur lutte pour un syndicat de soldats ;
– que leur polémique se soldait de part et d’autre par une sorte de plébiscite réclamant un chèque en blanc des travailleurs, sans leur donner les moyens de débattre unitairement et de trancher.
Ce dernier point constituait à nos yeux la clef de la situation. Il faut y revenir. En effet, comme par un vieux réflexe stalinien, le Parti communiste continue à faire comme si la libre confrontation des divergences et l’unité dans l’action étaient incompatibles. Pour nous, c’est tout le contraire. Parce que nous sommes antistaliniens et communistes, il n’y a pas et il ne peut y avoir incompatibilité entre la discussion et la polémique sur le programme et l’unité pour frapper ensemble. Mieux : l’unité, c’est-à-dire la discussion dans un cadre unitaire de toutes les positions, est une condition de clarté dans le débat. Et réciproquement la possibilité d’exprimer des positions différentes, de les défendre, quitte à appliquer dans l’action la position majoritaire, est la condition d’une unité solide et consciente.
C’est notre point de vue, celui qui nous guide quand nous nous battons pour des assemblées générales souveraines dans la lutte, pour des délégués élus et révocables, pour la fusion syndicale et un syndicat unique respectant le fonctionnement d’une démocratie fédérative.
C’est pourquoi, en même temps que nous acceptions la nécessité d’un large débat sur les questions de programme, nous refusions l’alternative du soutien soit aux positions du PC soit à celles du PS et nous mettions en avant l’unité des travailleurs.
Dès le lendemain de la rupture des négociations sur le Programme commun, le 23 septembre, Rouge titrait : « L’alternative n’est pas entre 250 et 729 nationalisations : il faut l’unité pour en finir avec l’austérité, pour chasser le gouvernement Giscard-Barre, pour imposer les solutions ouvrières à la crise. »
Le lundi 26 septembre, Rouge publiait une résolution du bureau, politique de la LCR largement diffusée à la porte des entreprises, « Il faut l’unité ouvrière » : « Mitterrand et Marchais n’ont qu’une réponse. Le premier dit “adhérez au PS” ! et le second “adhérez au PC” ! Et ils s’accusent mutuellement de sectarisme. Ce n’est pas comme cela qu’on fera avancer l’unité. Pourtant, en 1974, Mitterrand disait à la télévision : “La droite veut garder le pouvoir, moi je veux vous le rendre.” Il prétend rendre le pouvoir au peuple, mais il ne propose rien aux travailleurs pour qu’ils puissent intervenir dans le débat ! G. Marchais, lui, répète depuis trois mois que “les travailleurs doivent intervenir dans le débat”, mais il ne dit pas comment. Pourtant les travailleurs savent comment il est possible, dans une grève, si elle est conduite démocratiquement, de débattre tout en maintenant l’unité d’action face aux patrons. En assemblée générale, les grévistes discutent les différentes positions syndicales CGT, CFDT ou FO, ou toute autre proposition faite par les travailleurs, et puis, après avoir confronté les positions, après avoir réfléchi et débattu, on vote. Et la position majoritaire devient la position de tous les travailleurs face aux patrons. Alors, il faut faire pareil ! Il faut que dans toutes les entreprises soient convoquées des assemblées où tous les syndicats et tous les partis ouvriers expliquent leurs positions. Après débat démocratique, les travailleurs devront être consultés et le PC et le PS devront s’engager à tenir compte de leur avis sur les nationalisations, mais aussi sur le smic, sur la hiérarchie, sur les conditions de travail, sur l’emploi et sur l’armée… Le PS et le PC prétendent l’un et l’autre parler au nom des travailleurs. S’ils sont convaincus qu’ils défendent réellement l’intérêt des travailleurs, ils ne doivent pas avoir peur d’un tel débat démocratique où toutes les positions existant au sein du mouvement ouvrier pourront s’exprimer démocratiquement et où les travailleurs pourront trancher […]. Avec la division, non seulement la droite gagnera les élections, mais surtout le plan Barre va s’appliquer de plus belle et la répression patronale va pouvoir s’intensifier. C’est pourquoi nous disons aux militants de la CGT et de la CFDT : au lieu de soutenir qui le PC, qui le PS, il faut consolider le front syndical commun. »
La même résolution dénonçait, après la spectaculaire « sortie » de Robert Fabre, le rôle des radicaux de gauche comme « roue de secours de la bourgeoisie. »
Tout cela s’est vérifié. Avec la division, la droite a gagné effectivement les élections. Quant aux radicaux, la fausse sortie de Fabre est devenue, sitôt l’échec confirmé, une vraie sortie pour aller à la soupe.
La bataille pour l’unité, nous l’avons menée dans la limite de nos forces. Nous avons fait des démarches pour la mener avec les organisations qui en comprenaient la nécessité. Mais nos forces étaient trop faibles devant le poids des grands appareils réformistes, politiques et syndicaux. Mais surtout, le pli de la passivité était pris. Les travailleurs qui avaient en 1972 reçu le Programme commun comme la « seule solution », sans avoir à en discuter, puis qui avaient été démobilisés face à l’application du plan Barre, dans l’attente d’une victoire électorale présentée comme acquise, ne pouvaient pas du jour au lendemain s’organiser pour prendre la parole et prendre les choses en main.
C’est aussi pour cette raison que nous disons aujourd’hui que la division vient de loin.
Sur les questions en débat, il n’y eut guère de prises de position syndicales, encore moins de motions intersyndicales. Une motion de l’UD-CFDT de l’Ille-et-Vilaine réclamant la nationalisation de Citroën, abandonnée dans les négociations par le PC comme par le PS, quelques autres motions par ci par là, vite enterrées dans le silence des appareils. Décidément, les travailleurs n’avaient pas leur mot à dire dans cette grande diplomatie électorale où tous les protagonistes parlaient en leur nom.
De même, nous nous sommes emparés de l’idée des conseils d’ateliers et de services, lancée par la CFDT, puis reprise par le PC et le PS. Nous avons dit : s’il s’agit, non pas de structures de cogestion, mais d’instruments de lutte pour les travailleurs en défense de leurs conditions de travail, alors il n’est pas utile d’attendre une victoire somme toute incertaine de la gauche et un décret-loi pour s’atteler tout de suite à leur construction dans l’unité ; il n’y a aucune raison d’en limiter a priori l’existence au secteur nationalisé et d’en définir a priori les fonctions.
Imaginons combien les conditions du débat auraient été différentes si, en 1972, au lieu d’un compromis à huis clos entre les deux partis réformistes, les travailleurs avaient été impliqués, s’ils avaient discuté dans les entreprises, les syndicats, si ceux des entreprises nationalisables s’étaient prononcés, si ceux des grands secteurs de l’économie et des entreprises en faillite s’étaient emparés de la petite phrase sur l’extension des nationalisations refusée par les radicaux de gauche, si partout ils avaient chiffré les effectifs nécessaires et discuté des conditions de travail… La division aurait alors eu infiniment plus de mal à s’imposer sur leur dos.
III – Accepter le geste unitaire du désistement pour discuter du programme
Le 14 mars, deux jours après le premier tour, au lendemain de l’accord conclu avec le PS et les radicaux de gauche, Georges Marchais déclarait, souverain d’aplomb et de cynisme : « Nous avons toujours dit que les désistements ne font pas problème. Nous ne sommes plus à l’époque où l’on nous demandait de retirer tel ou tel candidat arrivé en première position… » (L’Humanité du 15 mars 1978).
Il fallait un certain culot. N’était-ce pas désavouer René Andrieu, lui-même présent au club de la presse en tant que journaliste de L’Humanité, et qui avait écrit un mois plus tôt dans un éditorial daté du 9 février 1978 : « Disons le clairement ; la notion de “discipline républicaine” est à reléguer au musée de l’Histoire, entre le rouet, la lampe à huile et les occasions manquées. »
Mais surtout, n’était-ce pas désavouer Marchais lui-même, qui disait dans son rapport à la conférence nationale du PC les 7 et 8 janvier : « Régler la question du second tour avant le premier, ce serait tout bonnement abandonner la lutte pour un bon accord sur un programme, ce serait demander à tous les hommes et les femmes qui font confiance à notre parti de servir d’instrument aux mains de ceux qui veulent frustrer les travailleurs des changements qu’ils attendent. Cela, nous ne saurions y consentir. Le problème est ainsi clairement posé : c’est aux Français et aux Françaises qui veulent que ça change qu’il appartient de décider. Nous avions dit à notre XXIIe congrès : si le Parti communiste atteignait 25 % des voix, ce serait bien pour les travailleurs et le pays. Cela reste tout à fait vrai. En tout cas une chose est certaine, les 21 % que nous accordent les sondages, les résultats des élections récentes, pour encourageants qu’ils soient, ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de plus, soyons clairs… » (Cahiers du communisme, février 1978, p. 32).
Si les mots ont encore un sens, la position arrêtée par le PCF lors de sa conférence nationale de janvier revenait à subordonner le désistement à un bon accord sur le programme et sur les ministres. Toujours en vertu de la même logique pour laquelle divergences et unité s’excluent.
Alors que le PCF liait la question du désistement à celle du programme, nous expliquions au contraire que ces questions devaient être dissociées. Dans une grève, pour battre un patron, pour lutter au coude à coude, les travailleurs n’ont pas besoin d’être d’accord sur l’ensemble d’un programme et la composition d’un gouvernement. C’est pourquoi nous avons considéré qu’il n’y avait pas de préalable et de chantage admissible, lorsqu’il était possible de chasser la droite par un désistement automatique en faveur du candidat ouvrier arrivé en tête.
Si les arguments du PCF n’avaient pas été de mauvais prétextes, s’il avait vraiment voulu créer les meilleures conditions de lutte contre l’austérité, c’est la position qu’il aurait dû adopter : nous nous désisterons, nous irons unis à la bataille et les conditions du débat sur ce qui nous sépare seront d’autant plus claires et d’autant plus saines que nous continuerons à frapper ensemble l’ennemi commun. Avec un tel langage la discussion sur le programme pouvait se poursuivre sans porter préjudice à l’élan unitaire ; dans la confiance que crée le sentiment d’un combat commun, par-delà les divergences sur la façon de le conduire.
Finalement, le rapport de forces s’en serait trouvé amélioré au profit des travailleurs. Car toutes les garanties réclamées par le Parti communiste – 25 % des suffrages et des ministres communistes – ne tiennent pas cinq minutes à la lumière de l’histoire. Il est déjà arrivé que le Parti communiste approche ou dépasse les 25 % de voix, à la Libération et en 1956. Il est déjà arrivé qu’il y ait des ministres communistes et même à un haut niveau, avec Thorez ministre d’État. Cela n’a jamais constitué une garantie contre les mauvais coups pour les travailleurs. En 1945, les ministres communistes ont appelé à la reconstruction nationale, à l’arrêt des grèves, à la bataille de la production, bref à l’austérité de l’époque. En 1956, le Parti communiste a utilisé ses suffrages pour faire voter par ses députés les pleins pouvoirs à Guy Mollet dans la sale guerre d’Algérie.
En revanche, l’unité maintenue des travailleurs, l’engagement sur le désistement, la victoire possible sur la droite, le 19 mars, auraient créé chez les travailleurs un tel sentiment de confiance en leurs propres forces qu’il aurait été infiniment plus difficile à quiconque de leur réclamer ensuite des sacrifices nouveaux, de refuser la réduction du temps de travail et l’augmentation des salaires. La discussion sur le programme aurait pu se poursuivre sur la base d’un tout autre rapport de forces. Mais là n’était pas le problème du PCF.
Et Rocard a beau jeu d’expliquer aujourd’hui à la télévision qu’à faire de la surenchère sur le smic et les nationalisations, on a fini par casser le pot au lait. Il prend l’exact contre-pied de la position du PCF :
– le PCF conditionnait l’unité d’action à l’accord sur le programme… ;
– Rocard en déduit qu’il fallait accepter un programme au rabais pour permettre l’unité d’action…
Tout au long de notre campagne, nous nous sommes efforcés de montrer qu’il y a une autre voie.
D’emblée, dans les discussions entre les organisations d’extrême gauche en vue d’un accord pour la campagne électorale, nous avons fait de la question du désistement automatique pour le second tour un point clef, au même titre que la lutte contre l’austérité et la caractérisation du Programme commun comme programme de collaboration de classe. C’est pourquoi, l’accord conclu avec les Comités communistes autogestionnaires (CCA) et l’Organisation communiste des travailleurs (OCT), dans le cadre des listes « Pour le socialisme, le pouvoir aux travailleurs », affirmait en toute clarté dès le 16 décembre : « Au second tour, pour battre la droite et malgré votre désaccord et votre défiance avec les perspectives du Programme commun, vous voterez pour le candidat des partis réformistes le mieux placé (la LCR et les CCA n’appelleront pas à voter pour les candidats bourgeois radicaux ou gaullistes de gauche). En contribuant à leur apporter une large majorité, nous ne leur laisserons aucun prétexte pour tergiverser, pour refuser de satisfaire les revendications des travailleurs… »
La plate-forme de la LCR elle-même – Pour chasser Giscard-Barre, unité des travailleurs – précisait les raisons de la divergence avec l’OCT sur les radicaux et les gaullistes de gauche : « Pas une voix ne doit aller à un candidat bourgeois, même s’il se met au goût du jour en se présentant comme gaulliste ou radical « de gauche ». Voter pour un candidat bourgeois, sous prétexte d’élargir la majorité électorale, c’est aliéner l’indépendance et la liberté d’action des travailleurs, c’est douter de leurs propres forces. Il ne viendrait à l’idée d’aucun ouvrier conscient de confier la défense de ses intérêts à son patron. Alors, pourquoi élire à l’Assemblée des représentants dont la seule fonction, comme l’illustre Robert Fabre, est de rappeler au respect de la propriété capitaliste et de l’ordre bourgeois, sans avoir de comptes à rendre dans les entreprises où on ne les voit pas. »
Poursuivant dans cette voie, nous publiions dans Rouge (le 7 janvier 1978), le matin même où se réunissait la conférence nationale du PCF qui devait se prononcer sur le désistement, une lettre ouverte aux militants communistes : « […] Il faut l’unité ouvrière et, sur le plan électoral, cela veut dire que toutes les voix ouvrières au deuxième tour devront se reporter sans condition sur les candidats du parti ouvrier arrivé en tête au premier tour. Refuser cette règle élémentaire, mettre des conditions au désistement, ou prendre prétexte du report souvent plus aléatoire des voix socialistes, c’est tout simplement prendre le risque de laisser en place le gouvernement Giscard… Comment battre l’austérité autrement que par une mobilisation active des travailleurs ? Et une victoire électorale des partis ouvriers, si elle ne saurait remplacer une telle mobilisation, ne serait-elle pas un formidable encouragement à la lutte ? Non, décidément, aucun argument ne peut justifier que vous ne preniez pas un tel engagement, les travailleurs ne pourraient comprendre qu’une chose : ils préfèrent laisser la droite en place. Vous ne prendrez pas une responsabilité aussi écrasante. »
Pourtant les dirigeants communistes ont pris cette responsabilité et les faits ont impitoyablement vérifié notre pronostic. Dès le lendemain de cette conférence, où pas une seule voix — il faudra s’en souvenir — ne s’est élevée pour condamner ou critiquer la position de la direction du PCF, Rouge revenait sur cette question du désistement par le biais d’une résolution du comité central de la LCR : « La direction du PCF, en refusant de s’engager avant les résultats du premier tour au désistement réciproque sans condition pour le candidat ouvrier le mieux placé, vient d’enfoncer un nouveau coin dans la division entre PC et PS […]. Ainsi, la concurrence fait place à la division, y compris sur le terrain élémentaire du désistement électoral. Il sera bien temps de se prononcer au lendemain du premier tour, a expliqué Georges Marchais. Sauf qu’il sera peut-être un peu tard ! Quand les électeurs communistes auront entendu rabâcher qu’entre le PS et les partis bourgeois au pouvoir, c’est bonnet blanc et blanc bonnet, combien ne se déplaceront pas au second tour ? Et quand les électeurs socialistes auront eu l’impression que le PCF est prêt à tout faire pour éviter la victoire électorale de leur parti, combien, suivant un vieux réflexe alimenté par l’anticommunisme, bouderont les consignes de désistement de François Mitterrand. Dès lors, l’hypothèse d’une majorité de votes pour les partis ouvriers au premier tour, débouchant sur une minorité parlementaire deviendrait possible, indépendamment des multiples trucages légaux du système électoral. Les travailleurs doivent exiger du PC et du PS un engagement immédiat et inconditionnel à se désister au deuxième tour pour le candidat ouvrier le mieux placé » (9 janvier 1978).
Ce qui devait arriver arriva.
Du point de vue de leurs stricts intérêts parlementaires, le PC comme le PS avaient besoin du désistement, d’autant plus que ni l’un ni l’autre ne pouvaient endosser publiquement la responsabilité ultime de la division. D’où l’accord honteux du 13 mars. Après avoir lié désistement-programme-gouvernement, le PC ne pouvait se désister sans accord politique, et comme le PS ne pouvait céder sous peine de repousser son électoral modéré, exaspéré par la polémique, le compromis ne pouvait se faire que sur un accord creux, confirmant après coup le caractère tactique de toute la polémique, créant chez les travailleurs un sentiment d’énorme duperie, et incapable de relancer une mobilisation unitaire. D’ailleurs, de campagne unitaire, les dirigeants politiques et syndicaux de la gauche n’en voulaient point.
Entre les deux tours, aucune initiative centrale, aucun meeting susceptible de remobiliser. Au niveau syndical, la direction de la CFDT appelait dès le lendemain du premier tour, avant l’accord entre les partis de gauche, au désistement. Mais la CGT réservait sa position jusqu’aux résultats du sommet de la gauche et se contentait de saluer, sans autres perspectives la victoire contre la droite au premier tour. Elle poursuivait ainsi son alignement honteux sur la politique du PC. De sorte que La Vie ouvrière paraissait le lundi 13 mars sans aucune consigne, avec une couverture la plus neutre possible. Quant aux initiatives communes, les directions confédérales donnaient pour consigne de les éviter au maximum entre les deux tours, et le secrétaire de la Fen, André Henry, déclarait plus explicitement que les déclarations communes ou rencontres intersyndicales ne lui paraissaient ni opportunes ni souhaitables. En somme, personne ne tenait à mobiliser, sauf circonscription par circonscription, pour sauver un siège par ci ou par là.
Seule, entre les deux tours, la LCR fit de son mieux pour mener campagne et exiger des meetings unitaires. Car cette démarche était fidèle à notre conduite pendant toute la période écoulée : contre l’austérité, nous discutons pied à pied sur le programme, nous relevons chaque abandon, chaque oubli, chaque concession… mais en même temps, nous menons bataille jusqu’au bout pour l’unité des travailleurs et de leurs organisations dans le débat et dans l’action. Voilà le langage que nous avons tenu et qui nous a guidés jusque dans la bataille entre les deux tours des élections.
IV – Un bilan accablant : depuis 1972, match nul entre le PC et le PS
dans la course à la division et à la collaboration de classe
Le dossier de la polémique entre le Parti communiste et le Parti socialiste, et son dénouement, constitue un bilan accablant.
Aujourd’hui, ils se renvoient l’un l’autre la responsabilité de l’échec. Mais pour qui veut bien se donner la peine d’un effort de mémoire, là n’est pas la vraie question.
Dans un premier temps, le Parti communiste a fait comme si la division résultait de divergences sur le programme et les alliances. Le PS, disait-il, a viré à droite. Que reste-t-il de cette argumentation à l’épreuve de la pratique ?
1. Le PCF, une question de programme ?
Dans une longue déclaration du bureau politique du PCF, publiée au moment de la convention nationale du PS en octobre 1977, il était dit : « Au cours de la négociation, notre parti a fait un important effort de conciliation en présentant des propositions nouvelles, qui sont à la limite de ce qu’il est indispensable d’inscrire dans un accord pour disposer demain des moyens d’apporter aux travailleurs les changements qu’ils attendent. » (L’Humanité du 11 octobre 1977). Deux mois plus tard, le rapport de Georges Marchais à la conférence nationale du 8 janvier maintenait la même intransigeance :
« La politique que propose le Parti socialiste représenterait-elle au moins un pis-aller, permettrait-elle de faire au moins un petit pas vers le mieux ? Absolument pas ! » (Cahiers du communisme, février 1978, p. 28).
Or, que dit Georges Marchais, le mardi 14 mars, dans son débat au club de la presse, pour justifier l’accord signé la veille avec le Parti socialiste et les radicaux de gauche ? Son explication mérite d’être longuement citée, tant elle est ahurissante : « La déclaration que nous avons adoptée rappelle les objectifs sociaux, définit un certain nombre de moyens nécessaires pour les atteindre, définit encore ce qui sera la base de la constitution d’un gouvernement de la gauche unie si elle l’emporte… Si cet accord a été possible, c’est que de part et d’autre des pas ont été accomplis pour permettre un compromis […]. Ce texte prévoit de nombreuses mesures sociales, dont par exemple le smic à 2 400 F, l’augmentation des salaires, des allocations familiales, des pensions et retraites. Ce n’est pas l’austérité que nous proposons. C’est le contraire de l’austérité ! Les problèmes que je posais au mois de janvier ne se posent pas ce soir, puisque nous avons signé cet accord hier. »
On se frotte les yeux devant un tel numéro de cynisme. L’intransigeance d’octobre et de janvier a été en quelques minutes jetée par-dessus les moulins.
Des pas ont été « accomplis pour permettre un compromis », pas qui font de l’accord un plan contre l’austérité et balaient d’un coup les problèmes posés en janvier. Alors on cherche la trace de ces pas ? Rien dans l’accord que le Parti socialiste n’ait été disposé à signer bien avant le 12 mars ! Le smic à 2 400 F, il y avait consenti depuis plusieurs mois. Les communistes au gouvernement, aussi. En revanche, rien dans l’accord du 13 mars sur l’échelle mobile des salaires ; les 40 heures n’y figurent même pas comme perspective immédiate ; et le relèvement des allocations familiales est prévu par étapes. Quant aux moyens chers au PCF : rien sur les filiales, sur l’impôt sur le capital et la fortune !
Six mois de polémique et de division, trois mois de chantage au désistement, pour en arriver là ! L’escroquerie est énorme. Et, sans se démonter, Marchais conclut son débat radiodiffusé par cet incroyable constat d’autosatisfaction : « Si vous comparez l’accord signé hier à celui que nous avions signé en 1967, c’est dix fois, cent fois plus que ce que nous avions signé alors. »
Preuve est faite, dix fois et cent fois faite, que la discussion sur le programme n’était qu’un mauvais prétexte et le chantage au désistement une grossière manœuvre, dont les raisons profondes sont ailleurs.
Quant aux alliances, la vérification est encore plus rapide. Le PS était accusé de virer à droite, de céder aux sirènes de la troisième force, de rencontrer dans des cérémonies les gens au pouvoir… Mais le PCF ne s’indignait guère des cadeaux électoraux faits par le PS aux radicaux de gauche. Il s’en inquiétait d’autant moins que lui-même, chatouilleux sur l’interprétation du Programme commun au point de mettre dans la balance le geste unitaire du désistement, n’hésitait pas à retirer dès le premier tour ses candidats devant un Binoche ou un Gallet, libres, eux, de tout engagement programmatique et étrangers au mouvement ouvrier.
2. Le PS : austérité et division
Le bilan du Parti socialiste est aussi lourd. Si sa politique avait été défendable devant les travailleurs, il lui aurait été facile de déjouer l’entreprise du PCF. Elle ne l’était pas. C’est pourquoi, le PS était vulnérable à l’offensive du PCF entre septembre et mars, et c’est pourquoi, loin de la contrecarrer, il ne pouvait que précipiter la spirale de la division.
Le PS était incapable de répondre à l’accusation de vouloir gérer la crise, parce qu’il s’y préparait bel et bien. Dès octobre 1974, dans le journal Options, l’économiste du PS, Jacques Attali, reprenait à son compte l’explication de la crise par l’augmentation du prix du pétrole qui fit les beaux discours de Raymond Barre : « La hausse des prix crée une baisse de la masse à distribuer au niveau national, ce qu’aucun pays capitaliste géré par la droite ne peut imposer à ses travailleurs, faute d’une association des travailleurs aux décisions. » Les déclarations des économistes du PS allant dans le même sens ne se comptent pas. Elles sont d’ailleurs officiellement reprises, en pleine polémique, dans le petit livre collectif intitulé « 89 réponses du Parti socialiste aux questions économiques. »
Le PS y prend soin de ne pas endosser le terme trop impopulaire d’austérité : « Si austérité signifie que toutes les couches sociales doivent faire indistinctement les frais de la crise du capitalisme, il est clair qu’elle ne peut faire partie de la politique des socialistes. » Mais ce refus du terme débouche deux lignes plus bas sur l’acceptation du contenu : « Ce rejet d’une telle forme d’austérité n’est nullement contradictoire avec une politique de rigueur économique, n’a de sens que si elle s’accompagne d’une profonde redistribution non seulement des revenus, mais encore des pouvoirs au niveau de l’État, de la région, de la commune, de l’entreprise. Les communistes italiens appellent cette politique austérité ; les socialistes français préfèrent parler de rigueur économique ».
Rigueur ? Austérité ? L’essentiel, et les théoriciens socialistes le reconnaissent, c’est qu’il s’agit quant au fond de la même chose, sous un vocable moins compromettant en apparence. Et ce n’est pas à cette « rigueur » que pensait Michel Rocard à la télévision, le soir du second tour, lorsqu’il regrettait que son parti se soit laissé entraîner par la polémique avec le PCF dans une polémique quantitative, au lieu de mettre l’accent sur les réformes qualitatives, autrement dit sur une décentralisation des responsabilités susceptible de faire avaler la pilule de la rigueur… ou de l’austérité. Comme il vous plaira.
Et n’était-ce pas le même Rocard qui avait confié avant l’été, en plein démarrage de la discussion sur le smic, à une assemblée de jeunes patrons, que les 2 200 F alors acceptés par son parti lui semblaient un maximum, et que 2 000 F auraient été à ses yeux plus « raisonnables ». D’ailleurs, les 89 réponses, publiées quelques semaines à peine avant que Mitterrand cède sur les 2 400 F, faisaient encore du montant du smic un test et un critère de réalisme gestionnaire : « Les 10 ou 20 % qui séparent les différentes positions sur le niveau du smic en mars 1978 ne tracent nullement une ligne de partage entre une stratégie de profonde transformation sociale et une politique de gestion de la crise. Mais ces 10 ou 20 % pourraient bien être la marge qui sépare les bases de la réussite des conditions de l’échec. » Lorsque le PS eut accepté les 2 400 F, Michel Rocard devait se contenter d’un commentaire peu convaincu selon lequel il fallait parfois savoir mettre la politique au poste de commande, avant l’économie.
À bon entendeur salut : le fringant maire de Conflans se place sur orbite pour les présidentielles de 1981, dans le rôle du technocrate efficient.
Dernière perle tirée des 89 réponses, pour montrer s’il en est encore besoin, que le PS, après avoir affirmé à maintes reprises son respect de l’économie de marché, entendait bien par ce biais sauvegarder et restaurer les profits : « Le profit est une partie de la valeur créée, il est le surplus qui apparaît une fois que la force de travail a été rémunérée. Issu du travail de tous, le profit doit être réparti conformément aux intérêts de la collectivité et non approprié exclusivement par les propriétaires du capital. Les socialistes ne sont pas contre le profit lorsqu’il est l’expression d’une richesse nouvelle et réelle pour la collectivité. Ils tiennent pour essentiel que les entreprises soient efficaces et performantes. » Le profit apparaît ici, non comme le fruit de l’exploitation (la notion ne figure même pas dans le texte !) des travailleurs, mais comme le produit naturel de « l’entreprise » (dont l’efficacité et la « performance » louées par les rédacteurs, sont précisément fonction du taux d’exploitation). Il en résulte que les économistes socialistes n’envisagent pas la défense des salaires comme une lutte contre les profits, mais seulement une répartition plus équitable des profits « une fois la force de travail rémunérée » (par une « juste rémunération » ? Définie par qui ? Et selon quels critères ?), c’est à dire une fois extorquée la plus-value par le partage entre profits et salaires. La charité et la bienveillance des maîtres se substituent à la lutte des classes : « il ne faut pas, dans la répartition du profit, oublier ceux qui, en apportant leur travail, ont permis à l’entreprise d’obtenir de bons résultats ». En apportant leur travail ! Et qu’ont apporté les « autres », les patrons ? Le capital ? Mais n’est-ce pas de la plus-value, c’est-à-dire du surtravail accumulé ? N’oubliez pas les pauvres, disent en gros les socialistes aux patrons, dans une tradition plus proche du christianisme social que du socialisme scientifique.
Il n’y a rien d’étonnant, qu’obéissant à une telle logique, le PS ait été plus d’une fois mis en difficulté par les attaques du PCF. Il pouvait toujours dénoncer la stratégie du soupçon : les soupçons en question s’alimentaient à bonne source.
Et il n’y a rien d’étonnant à ce que le PS ait été incapable de répondre à l’offensive de division du PCF par une contre-offensive de l’unité. Il aurait fallu pour cela en appeler franchement et honnêtement à la masse des travailleurs. Ce que le programme et les arrière-pensées du PS rendaient impossible : s’il en appelait au verdict des travailleurs, il prenait le risque d’être le premier condamné sur les questions de programme : smic, temps de travail, hiérarchie, nationalisation. « Le maximum de Programme commun et le minimum d’actions communes », disait déjà lucidement François Mitterrand en octobre 1972. Il est resté fidèle à cette maxime, parce qu’elle est conforme à un programme de collaboration de classes, fait pour gérer l’économie et l’État bourgeois, et non pour mobiliser unitairement les travailleurs et leur donner les moyens de prendre les choses en main.
Devant les travailleurs, PC et PS portent donc une écrasante responsabilité, pour le présent et pour l’avenir.
Du point de vue immédiat et électoral, ces responsabilités ne sont pas tout à fait symétriques : par son attitude sur la question du désistement, le PC endosse une part particulière. Mais du point de vue des intérêts fondamentaux de la classe ouvrière, les deux partis réformistes doivent être renvoyés dos à dos : dans la course à la collaboration de classe et à la division, depuis la signature du Programme commun en 1972, et avec plus d’évidence encore depuis les municipales de mars 1977, ils font match nul.
Pour notre part, nous avons fermement tenu de bout en bout les deux maillons de notre politique :
– prendre nos responsabilités en participant pleinement à la lutte et au débat programmatique contre la crise et l’austérité ;
– défendre inlassablement l’unité des travailleurs et de leurs organisations, comme la condition de la conduite démocratique de ce débat et de la victoire contre la droite.
Nous avons constamment pris pour boussole les intérêts et les besoins de la masse des travailleurs, en nous efforçant de répondre aux questions les plus urgentes, aux problèmes de l’heure, sans nous retrancher derrière ceux du lendemain ou du surlendemain.
À l’heure des bilans, nous sommes prêts à tirer le nôtre, documents en main. Non qu’il soit exempt d’erreurs ou de faiblesses. Mais c’est un bilan de droiture et de continuité, sans concession programmatique sur l’austérité, sans indulgence pour les directions réformistes, sans bavure sur la dénonciation de leurs alliances avec la bourgeoisie, et sans écart par rapport au fil rouge de l’unité des travailleurs qui nous a guidés.
V – Qu’est-ce qui fait courir le PCF ? De l’union sans combat, au combat sans union
Si le Parti communiste et le Parti socialiste sont coresponsables de la division, c’est le premier qui, sur le plan des événements, en a pris l’initiative. D’où la question que se posent nombre de militants et de travailleurs : quelles sont les raisons et les motivations de sa direction.
1. L’explication la plus simple, parce que la plus traditionnelle, reste celle de la main de Moscou. Elle est revenue en force ces derniers temps dans la presse bourgeoise. Maurice Clavel l’a reprise à son compte ; mais aussi certains courants dans l’extrême gauche. Que les dirigeants du Kremlin aient considéré le régime de De Gaulle, puis celui de Giscard comme un élément de stabilité dans le statu quo international est un fait assez connu. Il fut illustré spectaculairement par la visite de l’ambassadeur soviétique à Giscard, en pleine campagne présidentielle de 1974. Plus récemment encore, Raymond Barre a été reçu à Moscou, en octobre 1977, avec des égards assez exceptionnels. Mais si on peut en conclure à une coïncidence conjoncturelle d’intérêts entre la bureaucratie du PCF et celle du Kremlin, cela ne suffit nullement à établir que les intérêts de la seconde sont la cause immédiate de la politique de la première. Cette explication irait en effet à contresens de l’analyse des grandes tendances historiques et de l’étape actuelle de la crise du stalinisme. Il faut souligner une nouvelle fois à ce propos que l’attitude du PCF dans sa polémique avec le PS ne s’est pas accompagnée d’un revirement ou d’une sourdine dans ses critiques aux régimes des pays de l’Est. L’Humanité a pris soin au contraire de marquer une continuité sur ce point : dénonciation des procès contre les intellectuels à Prague, des atteintes aux libertés dans le cas de Biermann ou du retrait de nationalité de Rostropovitch… D’autre part, les frictions se sont multipliées dans les rapports au sein de la Fédération syndicale mondiale (FSM), au point que la CGT italienne (CGIL) s’en est retirée en mars, et que la CGT française menace de ne plus en assurer lors du prochain congrès la présidence qu’elle assure depuis 1945 avec Louis Saillant puis Pierre Gensous. Séguy n’a-t-il pas dénoncé le fait que, « dans certains pays de l’est, toutes les libertés syndicales ne soient pas respectées », tandis que René Duhamel, secrétaire confédéral de la CGT indiquait : « La FSM doit être moins structurée et devenir une organisation très ouverte, un lieu de rassemblement, de rencontre, de recherche. » Rappelons pour mémoire que le comportement des Soviétiques en 1974 n’avait pas empêché le PCF de faire une campagne échevelée en faveur du candidat unique François Mitterrand, et que leur ingérence peu discrète avait été ouvertement condamnée en 1976 dans une interview de Jean Kanapa à France nouvelle.
2. Seconde explication : c’est simple comme bonjour, le PCF ne voulait pas aller au gouvernement ! Soit, mais pourquoi ne le voulait-il pas ? C’est ici que l’affaire se corse. Certains avancent qu’il ne le voulait pas parce qu’il ne voulait pas gérer la crise. C’est lui faire trop d’honneur. Les réformistes savent qu’ils sont rarement appelés à gérer les affaires de la bourgeoisie lorsqu’elles sont florissantes : les mêmes qui se contentent aujourd’hui de cette explication auront du mal à s’y retrouver lorsque demain, tel ou tel parti communiste ira au gouvernement gérer une crise aussi grave. Les variations de position dans la politique du PC risquent fort d’y perdre toute cohérence et de se voir ramener aux lubies de leurs directions.
3. Autre variante de la position précédente : le PCF ne voulait pas aller au gouvernement parce qu’il voulait diviser la classe ouvrière, parce qu’il voulait casser les reins à sa montée. Les arguments du type « ils divisent parce que ce sont des diviseurs » ont toujours été un peu courtes lorsqu’il s’agit de rendre compte concrètement des mille et une façons de pratiquer la division et la collaboration de classe. Si le PCF était entré dans un gouvernement avec les socialistes et les radicaux de gauche (ce qui tenait à environ 1 % des voix), les mêmes camarades auraient pu expliquer qu’il le faisait parce qu’il était dans sa nature de collaborer, et que le gouvernement d’Union de la gauche était le pire rempart réactionnaire contre le mouvement de masse.
Si tout le monde est d’accord pour dire que le PCF est un parti réformiste, donc un parti qui pratique la collaboration contre l’indépendance de classe, la division contre l’unité des travailleurs, par son programme comme par ses alliances, la vraie question demeure ailleurs : pourquoi cette forme de collaboration et de division précisément, et pourquoi maintenant ? Questions qui ne peuvent être réglées par le simple recours à une nature éternelle du PC stalinien, à « une vertu diviseuse » en quelque sorte qui expliquerait aussi mal la division que la « vertu dormitive de l’opium » explique le sommeil. Il faut donc rentrer dans l’analyse concrète de la situation concrète, c’est-à-dire dans la forme que prennent à un moment donné les contradictions d’un parti réformiste stalinien, dans sa triple relation avec les masses qu’il organise, avec l’appareil d’État national dans lequel il s’intègre progressivement, et avec la bureaucratie soviétique (cf. encart page 31).
C’est dans cette perspective que nous avons analysé la contradiction dominante du moment pour le PCF, comme étant celle entre son intégration croissante dans l’appareil d’État (accélérée dans l’hypothèse d’une victoire électorale de la gauche) et le maintien de son contrôle sur la majorité active de la classe ouvrière, contrôle menacé par l’essor électoral du PS et la progression de la CFDT dont les effectifs ont crû de 50 % en dix ans, alors que ceux de la CGT stagnaient ou régressaient dans certains bastions. La question est vitale pour la bureaucratie du PCF, parce qu’elle sait fort bien que, dès lors qu’elle perdrait son hégémonie sur le mouvement ouvrier organisé, elle perdrait du même coup l’essentiel de son attrait aux yeux de la bourgeoisie.
C’est dans ce cadre que le développement de la polémique entre le PC et le PS fut constamment analysé par la LCR, à partir d’une résolution de son comité central le 1er octobre 1977, dont le contenu est développé dans l’article d’Inprecor du 13 octobre 1977 : « La contradiction fondamentale passe pour le PCF entre les liens étroits qu’il conserve avec la classe ouvrière et l’intégration plus profonde dans l’appareil d’État que signifierait sa participation gouvernementale. En cas de victoire de l’Union de la gauche dans un contexte de crise du capitalisme qui impliquerait une politique d’austérité, cette contradiction peut devenir particulièrement aiguë. L’appareil du PCF sait fort bien qu’il aura alors la responsabilité de la basse besogne d’encadrement de la classe ouvrière. De plus, chaque fois qu’il a lâché un peu plus de lest, qu’il a gommé davantage son identité et sa doctrine (par exemple, la dictature du prolétariat) pour mieux ressembler à un « parti de gouvernement » respectable, la dynamique électorale unitaire a bénéficié principalement à la social-démocratie. Les municipales ont bien illustré ce double danger pour le PCF. D’un côté la social-démocratie devient le premier parti, de l’autre apparaît un courant de défiance polarisé autour de l’extrême gauche. Une fraction de l’appareil qui semble se regrouper autour de Roland Leroy a donc un réflexe de défense. Il faut d’abord à ses yeux réaffirmer l’originalité du parti comme le seul parti de la classe ouvrière. Et peut-être vaut-il mieux rester dans l’opposition que de se risquer au gouvernement dans d’aussi mauvaises conditions… La bureaucratie du PCF se trouve donc à un tournant de son histoire. Ce tournant ne peut s’opérer sans une violente bataille d’appareil dont le XXIe congrès avait donné des signes avant-coureurs. »
Pour nous, le PCF ne refusait donc pas de gérer la crise, mais il pouvait refuser de la gérer si c’était au prix de l’ouverture de sa propre crise.
1. L’union sans combat
En tant que parti majoritaire dans la classe ouvrière, le PCF s’est trouvé contraint, après 1968, d’apporter une perspective politique, de trouver une solution pour canaliser la combativité montante de la classe ouvrière. Il était prêt à aller très loin pour cela, bien au-delà du Programme commun, vers l’Union du peuple de France, dont l’idée fut lancée au cours de la campagne présidentielle de 1974. À cette époque-là, Georges Marchais ne mâchait pas ses mots, lorsqu’il expliquait aux journalistes Harris et Sedouy enquêtant pour leur livre Voyage à l’intérieur du PCF : « J’ai dit au comité central et je le redis dans le parti, partout où je vais : que cela nous plaise ou non, il n’y a pas aujourd’hui de majorité en France qui souhaite passer à la construction d’une société socialiste […]. Je dis aux militants. si nous nous battons sur ce mot d’ordre, vous allez fêter le 100e et même le 150e anniversaire du parti dans l’opposition […]. Vous et vos enfants […]. Et la bourgeoisie continuera à diriger le pays. Il ne faut donc pas que le programme de transformation que nous proposons aux Français soit trop avancé qu’il entraîne un phénomène de rejet chez les gens que nous pouvons gagner. Le Programme commun, ou en tout cas ses options fondamentales, correspond à ces transformations acceptables par d’autres que les électeurs de gauche […]. D’ailleurs on ne changera pas de société, puisque de société, il n’y en a que deux, capitaliste ou socialiste […]. »
On mesure aujourd’hui la différence de ton entre le Marchais du printemps 1974 et celui de l’automne 1977. Mais le ton de l’époque n’était pas celui du seul secrétaire général, c’était bien celui qui dominait dans un parti pressé d’aller au pouvoir, et prêt à beaucoup pour faciliter cette accession.
Lorsque Mitterrand se présenta en 1974, il se mit au-dessus des partis, y compris au-dessus du sien. Il ne se présenta pas comme candidat du Programme commun, mais comme porte-parole d’une charte présidentielle élaborée par lui seul. Et c’est à ce titre qu’il reçut les représentants des partis de gauche, y compris Mauroy pour le Parti socialiste ! Sur le coup, le Parti communiste ne trouva pas grand-chose à redire. Il ne dénonça ni tournant à droite de Mitterrand, ni abandon du Programme commun. Et pourtant !
Mieux encore. Comme le rappellent Gérard Molina et Yves Vargas dans leur livre récent 2, l’Union n’était guère conçue alors comme un combat, et l’hebdomadaire du PCF, France nouvelle se livrait à l’approche de la date du scrutin à une véritable escalade dans le soutien inconditionnel à Mitterrand, comme l’illustre la chronologie de ses couvertures : « Avec le Programme commun, un rassemblement majoritaire, une chance pour la France » (9 avril 1974) ; « Programme commun, candidat commun, élections présidentielles, défi démocratique, François Mitterrand, réflexions inévitables » (16 avril 1974) ; « 3 hommes, 2 chemins, 1 choix : changer avec le Parti communiste français pour le Programme commun, un candidat commun : François Mitterrand » (23 avril 1974) ; « Avec François Mitterrand. Avec le Programme commun. La gauche pour la France » (30 avril 1974) ; « Autour de François Mitterrand, ensemble pour le changement » (8 mai 1974) ; « Un dimanche, un pays, un espoir. Avec François Mitterrand » (14 mai 1974).
Le comité central du 10 juin suivant continuait sur la lancée. Georges Marchais y présentait le rapport sur l’Union du peuple de France, en proposant « avec une audace sans précédent de tout faire pour élargir au maximum l’alliance des forces politiques et sociales », et en rendant hommage au gaullisme en tant que « courant porteur d’idées et générateur de positions conformes aux intérêts de la nation. » Emboîtant le pas, les membres du comité central rivalisaient de zèle au cours de la discussion intentionnellement reproduite dans L’Humanité. Francette Lazard reprochait à la droite de caricaturer le Programme commun, qui « ne préjuge pas de la suite ; il s’agit de réformes, pas d’un engrenage ». Paul Boccara se félicitait du fait que « le rôle de parti de gouvernement du PCF se soit affirmé dans la campagne ».
Léo Figuières trouvait l’expression « ouvrant la voie au socialisme » malvenue, parce que risquant d’effrayer certaines couches. Jean Fabre recommandait de ne pas « donner l’impression qu’on va plus loin que le Programme commun ».
Toujours sur la lancée, Paul Laurent, membre du bureau politique, confiait à France nouvelle (6 août 1974) que le PS « a rompu dans sa pratique politique avec la politique de collaboration de classe ». D’où il concluait : « On peut parler de l’unité de la classe ouvrière, non plus comme d’un but à atteindre, mais d’un objectif déjà réalisé pour l’essentiel. C’est seulement maintenant, l’unité des formations politiques qui traduisent les grands courants de pensée de la classe ouvrière étant réalisée, que l’on peut envisager sérieusement, comme un objectif immédiat, la réalisation de l’Union du peuple de France. »
Qui aurait osé parler à ce moment de virage ou d’ouverture à droite ?
2. Le coup d’arrêt du XXIe Congrès (décembre 1974) et le combat sans union
Le PCF était donc prêt à aller très loin sur les alliances, le programme, et la doctrine, pour hâter son approche du pouvoir. Mais à la différence de l’Italie, il devait le vérifier bientôt, cette marche forcée risquait de lui coûter très cher.
Contrairement au parti de Berlinguer, celui de Marchais a à ses côtés un parti social-démocrate de longue tradition qui s’est remis en selle à travers la signature du Programme commun, et qui dispose à travers la CFDT d’un réel ancrage syndical. Les élections législatives partielles de l’automne 1974 ont comme dégrisé la direction du PCF ; la montée électorale du PS prolongeait les résultats de son premier secrétaire. Par la suite, d’autres exemples internationaux, les élections portugaises de 1975-1976 puis les élections espagnoles de 1977 devaient confirmer cette menace : l’érosion de l’identité des partis communistes, résultant de leur social-démocratisation progressive, les découvre sur leur droite et risque de profiter électoralement à la social-démocratie.
Les élections municipales de 1977 en France, qui virent dans les grandes villes les listes d’extrême gauche atteindre un résultat inattendu allant de 5 à 10 % apportèrent un autre sujet d’alerte : la politique du PCF l’amenait, en gommant son identité, à se découvrir à la fois sur sa droite et sur sa gauche, à perdre sur les deux tableaux, à précipiter donc la crise de son contrôle sur le mouvement ouvrier.
À l’automne 1974, en pleine préparation du XXIe congrès extraordinaire, s’ouvrit donc la première contre-offensive du PC contre le PS. Préparé comme un XXIIe congrès solennel, le congrès « extraordinaire » changea d’axe en cours de route, et ne fut finalement que le XXIe congrès. Peu après, Rouge alors hebdomadaire consacrait un long éditorial d’analyse du comité central du PCF des 20 et 21 janvier 1975, dans lequel il abordait les questions qui se posent à nouveau aujourd’hui : « Poursuite de la polémique entre le PC et le PS… Rupture de l’accord commercial entre l’URSS et les États-Unis… Conflit entre le PC et le PS au sein du gouvernement portugais… L’addition de ces éléments débouche sur une question. La polémique ouverte par le PCF en octobre dernier fait-elle partie d’un tournant de la politique stalinienne internationale ? Signifie-t-elle un renforcement des liens du PCF avec l’URSS qui n’a jamais vu l’Union de la gauche d’un bon œil ? Ou bien s’agit-il d’un durcissement tactique du PCF répondant avant tout aux contradictions nourries par sa politique nationale ? Une plus sereine appréciation des récents événements internationaux et les travaux du dernier comité central du PCF confirment la seconde hypothèse : le PCF vise principalement à un rééquilibrage de la gauche en sens inverse, à son profit. Il estime avoir le temps d’y parvenir avant les prochaines échéances électorales encore éloignées. »
Nous recensions dans cet article éditorial les motifs d’inquiétude pour la direction du PCF :
– Les législatives partielles de l’automne 1974 ont confirmé « une tendance déjà perçue par les dirigeants du PC au moment des législatives de 1973. Dans certaines régions, le PCF avait alors connu des reculs de 5 %, tandis que le PS progressait symétriquement d’autant. Sentant le vent, la direction du PCF avait fait le forcing peu avant le premier tour, expliquant que le renforcement de l’Union passait d’abord par un renforcement du parti, en réaction contre des conceptions « opportunistes » de l’unité qui se seraient fait jour dans le parti… »
– « A la veille des élections présidentielles de 1974, la Jeunesse communiste avait un retard de 6 000 cartes sur ses effectifs de l’année précédente et près de 700 cercles ou foyers n’avaient pas repris corps… »
– « Dans les entreprises, nous avons plusieurs fois noté les reculs de la CGT aux élections professionnelles, là encore dans les grosses entreprises. La presse de la CGT s’est alarmée de ce phénomène après la grève des banques. Mais le processus est plus général depuis 1968. Il en va de même en ce qui concerne les effectifs même du syndicat. Le pourcentage de syndiqués CGT dans la grande métallurgie de la région parisienne a spectaculairement baissé depuis 1968 (de 16 à 19 % environ) ; et la création de nouvelles sections syndicales dans des entreprises de dimensions modestes n’a pas compensé les pertes dans les gros bastions, loin de là. Parallèlement les effectifs de la CFDT ont progressé de 40 % environ. D’où aussi l’insistance mise par le PCF depuis plus d’un an et dans la préparation de son congrès sur la réanimation des cellules d’entreprise… » À la date de cet article (janvier 1975), le fameux rapport du comité central du PCF de juin 1972, qui mettait en garde contre les conséquences possibles de la signature du Programme commun – et qui fut tenu secret trois ans – n’était pas encore rendu public. Il ne le fut que quelques mois plus tard. Sans en connaître l’existence, nous ne doutions pas de son contenu. Le même éditorial de Rouge indiquait : « En signant le Programme commun, les dirigeants du PCF s’attendaient sans aucun doute à ce que l’accord profite d’abord au Parti socialiste. Mais la fonction assignée au partenaire socialiste, défini comme parti des classes moyennes, c’était de gagner sur la droite l’électorat le plus marqué par les préjugés anticommunistes. Ce qui était moins prévu, c’est que la remise en selle du PS, participant du processus plus général de recomposition du mouvement ouvrier français depuis 1968, contribuerait à remettre en cause l’hégémonie du PCF sur le mouvement ouvrier organisé. » Ce pronostic, d’ailleurs, nous l’avions fait le lendemain même de la signature du Programme commun. À croire que le rapport secret n’en avait pas pour nous, ou bien que le plus secret des rapports ne résiste pas à l’application méthodique de l’analyse marxiste…
L’analyse fondamentale de cet éditorial de janvier 1975 qui interprétait l’attitude du PCF comme une réponse aux contradictions de sa politique nationale et non comme le résultat d’un tournant international de la politique stalinienne, nous paraît avec le recul pleinement confirmé par les faits.
• Entre 1975 et 1977, les prises de distances envers la bureaucratie soviétique se sont multipliées et approfondies, et non l’inverse : attitude du PCF à la conférence de Berlin-Est en 1976, polémique avec les soviétiques sur la notion d’internationalisme socialiste, critiques répétées de l’arbitraire contre les dissidents. On ne saurait y voir une manœuvre conjointe et suprêmement machiavélique lorsque le dernier point notamment concerne directement les intérêts intérieurs de la bureaucratie soviétique.
• En revanche, le PCF a su mettre la polémique entre parenthèses lorsqu’il s’est agi d’aller uni à la bataille des municipales, car elles constituaient, du point de vue de ses intérêts d’appareil une bataille bénéfique : les listes unitaires lui ont permis de prendre pied dans un grand nombre de municipalités. En revanche, les modalités du scrutin législatif, en amplifiant la poussée du PS pouvaient aboutir à un écart de 5 % entre les deux alliés et à ce que, les socialistes arrivant la plupart du temps en tête, le mécanisme des désistements donne dans une gauche majoritaire un affaiblissement parlementaire de la fraction communiste. D’où la réaction d’autodéfense vitale de l’appareil, traduite crûment en termes de pourcentages électoraux au moment de la conférence du 8 janvier.
Dans cette réaction, il était inévitable que le débat glisse de la réaffirmation de l’originalité programmatique du PC (de juillet à octobre 1977) à la réaffirmation de son identité de seul parti ouvrier par opposition au Parti socialiste.
C’est le comité central des 6 et 7 octobre 1977 qui marque ce déplacement du débat sur la question de la nature du PS. Dans son rapport, Georges Marchais énumère au moins trois critères qui interdisent au PS de se présenter comme un parti du mouvement ouvrier :
– sa « nature » : il est et reste un parti réformiste ;
– sa « composition sociale » : « peu d’ouvriers, beaucoup de cadres supérieurs de l’État, formés dans le giron de la bourgeoisie » ;
– ses liaisons nationales et internationales avec les « forces attachées au système du grand capital – en premier lieu l’Internationale socialiste ».
3. À propos d’un pronostic : tendance et conjoncture
Au bout du compte, avons-nous apprécié correctement la politique et les contradictions du PCF ? Nous pouvons répondre fondamentalement que oui. Le but du PCF, pour maintenir sa position dominante dans le mouvement ouvrier, était bien d’endiguer la montée du PS et de se renforcer lui-même. Cet impératif commande pour lui l’avenir. L’accession au gouvernement lui était une question subordonnée. Le PC n’a pas décidé froidement de torpiller l’Union de la gauche et de provoquer l’échec électoral de mars. Mais il préférait courir ce risque-là, voire rendre l’échec probable, plutôt que de courir un autre risque : celui de se voir distancé électoralement, puis en termes de sièges par un PS., qui aurait vu dès lors ses marges de manœuvres renforcées pour négocier avec Giscard, congédier un jour si besoin les ministres communistes, réduire le PCF à une force électorale de second plan, entre 10 et 15 % comme les PC portugais et espagnol.
Pourtant, nous nous sommes trompés, lorsque nous nous sommes risqués, jusqu’au comité central de la LCR du 1er octobre inclus, à pronostiquer un « compromis » comme dénouement « probable ».
Mais en quoi nous sommes-nous trompés au juste ?
Ce pronostic était conforme à l’analyse que nous faisons de l’Union de la gauche. Depuis 1968, la radicalisation de la classe ouvrière et la forte polarisation des antagonismes de classes, dans un pays où l’organisation du pouvoir autour de l’État fort bloque les alliances, appellent un débouché politique de la part des partis ouvriers réformistes, en termes de programme et de coalition de collaboration de classe.
L’existence d’une telle perspective est la condition nécessaire pour canaliser et briser au besoin la montée des luttes ouvrières. Le PCF ne trouve d’alibi à sa politique réformiste que dans cette alliance, et le Parti socialiste, réduit à une peau de chagrin en 1968 n’a repris pied dans la classe ouvrière qu’à travers cette alliance. Aussi longtemps que le rapport de force social entre les classes n’aura pas été fondamentalement modifié dans un sens ou dans l’autre, les deux partis auront encore besoin d’une telle perspective.
C’est dans ce cadre qu’il faut analyser l’accord bâclé du 13 mars, au lendemain du premier tour. Il répond à une double préoccupation :
– une préoccupation immédiate et parlementaire : sans accord de désistement, chacun des partenaires risquait de voir sa représentation parlementaire laminée au second tour, alors qu’ils disposaient d’une majorité quasi absolue au premier ;
– une préoccupation politique à plus long terme. Il est frappant de noter que PC et PS s’accusent mutuellement de l’échec et enterrent le Programme commun. Mais l’un et l’autre continuent, en laissant les modalités dans le vague, à parler de l’Union. Si le PS se retournait aujourd’hui brutalement vers Giscard pour accepter ses appels du pied, il le ferait à contre-courant de tout ce sur quoi il s’est reconstruit depuis le congrès d’Épinay en 1971, c’est-à-dire au prix d’une inévitable crise interne et d’une probable régression électorale. Quant au PCF, il ne peut pas, comme dans ses périodes ultra-gauches d’antan se mettre en boule autour de son appareil et de l’Union soviétique (guère menacée !), et s’adonner à la propagande pour les soviets (comme il le fit en 1928). PC et PS ont donc intérêt à laisser l’Union en sommeil, moribonde, mais sans l’achever, car ils risquent d’en avoir à nouveau besoin à l’avenir.
C’est en ce sens que notre pronostic du « compromis probable » correspondait bel et bien à une tendance fondamentale de la période. Ce que nous avons sous-estimé en revanche, c’est l’ampleur des contradictions qui tenaillent le PCF, au point de lui faire prendre des risques considérables de différenciations et de crise interne. C’est au lendemain du comité central du PCF d’octobre 1977, ouvrant la polémique sur la nature du PS, que nous avons rectifié notre position en nous refusant désormais à tout pronostic sur l’issue finale de la polémique et en nous contentant d’analyser les différentes hypothèses. C’est cette modification qu’enregistrait la résolution du bureau politique de la LCR publiée par Rouge le 26 octobre 1977 : « Ainsi s’est déclenchée une partie de poker entre le PC et le PS où chacun augmente la mise sans retourner les cartes. À ce jeu-là, il est difficile de savoir s’ils finiront par se mettre d’accord et quelle sera la nature de l’accord : accord gouvernemental ? Simple désistement électoral ? Ou rupture complète ? Car pour faire reculer ses partenaires, le PCF n’hésite pas à brandir le chantage d’un échec électoral de la gauche. »
Finalement les dirigeants du PCF auront bien réussi à freiner la poussée électorale du PS, la maintenant au-dessous des 25 %, et à éviter que l’écart ne se creuse entre leurs représentations parlementaires respectives. Mais ils n’auront guère réussi à renforcer le PCF lui-même. Il se maintient à peine, avec 20,6 % en termes de pourcentages électoraux. Il progresse dans 44 départements, mais s’effrite dans des bastions traditionnels et perd la bagatelle de 4 députés sur Paris même.
Ils ont signé entre les deux tours l’accord de désistement parce qu’ils auront encore besoin à l’avenir, de cette perspective de l’unité conflictuelle, au prix de maints zigzags bureaucratiques.
À ceux qui se sont laissés prendre au discours démagogique du PCF nous demandons de constater avec nous :
– quand le PCF parle de l’unité, ce n’est pas de l’unité de combat des travailleurs, c’est de l’unité avec les partis bourgeois, pour collaborer au maintien de l’ordre établi ;
– quand le PCF met en avant la discussion sur le programme, ce n’est pas pour mobiliser et fixer des objectifs de lutte, c’est pour couvrir une entreprise de division.
Encore une fois, unité des travailleurs et unité de leurs organisations ne sont pas incompatibles avec la poursuite de la discussion sur le programme. À condition de savoir qui est le juge : les travailleurs eux-mêmes sur la base de leur action et de leur expérience, sur la base d’un débat unitaire et démocratique sur les lieux de travail et dans les syndicats.
VI – Et maintenant ? Échec électoral, oui, reflux, non !
Comment caractériser l’échec électoral du 19 mars et ses conséquences ?
Comme une défaite politique, non seulement des appareils réformistes, mais aussi de toute une couche de travailleurs conscients qui, depuis plusieurs années, se sont mobilisés dans cette perspective, y voyant le débouché politique nécessaire à leurs luttes contre l’austérité ; mais encore pour toute une masse de travailleurs qui encaissent depuis dix-huit mois les coups du plan Barre et que les directions réformistes ont tenu en haleine dans l’attente du changement.
Mais au-delà de cette défaite politique, l’échec électoral du 19 mars ne marque nullement l’amorce d’un reflux, ni une modification du rapport de forces entre les classes et encore moins un renversement de tendance.
Ce qui demeure, au contraire, déterminant, c’est que, par-delà l’échec sur le terrain électoral favorable à la bourgeoisie, les partis ouvriers devancent la coalition gouvernementale et frôlent la majorité absolue. Quelles que soient la déception et la frustration pour des millions de travailleurs, c’est là, quant au fond l’élément déterminant.
Le fait que le rapport de forces entre les classes n’a pas basculé par un écart de 300 000 voix sur un électorat de près de 30 millions se vérifiera rapidement tant du point de vue de la classe ouvrière que du point de vue de la bourgeoisie :
– du côté des partis ouvriers (PS et PC), il sera difficile de se détourner totalement de l’union conflictuelle qui les lie pour passer à la coopération directe avec la coalition au pouvoir :
– du côté de la majorité, il sera difficile aux giscardiens de s’émanciper de leur alliance contraignante avec le RPR (lequel refuse une fois de plus toute modification du mode de scrutin) et de dissocier le PS du PC pour former une nouvelle majorité de centre gauche.
Certes, la presse bourgeoise a salué en Giscard le grand vainqueur de ces élections législatives : personnellement engagé dans la bataille, fort d’une majorité rassemblée sur son nom, il aurait désormais les moyens qui lui firent défaut en 1974 pour appliquer sa politique de réformes.
Pourtant, la percée électorale de l’UDF ne doit pas faire illusion. Il ne s’agira au mieux que d’une fédération parlementaire au sein de laquelle chaque composante entend garder sa personnalité et en aucun cas du grand parti libéral depuis longtemps rêvé par le président pour asseoir les bases d’un régime présidentiel bipartite. De plus, la coalition au pouvoir a été amenée, pour se survivre, à grignoter tous les groupuscules bourgeois, de sorte qu’il n’existe aujourd’hui guère de réserves pour cautionner une nouvelle « ouverture ». Du moins, jusqu’à ce que Robert Fabre parvienne à ressusciter la vieille famille radicale, ou jusqu’à ce que se produisent des fractures au sein du Parti socialiste. Enfin, l’offensive réformatrice annoncée par les giscardiens ne peut se limiter à un flot de bonnes paroles et à un train de mesures dites qualitatives. La campagne électorale a mis en discussion des exigences très concrètes en matière d’emploi et de salaires. Or, ce qui s’annonce, c’est plutôt la poursuite d’une austérité à peine plus tempérée et une augmentation substantielle du chômage, compte tenu du nombre d’entreprises considérées comme « canards boiteux » et maintenues « sous perfusion », dans l’attente des élections. [Passage incompréhensible] Le seul comité interministériel pour l’aménagement des structures industrielles, porterait à lui seul plus de 60 000 emplois « à bout de bras », de source officielle, et l’éventuel arrêt de l’opération « emploi des jeunes » pourrait augmenter de plusieurs dizaines, voire de plusieurs centaines de milliers le nombre de chômeurs.
Pour ce qui est des salaires, la question du smic est significative. Servan-Schreiber demande de porter le smic à 2 400 F courant 1979. Mais Raymond Barre le traite d’irresponsable et s’en tient au programme de Blois qui prévoit seulement une augmentation du smic plus rapide que celle de la moyenne des salaires : encore faudrait-il avoir des précisions sur la dite rapidité, car si le Premier ministre se contentait de suivre le rythme actuel, il faudrait attendre onze ans pour atteindre les
2 400 F payés autrement qu’en monnaie de singe. Enfin, Soisson et Poniatowski parlent du smic à 2 400 F dans le courant de la législature, c’est-à-dire en 1982 ou 1983… Les travailleurs attendront !
En guise de consolation, la presse patronale évoque la relance et la reprise des investissements » que seule l’inquiétude politique aurait gelés. Mais la raison fondamentale est ailleurs : elle réside dans la baisse du taux de profit qui se solde du côté des patrons par une réduction de leurs investissements, en particulier des investissements lourds dans les secteurs des biens d’équipement et de production. La restauration du taux de profit supposerait que soit brisée la résistance des travailleurs aux attaques contre leur emploi et leur niveau de vie. C’est à cette contradiction qui se heurtera inévitablement la nouvelle vague de réformes annoncées par la majorité reconduite.
Dans l’immédiat, les miettes négociables par le patronat au titre d’une nouvelle politique contractuelle, pour apaiser les revendications depuis trop longtemps en attente des travailleurs, ne paraissent pas suffisantes : l’augmentation de certaines catégories de salaires et la cinquième semaine de congés payés. Mais ni le smic à 2 400 F, ni même de quoi commencer à résorber le chômage ! En échange, la direction des prix tient sous le coude une série de dossiers libérant les prix, comme le réclame le patronat, dans les secteurs où il entend accroître au plus vite ses profits et ses marges financières pour se réorganiser.
Sur le plan social, le nouveau gouvernement sera donc acculé à la gestion étriquée d’une austérité à peine modifiée. Sur le plan politique, faute de pouvoir élargir ses alliances et se défaire de la présence encombrante du RPR, il sera condamné à faire du neuf avec du vieux. De son côté, relevé des responsabilités immédiates de la gestion, le RPR aura les coudées plus franches pour conduire sa démagogie sociale et placer Chirac sur orbite pour les présidentielles de 1981.
Il faut donc s’attendre à une résistance forcée de la part des travailleurs obligés de se défendre et à des luttes sectorielles dures. Du fait de la polémique entre le PC et le PS et de l’incertitude qu’elle a fait planer sur l’issue électorale dès l’automne, la campagne a été inhabituellement animée du point de vue des luttes sociales, avec l’explosion de Michelin contre le semi-continu en pleine période de Noël, avec les luttes de l’EGF, des cheminots, des PTT et des hôpitaux du centre à la veille même des élections. Sans parler de tous les secteurs comme la sidérurgie, ou des entreprises comme Lip qui attendaient d’un dénouement électoral une réponse à leur situation.
La classe ouvrière, dans sa masse, est infiniment moins électoraliste que ses directions réformistes.
Elle accorde de l’importance aux élections ; mais pour elle, la lutte de classe ne s’arrête ni ne commence les soirs de scrutin, tous les quatre ans. C’est d’abord la résistance de tous les jours contre l’exploitation et les agressions du capital.
Il faudra faire front à l’austérité et au chômage, dans un pays où la majorité bourgeoise ne se survit que par le trucage électoral et la division des partis ouvriers. Il y a les conditions objectives d’une contre-offensive d’envergure de la classe ouvrière pour arracher par la lutte ce qui était promis par les élections.
Mais les éléments les plus conscients de la classe ouvrière ne se lanceront pas dans une telle bataille sans que soient pansées les plaies de la division et sans que renaisse une perspective politique. Parce qu’ils savent d’expérience que l’importance des enjeux ne permet pas de victoire revendicative substantielle et durable, sans affrontement avec le pouvoir politique en place.
Telle est la contradiction de ce lendemain d’élections tel que nous l’envisagions déjà au comité central du 1er octobre 1977 de la LCR : « En cas d’échec électoral, ce sera un relatif succès de la bourgeoisie qui aura réussi à appliquer le plan Barre et à garder la majorité. Les coups reçus par la classe ouvrière tout au long de cette année peuvent alors provoquer une réelle démoralisation dans certains secteurs. Mais le plus probable, c’est qu’il y aura des explosions sociales importantes, dont la portée et l’efficacité peuvent être limitées par les différenciations même dans la classe ouvrière. Ce sera là le problème principal » (Inprecor, 13 octobre 1977, p. 6.)
Depuis, les formes de la division se sont précisées. La division entre militants du PC et du PS s’est certes nourrie de reproches et de rancœurs. Division entre ceux qui soutiennent la politique de ces partis et ceux qui ont le sentiment d’avoir été trahis. Division surtout entre syndicats, la CGT s’étant alignée sur les positions du PCF et la CFDT ayant fait cavalier seul. Entre les deux tours, les deux centrales ont marqué leur volonté de restreindre au minimum leur pratique unitaire. Au moment de faire face au patronat et à son arrogance, la division des rangs syndicaux menace donc d’emboîter le pas à la division des appareils politiques.
C’est pourquoi, la première tâche que nous nous fixons, c’est d’œuvrer à reconstituer à tous les niveaux l’unité des travailleurs et de leurs organisations, à la forger dans le combat.
D’abord sur les lieux de travail, en mettant à l’ordre du jour l’action commune sur les objectifs promis hier, aujourd’hui à conquérir : pour imposer le smic à 2 400 F, l’échelle mobile, les 35 heures, la nationalisation sans indemnité des entreprises qui ferment et licencient… En mettant à l’ordre du jour, donc l’unité d’action syndicale, la discussion en commun des plates-formes de la CGT et de la CFDT pour arrêter les objectifs de lutte, la perspective de la fusion syndicale, de la centrale unique des travailleurs sur la base d’une démocratie fédérative.
Il est évident que les mots d’ordre politiques centraux qui ont marqué les derniers mois de campagne : dehors Giscard, abrogation de la Constitution de 1958, un gouvernement du PC et du PS qui rompe avec la bourgeoisie et satisfasse les revendications n’ont pas le même sens immédiat et la même actualité. Ils passent au second plan, ils ne disparaissent pas. Les ressortir de la même façon n’aurait aucun impact parce que ce serait faire comme si nous ignorions la réalité de la défaite électorale, il faut continuer à les expliquer. Car, dès qu’il y aura de nouvelles mobilisations, la moindre tendance à la généralisation des luttes, le problème du débouché politique ressurgira inévitablement et ils reviendront à l’ordre du jour.
En mai 1968, dix millions de travailleurs en grève, découvrant brusquement leur force collective, tiraient un trait sur la défaite du mouvement ouvrier en 1958. Leurs partis, à ce moment-là, bien loin de construire avec eux, dans la lutte, un programme pour en finir avec la Ve République s’efforçaient au contraire de canaliser le mouvement. La FGDS était introuvable, Mitterrand magouillait un cabinet « fantôme ». Et le Parti communiste, après avoir crié victoire aux maigres accords de Grenelle, jetait les travailleurs dans le piège électoral tendu par de Gaulle.
Quatre plus tard, en juin 1972, le Parti communiste et le « nouveau » Parti socialiste signaient un Programme commun de gouvernement, auquel se ralliaient, peu après, les radicaux de gauche. Le débat sur les nationalisations fut déjà révélateur à l’époque. Le PC en proposait 25. Le PS restait évasif sur la question. On transigea à 9. Qui avait eu droit à la parole ?
Cinq ans plus tard, en septembre 1977, le « sommet » de l’Union de la gauche se concluait par un constat d’échec et une rupture. On y avait discuté – à 15 négociateurs – du niveau du smic, de la hiérarchie des salaires, du nombre d’entreprises à nationaliser, des pouvoirs des travailleurs dans l’entreprise. Le PC parlait de 729 filiales. Le PS campait sur 250. Il n’y eut pas, cette fois, de compromis. Qui avait eu droit à la parole ?
Six mois plus tard, le 13 mars 1978, le Parti communiste et le Parti socialiste signaient un accord de désistement qui reprenait les grandes orientations du Programme commun de 1972 avec, en plus, le smic à 2 400 F. Aucune allusion n’était faite, dans le texte, aux débats qui avaient provoqué la rupture de l’Union de la gauche, puis la polémique puis la division, puis l’échec électoral du premier tour. Qui avait eu droit à la parole ?
Le Programme commun est désormais enterré, paraît-il. Les travailleurs l’auront vu naître, entraîner derrière lui les succès électoraux de la gauche, tomber malade, puis mourir. Ils n’auront jamais eu droit, en dix ans, à la parole. Les dirigeants du Parti communiste et du Parti socialiste n’y tenaient guère, il est vrai, soucieux, avant tout, de parfaire un programme de gestion du capitalisme en crise. Comment s’étonner, dès lors qu’un vaste courant populaire n’ait pu se traduire, en 1978, par la défaite électorale de la droite ?
Mais ce n’est pas tout. Les travailleurs en sont désormais réduits à compter les points entre les communiqués vengeurs des uns et des autres, faisant porter la responsabilité de l’échec électoral sur le voisin. « Et nous ? », sont-ils tentés de dire, à juste titre, devant un tel spectacle de division.
L’heure n’est pourtant pas à l’amertume. Le Programme commun est mort ? Fort bien. Mais les revendications demeurent. Le smic à 2 400 F, l’échelle mobile des salaires sur indice syndical, les 35 heures sans diminution de salaires, ce ne sont pas les objectifs qui manquent. Il faut s’en saisir pour reconstruire, dans les entreprises, l’unité de combat contre la majorité reconduite. Par-delà les divergences, par-delà des désaccords, c’est tous ensemble qu’il faut forger un programme de lutte anticapitaliste qui unisse les travailleurs.
Il y a dix ans, la classe ouvrière de ce pays a fait l’expérience de la grève générale et de son impasse, dès lors qu’elle ne débouche pas sur la question du pouvoir politique. Elle vient de faire aujourd’hui l’expérience de sa force électorale, dès lors qu’elle ne repose pas sur une unité de combat enracinée sur les lieux de travail et les localités.
Les révolutionnaires ont été les seuls à s’opposer aussi bien à la trahison de la grève générale par la farce électorale de juin 1968, qu’à la trahison électorale par la division de 1978. À eux de frayer la voix maintenant à un mouvement unitaire de la classe ouvrière et de ses organisations, alliant la mobilisation à la base, extraparlementaire, aux débouchés politiques. Ils n’y parviendront qu’en se tournant de toutes leurs forces vers les grands partis majoritaires de la classe ouvrière, où l’heure des bilans nécessaires sera aussi celle des différenciations inévitables, quels qu’en soient les rythmes.
26 mars 1978
Cahiers de la taupe n° 22, avril 1978