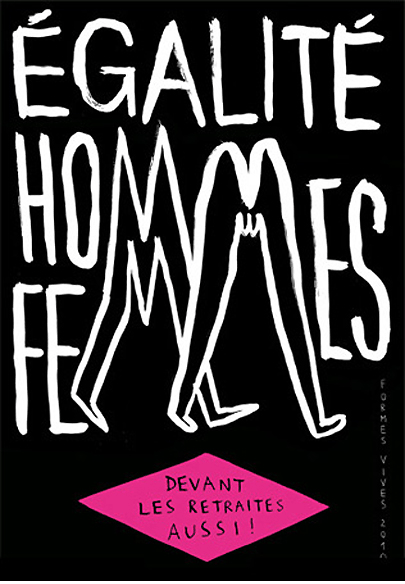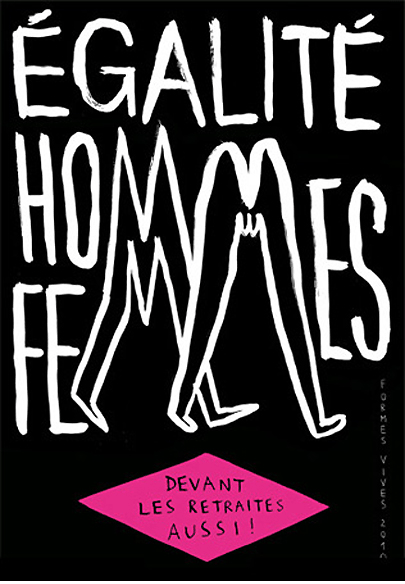
Deux thèmes apparaissent dans le débat public de ces dernières années : d’une part, depuis les grèves de 1995, un intérêt pour ce que la presse appelle « les nouveaux mouvements sociaux », et, d’autre part, une inquiétude quant à la désaffection, à la crise ou au discrédit de la politique.
Ce double questionnement n’est pas tout à fait nouveau. La relation entre le mouvement de protestation et de résistance sociale et les formes de représentation politique est problématique, voire conflictuelle, depuis pratiquement la naissance du mouvement ouvrier moderne au XIXe siècle qui souligne la scission entre social et politique.
D’où vient cette relation difficile entre le domaine des luttes sociales, d’une part, et le domaine des partis et du jeu parlementaire, de ce qu’il est convenu d’appeler « la politique », d’autre part ? Il faut s’interroger sur cette opposition. Dans le vocabulaire dominant, en particulier dans la rhétorique journalistique, la politique gravite autour de l’État. Il y a déjà là un différend, ou du moins un malentendu sur l’idée que nous nous faisons, les uns et les autres, de « la politique ». En ce qui me concerne, la politique n’est pas sous l’emprise exclusive de l’État, réduite au domaine réservé de l’État et des appareils, des institutions ou des partis qui gravitent autour de la sphère étatique.
Si le rapport entre le social et la politique est problématique, c’est d’abord en raison de la grande séparation qui caractérise les sociétés modernes : séparation entre privé et public, entre économique et politique, entre société civile et État, entre droit et morale, l’objectif et le subjectif, etc. Cette séparation se retrouve dans l’intimité même de la marchandise, dédoublée, fendue, écartelée entre valeur d’usage et valeur d’échange, ou encore dans la duplicité du travail : travail abstrait, d’un côté, et travail concret, de l’autre. C’est là un des thèmes qui traverse toute la philosophie et la littérature contemporaines, de Proust à Kafka, à Lowry, en passant bien sûr par Freud. Ce sentiment de division, de mutilation s’oppose à l’idée du monde prémoderne et précapitaliste, dont la cohérence serait établie par l’imbrication des différentes sphères d’activité sociale sous l’autorité et sous l’égide unificatrice du religieux. Autrement dit, la politique n’était alors pas encore dégagée de la vision théologique du monde. Il a fallu beaucoup de temps pour que s’opère le partage entre la théologie et la connaissance profane (avec Bacon), entre la philosophie et de la religion (avec Spinoza) ; pour que s’opère donc la sécularisation de la politique dont le régicide constitue sous la Révolution française l’acte fondateur. Il ne s’agissait pas en effet, d’exécuter simplement un roi félon, mais bien de séparer les deux corps du roi, de rompre le cordon ombilical avec l’investiture divine et avec les fondements transcendants de la morale et du droit.
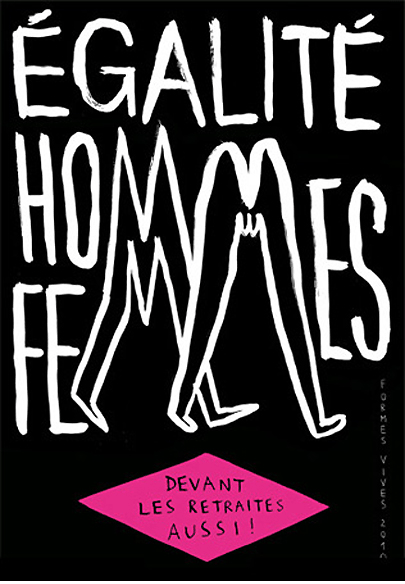 Retour du social
Retour du social
La question sociale qui était en grande partie évacuée ne l’a pas été seulement par un discours philosophique assez prisé dans les années quatre-vingt, et qui commence à avoir du plomb dans l’aile. Ce discours coïncidait avec ce que j’appelle la Contre-réforme libérale. Autrement dit la question sociale refluait et sortait du débat théorique (ou philosophique si vous voulez), mais elle était aussi refoulée dans la réalité par l’effet des attaques contre les systèmes de protection sociale. La question sociale et la solidarité étaient expulsées de l’espace public et renvoyées à la sphère privée du caritatif. Le cas exemplaire en la matière est celui des États-Unis, où, avec le démantèlement des droits sociaux, la responsabilité de l’aide sociale a été renvoyée aux Églises pour un traitement, non plus politique, mais caritatif de la misère, de la souffrance sociale, etc.
On a tous perçu, à des degrés divers, cette inflexion très importante, bien que non définitive : dans ce mouvement de balancier, 1995 marque un retour en force de la question sociale. Au début des années quatre-vingt-dix, il était de bon ton de dire que les manifestations étaient des formes de résistances archaïques, les derniers soubresauts du mouvement ouvrier du XIXe siècle. On a ainsi entendu, que 1968 était certainement la dernière grande grève du XIXe siècle, l’apogée et la fin d’un cycle. La Fnac en avait fait d’ailleurs son slogan. À la veille des grèves de l’hiver 1995, sa grande campagne publicitaire sur fond vert titrait : « Pourquoi le vert ? Parce que le rouge est passé de mode ! » Les publicitaires qui ont inventé ça auraient mérité de compter les drapeaux rouges dans les cortèges et de copier 100 fois, 1 000 fois, comme à l’école : « Je suis un crétin qui ne connaît rien au jeu des couleurs ». Le problème est celui des flux et reflux des luttes sociales et de leur forme d’expression.
L’effet de 1995 a commencé avant : une impulsion, un élan de ce qu’on a appelé ensuite les « nouveaux mouvements sociaux ». Certains existaient bien avant : Droit au logement était apparu place de la Réunion avant même l’occupation de la rue du Dragon. La première marche des chômeurs en France, celle de 1994, précéda d’une année les grèves de 1995. Il y avait aussi des mouvements comme Ras l’Front ; il y avait une renaissance du mouvement féministe : les grèves de novembre et décembre 1995 ont été préfacées par la manifestation des femmes contre la remise en cause des droits à l’avortement et à la contraception. Un renouveau des mouvements sociaux était donc en cours.
Dans le mouvement syndical, ce renouveau s’est évidemment amplifié après 1995. Il avait été annoncé par la formation des Sud, après l’expulsion de la CFDT Poste et télécoms au début des années quatre-vingt-dix. Ce n’est pas un changement total, mais c’est un accélérateur de la remobilisation, avec ses limites et ses faiblesses.
Sur le plan intellectuel aussi on enregistre un changement des images. Le livre de Bourdieu et de son collectif, La Misère du monde, date de 1993 (comme celui de Derrida sur Les Spectres de Marx). C’est l’annonce de quelque chose qui bouge. L’engagement croissant de Pierre Bourdieu dans le combat politique constitue une inflexion importante par rapport à sa position traditionnelle de sociologue scientifique attaché à un devoir de réserve déontologique.
Tout cela est symptomatique. Si l’on veut d’autres symptômes de ce changement de climat : la Sainte Fondation Saint-Simon, la boîte à idées de la Contre-réforme libérale s’est sabordée après 1995, tandis que se constituaient des réseaux de réflexion comme la Fondation Copernic ou les commissions scientifiques d’Attac. Le centre de gravité s’est déplacé à gauche. S’il fallait une preuve ultime, le fait que Bernard-Henri Lévy se soit remis à écrire sur Sartre, et non sur Aron, est un signe irréfutable du changement dans le fond de l’air.
Mais ce changement n’a pas résolu pour autant la question du rapport (toujours aussi compliqué) entre le social et le politique, ce jeu de chiens de faïence et de méfiances réciproques. On aborde parfois le problème sur le thème : il y a discrédit du politique…, les jeunes s’en détournent…, ils ne veulent pas faire de politique parce que le spectacle des partis est lamentable…, le débat parlementaire est creux… Mais pourquoi s’engager, en effet si le choix se limite à une alternance entre une gauche du centre et une droite du centre, ou un centre gauche et un centre droit, etc.
Il y a du vrai dans tout cela. Les affaires, la corruption, ce que certains ont qualifié de climat délétère, tout cela peut effectivement, et je ne m’en réjouis pas du tout, nourrir un certain cynisme politique. Le « tous pourris » n’est jamais très productif ni très encourageant. Il y avait certains rapports au sein du mouvement syndical qui avaient établi, sous des formes certes discutables, des liens entre social et politique : le tandem CGT-PC, le partenariat CFDT-Fen avec la social-démocratie, etc. Aujourd’hui, je ne dis pas que les liens n’existent plus, mais ils sont distendus et l’écart s’est plutôt creusé entre le monde du syndicalisme et de l’association, et celui de la représentation politique. les raisons en sont beaucoup plus profondes que celles généralement avancées.
La privatisation du monde
Il y en aurait probablement plusieurs, mais je n’en retiendrai que deux. La première, c’est ce que j’appelle « la privatisation du monde ». Une conséquence des réformes libérales, c’est de vider l’espace public de sa substance et de ses enjeux. Si presque tout relève de la décision privée, du jeu de la concurrence et du marché, quelles sont les grandes décisions qui demeurent du domaine public ? Il y a privatisation de l’appareil productif et industriel, mais aussi privatisation des services. Elle est largement entamée. Elle est inscrite à l’ordre du jour du prochain sommet de l’Organisation mondiale du commerce et elle va aller s’accélérant.
J’ai enseigné l’an dernier en Angleterre, où le marché des professeurs du supérieur n’est plus encadré par une grille comme celle de la fonction publique dans l’Éducation nationale française. C’est comme le marché des transferts de football ! Un mercato ! Il y a des salaires à la Zidane ou à la Ronaldo ! Malgré ses imperfections le système public français a encore des règles et une déontologie.
Donc, privatisation des services, mais aussi, plus discrète, privatisation du droit : des juristes comme Monique Chemillier-Gendreau ou Mireille Delmas-Marty insistent aujourd’hui sur la montée en puissance des rapports contractuels, au détriment de la loi. La loi commune s’affaiblit au profit de la négociation et de la transaction interindividuelle qui est du droit privé. D’où le traitement du droit par les officines privées, phénomène omniprésent dans les séries télé américaines. Les cabinets d’avocats qui vont démarcher les clients potentiels en prenant un pourcentage sur les résultats éventuels d’une affaire. Il se forme ainsi un véritable marché du droit, avec ses boutiques, ses bonimenteurs et ses charlatans.
On pourrait citer également la marchandisation du vivant et le brevetage forcené des découvertes. Pas encore sur le génome, parce qu’il y a débat sur la ligne de démarcation entre « découverte » et « invention » : ce qui est dans la nature serait de l’ordre de la découverte et ne pourrait pas être approprié de manière privée, tandis que l’invention résultant d’un travail de recherche (par exemple le décryptage d’une séquence génique) n’étant plus naturelle serait appropriable : la séquence deviendrait ainsi brevetable, comme les thérapies qui en découlent, donc privatisable. La génétique en général, non pas encore, mais tel ou tel gène pourrait devenir propriété d’un laboratoire privé ou d’une firme.
Même par rapport aux attentats et au terrorisme, il est évident que l’on est entré dans une logique de privatisation de la violence. Max Weber définissait l’État moderne comme le monopole de la violence organisée. Si l’on retient cette définition, quitte à la nuancer, on comprend que lorsque les États s’affaiblissent, disparaissent, se dissolvent, se réduisent, ou simplement se déterritorialisent, il en résulte une dissémination privée de la violence. Je ne parle pas là des réseaux terroristes : il y a déjà plus de monde dans les milices de gardiennage privées aujourd’hui en France que dans la police publique. Dans le tiers-monde, on le sait, c’est encore pire. J’étais au Brésil dans les années quatre-vingt ; la nuit, dans les quartiers cossus, les rues étaient fermées, gardées par des vigiles privés, avec guérites aux deux bouts de la rue. Les gens se payaient une fermeture de nuit. L’espace urbain était privatisé.
Avec cette logique de privatisation que reste-t-il au débat et à l’espace publics, réduits à une peau de chagrin ? J’extrapole, évidemment, mais le fait est que le jeu politique se vide de substance au profit d’un simulacre et d’un théâtre d’ombres dont les enjeux sont de moins en moins saisissables et dont l’électeur est de plus en plus dessaisi.
La contrepartie est double. Lorsque la politique capitule ou se retire, l’économique apparaît comme une seconde nature et comme une loi naturelle. Le recul de la politique et son discrédit entraînent l’acceptation de l’économique comme une sorte de destin, de fatalité de l’ordre des choses. Le paradoxe est d’ailleurs que les libéraux qui, hier, accusaient Marx de déterminisme économique sont, depuis les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les plus acharnés défenseurs d’un déterminisme économique absolu. Ils vous disent : « On ne peut rien faire, on ne peut pas faire ceci ou cela, on ne peut pas prendre telle mesure sur la Sécurité sociale ou sur l’école publique, parce que les actionnaires et les marchés financiers se fâcheraient ». Il n’y a pas plus déterministe ! On ne pourrait donc rien faire contre la loi naturelle de l’économie et du marché. Mais qui a édicté cette loi ? Qui en a décidé ? D’où vient-elle ? Est-ce une loi divine ? Les marchés sont-ils des despotes ventriloques ? Pourtant, les rapports sociaux, y compris les rapports économiques, sont des rapports humains. Nous les avons créés. Nous devons pouvoir les contrôler, les maîtriser, les changer.
Les compétences et les limites du politique
L’autre raison de la crise du politique, c’est qu’elle suppose toujours l’exercice d’un pouvoir collectif de délibération et de décision inscrit dans certaines conditions de temps et d’espace. C’est une banalité. Si certains d’entre vous ont la curiosité de lire ou de relire Les Politiques d’Aristote, ils verront qu’il est très précis sur la durée des mandats politiques. Dans la démocratie grecque, les mandats sont de très courte durée (quelques mois ou un an). Il y a donc une vraie rotation des charges. Aristote est également très précis sur l’espace de la politique, sur ses dimensions : la cité ne doit pas être trop étendue parce que les cultivateurs doivent pouvoir s’assembler. Il y a presque une définition de l’espace politique adéquat par la journée de marche, ou tout au moins par une certaine distance à échelle humaine.
Toute la pensée moderne sur la politique s’est développée dans l’espace de l’État national et selon les rythmes des mandats électoraux, tous les cinq ou sept ans peu importe. Or l’évolution sociale, technique et économique fait que ces repères sont aujourd’hui bousculés et ébranlés. À quelle échelle se prennent aujourd’hui les décisions ? Qu’est-ce qui relève du niveau régional, national, continental européen, mondial ? Comment se répartissent les compétences entre un conseil municipal et un conseil régional, d’un côté, et ce qui se discute dans les sommets internationaux, de l’autre ? Il y a un éloignement croissant des centres de décisions qui semblent échapper complètement au contrôle des citoyens. Dans quelles dimensions s’inscrit désormais la démocratie souhaitable et possible ?
De même, il y a une mise à mal des rythmes de la représentation politique par la pluralité de plus en plus manifeste des temps sociaux. La politique, qui relève du court et du moyen terme, est débordée par des phénomènes de longue durée, par des temporalités à longue portée. On le vérifie quotidiennement. Les décisions prises aujourd’hui en matière de politique énergétique ou d’émission des gaz à effet de serre ont des conséquences sur plusieurs dizaines d’années, voire de siècles. Un député élu pour quatre ans peut certes s’en soucier dans la mesure où il appartient à l’espèce humaine ; mais cette préoccupation a de fortes chances d’être subordonnée à celle de sa réélection prochaine. L’élection ne se jouera peut-être (probablement ?) pas sur ce qu’il adviendra des ressources énergétiques au siècle prochain ou, a fortiori, au millénaire prochain. Or l’énergie, la déforestation sont des questions qui relèvent de la longue durée.
La politique a son propre timing, sa propre temporalité. La démocratie prend du temps. Le temps de la délibération : le temps de discuter, de décider, de faire des allers-retours entre mandants et mandataires. La démocratie participative au Brésil – une expérience que je connais assez bien et de longue date – implique ces navettes entre les assemblées du budget participatif, les comités de quartier, le conseil municipal élu. Ce conseil doit rendre public son bilan budgétaire six mois avant l’adoption du budget pour l’année suivante, afin de donner le temps à ces navettes et aux amendements. Une procédure démocratique prend du temps, elle a ses lenteurs, elle oblige à ralentir la prise de décision. Pourtant, de plus en plus de décisions sont prises dans l’urgence. Un feuilleton télé a popularisé le thème à partir de l’exemple médical. Mais il y a toutes sortes d’urgences qui entrent en contradiction avec une autre exigence, celle du principe de précaution, qui est une exigence de lenteur. Et c’est vrai qu’il y a des urgences, des décisions de temps court, quasi instantanées qui court-circuitent le débat démocratique.
En matière militaire, ou dans le fonctionnement informatisé des marchés financiers, il y a quantité de décisions instantanées, voire de réponses réflexes à des signaux ou à des alertes sans délibération contradictoire. Cette instantanéité constitue une menace par rapport à ce que requiert de lenteur une vie démocratique, dans toute organisation sociale quelle qu’elle soit.
Cette question du temps et de l’espace est de plus en plus obsédante dans les interrogations sur notre civilisation. Tous les bouquins de Paul Virilio en traitent. Mais les solutions sont difficiles à trouver. Elles sont au cœur des controverses sur les rapports entre expertise et démocratie. Où commence et où s’arrête le pouvoir des experts par rapport aux nécessités de la décision démocratique ?
Les nouveaux mouvements sociaux
Quant aux nouveaux mouvements sociaux, la première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut commencer par tempérer l’idée de nouveauté. Il y a incontestablement des éléments nouveaux, mais ils ne sont pas forcément là où on les croit. Christophe Aguiton vient de publier un bouquin intitulé Le Monde nous appartient, qui brosse une synthèse des mouvements de résistance à la mondialisation capitaliste. Il a surpris certains journalistes parce que, pour eux, les résistances à la mondialisation marchande se réduisaient aux nouveaux mouvements sociaux les plus spectaculaires, aux ONG, aux associations, aux mouvements écologistes, féministes, homosexuels. Il y a bien sûr cette diversité et cette pluralité du mouvement social. Mais ce sur quoi insiste Aguiton, à l’étonnement de certains journalistes, c’est un rappel : « N’oubliez pas que le plus gros mouvement social, malgré son affaiblissement, reste, à l’échelle mondiale, le mouvement syndical. » Et de loin ! L’impact de Seattle n’aurait pas été imaginable sans la participation d’un syndicat qui n’est pas particulièrement radical ni subversif – l’AFL-CIO – qui, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir dans le débat, s’est engagé à Seattle. En Europe, c’est moins le cas. Très peu à Gênes, davantage lors du sommet européen de Nice parce que l’ordre du jour portait précisément sur l’Europe sociale.
Le mouvement des femmes peut aussi porter ces revendications. Tout mouvement évolue au fur et à mesure qu’il accumule les expériences. Mais le mouvement des femmes a pratiquement émergé, au milieu du XIXe siècle, parallèlement à la naissance du mouvement ouvrier et socialiste. Sa courbe d’activité suit pratiquement celle des mobilisations sociales. Il apparaît ainsi au début de la Révolution française, avec les « tricoteuses » et leur participation active aux clubs citoyens, avec des figures emblématiques comme Olympe de Gouges ou Théroigne de Méricourt et leur proclamation des droits des femmes. En revanche, l’hiver 1793-1794 voit l’exclusion brutale des femmes de l’espace public, parallèlement à la répression contre le mouvement populaire, et notamment contre les mouvements sectionnaires parisiens. C’est absolument frappant. Vous pouvez ainsi vérifier le phénomène récurrent d’une revendication féministe, avec une floraison de journaux féministes en 1848 autour de Flora Tristan, puis sous la Commune avec Louise Michel. Il y a là un véritable parallélisme. Quels sont les liens qui permettent de l’expliquer ? C’est un problème majeur. Mais quelle que soit la réponse, la corrélation est indiscutable.
Une nouveauté relative
Il y a néanmoins une part de nouveauté authentique dans « les nouveaux mouvements sociaux ». Max Weber soulignait déjà que le développement de la société moderne va dans un sens de complexité croissante. Ce qui est vrai. Cette complexité a d’ailleurs pour contrepartie la vulnérabilité des sociétés modernes. On pense à la vulnérabilité des systèmes électroniques, aux attentats, au fait qu’un kamikaze armé d’un simple cutter prenne en otage un Boeing ultra-perfectionné. On voit bien fonctionner ce couple entre complexité-sophistication, d’un côté, et fragilité de la société moderne, de l’autre. Plus la société évolue, plus elle se différencie et se complexifie. En se différenciant, elle produit des références, des formes d’appartenance, des revendications, qui se chevauchent, se complètent ou se contrarient.
Vous voyez que, bien que défendant Marx avec vigueur, j’en connais certaines limites. Lui pariait au contraire sur le fait que la société moderne irait vers une homogénéité croissante, une polarisation sociale accrue et une simplification des antagonismes de classe. Sa position n’a jamais été aussi simpliste qu’on le prétend parfois, mais la grande industrie était tout de même censée générer une classe exploitée moderne de plus en plus nombreuse, de plus en plus consciente de ses intérêts, et de mieux en mieux organisée.
Sur ce point, il faut rendre justice à Max Weber : il n’y a jamais eu deux blocs, mais des différenciations ont toujours existé. On pouvait espérer au XIXe siècle que l’unification de la classe dominée s’opérerait assez naturellement autour des grosses concentrations de la classe ouvrière industrielle. Ce n’était d’ailleurs pas une illusion de Marx. Il suffit de rappeler le pouvoir d’attraction, dans les constructions narratives populaires, de la figure symbolique de l’ouvrier industriel à la fin du XIXe siècle (chez Zola) et au XXe siècle (dans le cinéma de Renoir ou de Carné, dans le cinéma italien, etc.) jusque dans les années qui ont suivi 1968 quand on essayait de parler aux ouvriers. Pensez au Visconti de Rocco et ses frères, à La Classe ouvrière ira au paradis, voire, dans un registre plus médiocre, au Godard de La Vie est belle.
Dans les amphis de Mai 68, si un cheminot se présentait à la Sorbonne en disant : « Je suis ouvrier… », c’était aussitôt la standing ovation ! On l’acclamait debout sur les tables en trépignant. C’était naïf et mythique, bien sûr, mais c’était une façon d’exprimer le fait qu’on comptait réellement sur cette force qui, dans ses formes de résistance et de lutte, imprégnait et pouvait rassembler l’ensemble de la société et ses aspirations diverses.
L’éclatement du champ social
Aujourd’hui, la déconcentration des lieux de travail et la flexibilisation du travail font que l’image de la classe est brouillée, qu’elle n’apparaît plus comme une sorte de pôle naturel ou de poutre maîtresse, en tout cas plus avec la même force. Les auteurs socialistes du début du XXe siècle imaginaient que l’usine serait la cellule sociale autour de laquelle pourrait se structurer l’éducation, la culture… L’opéraïsme italien des années soixante-dix prolongeait cette inspiration, dont les sources remontent aux premières années de la Révolution russe, ou au mouvement des conseils ouvriers de Turin, lorsque les expériences d’éducation populaire gravitaient autour de l’usine, de même que les services d’entraide, de santé…
La déconcentration actuelle ne signifie pas que la classe ouvrière, y compris industrielle, ait disparu. Il y a un vaste débat autour de la notion même de classe ouvrière et de classe sociale plus généralement. Je suis d’accord avec la formule qu’utilisent Stéphane Beau et Michel Pialoux dans leur livre La Condition ouvrière, résultat d’une enquête sociologique de dix ans sur le bassin industriel de Montbelliard. Ils disent : « La classe ouvrière n’a pas disparu. Elle est devenue invisible. » Ce qui est fort différent. Le discours libéral a fait de la condition ouvrière une condition honteuse, inavouable, culpabilisante. Il a détruit la fierté du métier et, en faisant miroiter la promotion scolaire sans assurer les débouchés correspondants, fait rêver les enfants des classes laborieuses d’une possible évasion sociale. Il y a pourtant eu une époque où l’on pouvait être fier d’être ouvrier. Dans les années quatre-vingt, en revanche, c’est devenu une sorte de stigmate social, le signe d’une défaite et d’un échec. Ce n’est pas toujours irréversible. Ainsi, pendant l’hiver 1995, il y a eu une reconquête partielle de la fierté du métier à travers la lutte des cheminots qui ont une histoire très particulière.
Il faut donc prendre en compte l’effet réflexif d’un certain discours sociologique ou médiatique sur l’image que la société se fait d’elle-même, sur ce qu’elle valorise ou dénigre. À une époque où le modèle social tourne tout entier autour des « gagnants », des Tapie, des aventuriers de la finance, si on est resté un travailleur manuel, c’est que l’on est le dernier des minables. Cette culpabilisation apparaît aussi bien dans le livre de Bourdieu sur La Misère du monde, que dans celui de Beau et Pialoux, ou dans le film Ressources humaines. C’est aussi l’une des sources de la souffrance ouvrière aujourd’hui analysée par Christophe Dejours.
La complexité croissante des rapports sociaux est l’un des thèmes centraux de la sociologie critique inspirée de Bourdieu. On ne peut pas penser la société comme spontanément unifiée. On est obligé de mettre au pluriel les champs sociaux. Il n’y a pas une société homogène, au singulier. Il y a le champ économique, le champ scolaire, le champ médiatique, le champ culturel, etc. À ces différents champs correspondent, au pluriel également, des capitaux. Il y a bien sûr le capital proprement dit, celui des financiers ou des industriels, mais il y a aussi des capitaux culturels, des capitaux symboliques. Ces outils de représentation permettent de penser la société de façon plus complexe. Bourdieu distingue ainsi des « dominants dominés » et des « dominés dominants » : des enseignants qui sont dominés en tant que force de travail, du point de vue économique, seraient aussi dominants dans la mesure où ils détiennent un pouvoir culturel. Ce sont des hybrides, et ces hybridations font que la construction des solidarités sociales ne va pas de soi, qu’il faut batailler pour construire, unifier, lier en gerbes ces solidarités.
On note donc bien une sorte d’éclatement lié à la diversification des champs sociaux. Les problèmes d’urbanisation ou d’écologie ne se règlent pas au même rythme que les décrets économiques ou que les lois pénales. Le refoulement du social et des fonctions sociales de l’État a pour contrepartie la montée en puissance de l’État carcéral. Les études sur les États-Unis montrent que la population carcérale américaine devient un enjeu économique majeur. C’est une source de travail gratuit ou presque, semi-esclavagiste. Car il y a 1 600 000 détenus aux États-Unis. Rapporté au chiffre global de la population, cela ferait en France l’équivalent d’environ 500 000 personnes. Or nous comptons actuellement 45 000 détenus en France, et les prisons sont saturées. Vous imaginez, 500 000 détenus ?
Quand il y a des luttes pour le logement, sur les droits des homosexuels, il n’y a pas de force centripète qui s’imposerait naturellement entre ces mouvements sociaux. Des résistances s’organisent à partir de problèmes et d’intérêts spécifiques au départ. D’où le problème difficile du rapport des mouvements sociaux entre eux. Quel lien entre ces mouvements éclatés ?
C’est une question décisive. Aujourd’hui, il y a, dans le « champ philosophique » (pour parler comme Bourdieu), certains discours qui font de dispersion vertu. C’est l’un des thèmes des discours post-modernistes en vogue dans les pays anglo-saxons. Certaines critiques portées par ce discours postmoderne sont très fortes. Mais il s’agit pour moi d’un discours qui, malgré des aspects intéressants, enregistre l’émiettement du monde et se résigne à cet univers en miettes, à ces individus en miettes.
La Queer Theory, théorie queer (que l’on pourrait traduire par « étrange » ou « bizarre »), qui s’est développée ces dernières années dans le mouvement homosexuel américain, est l’expression de cette situation où la différenciation croissante aboutit au fait que chacun et chacune est un individu à ce point singulier, que cette singularité fluide fait de chaque personnalité une sorte de kaléidoscope. On est tantôt homo, tantôt hétéro, tantôt postier, tantôt philatéliste, tantôt gastronome, tantôt culturiste, plus ou moins femme et plus ou moins homme, déterminé selon les instants par sa famille, sa classe, son sexe ou sa race. Ce miroitement d’appartenances changeantes aboutit à ce que l’on ne puisse plus concevoir ni construire, non seulement un mouvement social du type syndical ouvrier, mais également un mouvement des femmes ou des homosexuels qui les enfermerait dans une appartenance particulière au lieu de laisser faire le libre jeu de leurs métamorphoses permanentes. On en arrive à l’idée que toute forme organisée fige les appartenances et gèle la diversité. Cette dissolution extrême du collectif ne permet plus d’établir et de faire évoluer des rapports de forces.
Ce type de discours peut apparaître comme un discours de libération individuelle et d’individualisation extrême. Poussée à bout, sa logique est pourtant parfaitement compatible avec la représentation marchande. Il y a une discussion intéressante à avoir avec ce courant queer. Puisque chacun(e) est consommateur(trice), les goûts, les désirs, les caprices peuvent varier à l’infini. Il ne faut pas se laisser enfermer dans des catégories sociales.
Mais c’est aussi une façon de déconstruire les solidarités sociales et le sens du collectif. La question posée est alors la suivante : peut-on encore penser des raisons profondes de convergence entre les différents mouvements sociaux ? C’est une question cruciale. S’il n’existe pas, dans la société moderne, dans ses logiques sociales, dans les pratiques et les résistances nouvelles, des dynamiques poussant ces mouvements à converger, alors leur convergence ou leur rassemblement ne relève plus que d’un pur impératif moral, de la volonté arbitraire d’un parti ou d’une avant-garde de sociologues ou d’intellectuels.
Le problème est de savoir si, oui ou non, la société moderne qui engendre d’un côté des divisions et des différenciations, qui désorganise les solidarités, crée aussi, en même temps, des tendances inverses, à reconstituer des solidarités et des collectivités sociales. Tous les gens qui pensent finement les différences butent sur ce problème. On dit, par exemple, que les mouvements sociaux ont les uns envers les autres une « autonomie relative ». Mais relative à quoi ? Dire « relative », cela implique un rapport à quelque chose d’autre. Cela veut dire qu’il n’y a pas simple juxtaposition de mouvements indifférents les uns par rapport aux autres. Bourdieu quant à lui parle « d’homologie ». D’autres parlent d’articulation. Mais est-ce que c’est articulable ? Quelqu’un qui joue un rôle important dans le débat anglo-saxon, Nancy Fraser, distingue deux grands types d’injustices : des injustices (sociales) de distribution de la richesse et des injustices (symboliques) de reconnaissance, notamment envers les homosexuels, les femmes ou le mouvement, les Noirs. Et estime que ces deux injustices sont autonomes l’une par rapport à l’autre, mais articulées de « façon complexe ». De façon complexe ? Comment au juste ?
On ne résout pas la question par des mots et des jeux de mots. Certains auteurs avancent que tous les champs ne sont pas équivalents, ne jouent pas le même rôle dans la structuration du rapport social. Bernard Lahire, qui enseigne à l’IEP de Lyon, soutient que les champs permettent de penser la diversité du social, mais que le champ économique traverse tous les autres. Le rapport de genre finit par renvoyer aux équipements collectifs, à la division sociale du travail, aux discriminations législatives ; de même, la question écologique renvoie aux choix en matière d’aménagement du territoire. Tous ces champs ne pèsent pas du même poids. Lahire reste donc « classique » en soulignant une spécificité du champ économique et des rapports de sexes qui surdétermineraient l’ensemble des rapports sociaux.
Bourdieu lui-même dit – ce qui paraît évident – que le champ politique a la particularité de ne jamais pouvoir s’autonomiser complètement. La politique n’est pas quelque chose qui flotte en lévitation au-dessus de la société. Elle est l’expression et la mise en délibération des contradictions sociales. Cela se vérifie du point de vue des mouvements sociaux eux-mêmes. Un mouvement antifasciste ou un mouvement contre le déploiement des missiles dans les années quatre-vingt ont leur importance, mais ils sont conjoncturels et peuvent disparaître. D’autres, en revanche, ont une permanence et répondent à un rapport de travail (d’exploitation et d’oppression) : c’est le cas du mouvement syndical. À condition de ne pas concevoir le syndicalisme comme un strict syndicalisme d’entreprise. Ce qui n’était pas le cas à l’origine. À l’époque des bourses du travail, il remplissait bien des fonctions territoriales, d’entraide, de soutien aux conscrits, de loisir…
Le succès d’un syndicat comme Sud, c’est d’abord de s’emparer d’une aspiration démocratique par opposition aux bureaucraties lourdes, ensuite de travailler la qualité de l’information, enfin de redéployer la vie syndicale dans un éventail de résistances sociales. On a parfois critiqué un syndicalisme politique, mais Sud ne s’est pas contenté d’être un syndicat revendicatif ou corporatif : il est intervenu dans toutes les luttes, celles des sans-papiers, des chômeurs, des luttes pour les médicaments génériques contre le sida, etc. On voit là se réinventer des pratiques syndicales.
À partir du moment où les pôles d’attraction que furent les grandes usines ne sont plus aussi visibles, la résistance sociale est plus disséminée et ramifiée. Mais deux mouvements jouent un rôle différent des autres, ne serait-ce que par leur continuité : le mouvement syndical ouvrier et le mouvement des femmes. Ce dernier répond à une oppression qui existait bien avant le capitalisme et le rapport salarial, et qui malheureusement ne disparaîtrait pas du jour au lendemain grâce aux seules transformations radicales des rapports de propriété. Les rapports psychologiques de domination et les rapports de sexes sont imbriqués aux rapports sociaux de classes mais ne s’y réduisent pas.
Un nouvel engagement politique
Le problème dans tout cela – et c’est l’objet d’un dialogue possible avec la problématique de Bourdieu –, c’est que le grand sujet et le grand unificateur de la société moderne, c’est le grand personnage créé par Marx, le Capital lui-même. Cela ne signifie pas que tout se réduise aux rapports sociaux capitalistes, mais si l’on pense à la plupart des grands problèmes auxquels s’attaquent les mouvements sociaux, on découvre là le fondement de leur convergence possible.
Prenons la question écologique. Il peut y avoir des crises écologiques résultant d’une gestion et d’une gabegie bureaucratique. On connaît le désastre de la mer d’Aral ou celui de Tchernobyl. Mais dans nos sociétés de marché, la question écologique est étroitement liée à des problèmes de rentabilité à court terme, à des critères de profit. Un monde régi par la loi de la valeur, dont l’échange de richesses est réglé par l’arbitrage à courte vue des marchés, peut difficilement prendre en compte de manière organique les conditions de reproduction de l’espèce sur la longue et la très longue durée.
La question des femmes n’est certes pas réductible à la domination de classe, mais, dans la division du travail, dans la structuration du privé et du public, dans le rapport de la sphère domestique à la sphère publique, l’oppression de genre est retravaillée, remodelée, surdéterminée. Il y a un changement des formes d’exclusion de la femme dans la mesure où il y a dévalorisation systématique de toute fonction sociale non directement reconnue comme productive. La vieillesse, l’enfance et la femme sont socialement dévalorisées à partir du moment où elles sont refoulées de ce qui apparaît désormais comme le centre de la production sociale. Les formes d’oppression sont alors modifiées par la relation familiale, la relation de sexe. Je ne prétends pas que le Moyen-Âge et le temps de l’Amour courtois furent un âge idyllique pour la condition féminine. Mais la domination sexuelle se loge et se love dans les rapports sociaux déterminés par la division du travail, par le rôle du travail salarié. Bref, l’oppression aussi est à penser dans son historicité et dans ses métamorphoses.
On pourrait continuer. Quels sont les ressorts de l’oppression ? Pourquoi la perception de l’homosexualité et les formes de l’homophobie changent-elles précisément à l’époque de l’Angleterre victorienne ? Y a-t-il là un rapport avec la représentation moderne du corps, sa machinisation, l’essor du sport de compétition, les dispositifs modernes de dressage corporel ? Le rapport de la question sexuelle au mode de production est évidemment fort complexe. Il met en jeu une multiplicité de niveaux dans la détermination du social. Il en résulte une interrogation qui traverse le mouvement homosexuel : est-ce qu’il devrait être « naturellement » de gauche, et pourquoi le serait-il ?
Pendant toute une période, la mode, dans la réflexion sur le social, le politique et les mouvements sociaux, était à l’apologie de la dispersion et de la fragmentation. L’apologie de la dispersion. C’est ce qui sous-tendait l’idée des coalitions ponctuelles, « arc-en-ciel », contre le mirage des programmes globalisants : plus de partis, plus de visées à long terme ni d’efforts de totalisation. À l’image du caméléon, la pratique politique changerait continuellement de couleur, au fil des coalitions thématiques sur la peine de mort un jour, sur l’avortement ou le cannabis un autre jour : autant de questions, autant de mouvements qui s’agrègent et se désagrègent en permanence, sans pouvoir donner naissance à un projet un tant soit peu unifié à moyen ou long terme.
Reste la question du rapport des mouvements sociaux à la politique. Pourquoi ce rapport est-il plus problématique que jamais ? On parle souvent de la crise des formes politiques. Cela m’irrite énormément. J’ai l’impression que c’est une formule qui permet d’éluder les vrais problèmes. On parle de crise de « la forme parti ». Mais la question préalable serait de savoir ce que proposent les partis ? Quel est le contenu de leur politique ? Discutons-en !
Il y a certes un problème spécifique des formes. Étant donné l’importance prise par les réseaux, les communications transversales, on ne peut plus imaginer des formes de centralisation politique telles qu’elles ont existé dans le passé. Or, un parti c’est aussi un moyen de produire et de faire circuler. Les syndicats également. Aujourd’hui, on utilise des téléconférences entre délégués syndicaux ou comités de grève de la France entière ; on échange de l’information quotidienne (jusqu’à saturation parfois) sur Internet. Cette circulation transversale renforce les possibilités d’autonomie et de résistance à la bureaucratisation fondée sur le monopole de l’information.
Une réflexion s’impose donc sur les moyens de reconquête démocratique dans les partis comme dans les syndicats. Mais cela ne doit pas faire diversion par rapport au fait que le renouvellement est aussi et peut-être d’abord un problème de contenus ou de projets. Quand Chevènement (pas seulement lui) parle, après le 11-Septembre, du retour du politique, il pense à une certaine forme de la politique. Ce qu’il nomme retour du politique, c’est une façon de dire que la dérégulation libérale est allée trop loin, qu’elle va entraîner des catastrophes, qu’il faut remettre un peu d’ordre là-dedans. L’ordre, c’est le point commun entre Bush et Chevènement ! Ce sont des hommes d’ordre. Et ce qui vient en premier dans la remise en ordre, c’est le réinvestissement disciplinaire et carcéral de l’État ; ce n’est pas l’État social, mais l’État pénal et militaire. Les États-Unis ont aujourd’hui le plus fort budget militaire depuis 1985.
Il y a deux ou trois ans, j’ai bondi à la lecture d’une tribune dans Le Monde cosignée par des gens aussi divers qu’Olivier Mongin (de la revue Esprit), Jacques Julliard (éditorialiste au Nouvel Observateur), par des républicains comme Régis Debray. Ils se retrouvaient consensuellement pour monter la garde idéologique autour de la République du contremaître, du surveillant général, de l’adjudant, du père, presque du confesseur ! Si on croit résoudre le problème social par ce type de surenchère disciplinaire, à mon avis, on va au désastre.
Soyons attentifs à ce que la réhabilitation de la politique ne serve pas simplement d’alibi au renforcement des interventions autoritaires et sécuritaires de l’État, et non à une relance des politiques sociales. Il faut aller à l’encontre d’un sentiment assez répandu selon lequel les hommes politiques trahissent tous leurs promesses, il faut aller à l’encontre du dégoût et du rejet démagogique de la politique, qui aboutirait paradoxalement à abandonner la politique à ceux qui en font profession, et, parfois, commerce. On peut penser que les élections ne sont pas justes, il n’empêche que les résultats électoraux pèsent sur les rapports de forces sociaux. C’est l’évidence même. Il y a un risque que la méfiance envers la politique aboutisse à confiner les mouvements sociaux dans un rôle de lobbying qui ne ferait en rien progresser la démocratie.
Je suis toujours un militant politique organisé. Pour moi, c’est une sorte de morale de la politique. Un principe de modestie et de responsabilité. Si j’interviens dans le débat public, parce que mon capital symbolique d’intellectuel ou d’enseignant en philosophie m’en donne la possibilité, quelle est ma compétence spécifique en tant que philosophe qui ferait que mon opinion sur la guerre ou sur la Palestine vaudrait plus que celle de tout citoyen ? La politique en démocratie c’est précisément la compétence des incompétents, c’est la compétence collective qui résulte de la synthèse des incompétences individuelles.
Le fait d’être un grand médecin ou un grand comédien ne donne pas de compétence particulière en matière de politique. Si j’utilise le privilège social de pouvoir publier une tribune dans Le Monde ou dans Libération, je ne prétends pas que mon statut social légitime une parole de surplomb sur tel ou tel problème. Je suis à la fois enseignant en philosophie et aussi citoyen et militant engagé. Cela me paraît une exigence d’honnêteté élémentaire : annoncer la couleur, ne pas biaiser, ne pas cacher son jeu, ne pas avancer masqué, ne pas dissimuler son propre pari (sa prise de parti) sous le manteau de la science ou de l’expertise. D’ailleurs, il n’y a pas d’expertise en philosophie. On doit accepter d’être jugé, comme tout autre citoyen, sur ses actes et ses pratiques.
Il y a bien des leçons à tirer du rapport entre la politique et le mouvement social au siècle dernier. Il y a des principes sur lesquels on ne saurait revenir : l’indépendance du mouvement social, syndical ou associatif, envers l’État ou les partis ; respect des mandats ; contrôle des représentants ; représentation des minorités. Mais pourquoi des syndicalistes ne prendraient-ils pas part à une élection ? Il n’y aurait donc que les professions libérales qui pourraient faire de la politique électorale ? Bien évidemment non. Un travailleur a le droit de faire de la politique. Mais en revanche il remet alors ses mandats syndicaux. Il ne confond pas les rôles et les fonctions. Il n’a pas été élu délégué syndical par ses camarades de travail pour être député. La clarté en la matière est l’une des conditions pour restaurer à la fois la confiance dans le syndicalisme et dans la politique.
Car la politique n’est pas un monopole des « politiques ». Il n’y a pas d’un côté la politique et de l’autre le social. Les mouvements sociaux inventent tous les jours de la politique à leur manière. C’est quoi le mouvement des sans-papiers ? Un mouvement social ? Mais quel est le problème qu’il pose ? La régularisation des sans-papiers ? Certes, mais pas seulement. Il pose aussi la question éminemment politique de définir ce qu’est être citoyen et être étranger au seuil du XXIe siècle, à l’époque de la mondialisation. La cristallisation de l’idée d’étranger par rapport au citoyen est une construction issue de la Révolution française, contemporaine des idées de nation, de frontières. Au début de la Révolution, les droits étaient les droits universels de l’homme et du citoyen. C’est la guerre qui a « nationalisé » les droits et fixé la figure de l’étranger (à travers notamment la loi des suspects). Quand les sans-papiers relancent cette question dans les conditions modernes, ils inventent de la politique.
Dans les débats sur la parité ou sur l’égalité des sexes, on invente aussi de la politique. Quand les chômeurs refusent d’être réduit au statut de victimes immatriculées à l’ANPE, lorsqu’ils posent la question du travail et de l’emploi comme droit, de la notion même de travail, c’est éminemment politique.
En revanche, les formes d’organisation politiques et syndicales ont des fonctions différentes. J’étais au Brésil quand Lula s’est présenté pour la première fois aux élections présidentielles. Il avait remis ses mandats syndicaux. Pourquoi ? Parce qu’un syndicat, c’est un mouvement unitaire. Il y a dans ses rangs des travailleurs socialistes, communistes ou autres. S’ils utilisaient leur mandat syndical pour faire la campagne d’un parti en compétition avec d’autres courants de pensée, ce serait un facteur de division du syndicat. On ne peut pas confondre les rôles pour des raisons fonctionnelles, et non en raison d’une coupure artificielle entre un champ social et un champ politique, non en raison d’une intangible « division du travail » : « la politique aux politiques, le social aux mouvements sociaux… ». Il y a entre les deux une interférence permanente.
L’engagement intellectuel
Un mot sur l’engagement intellectuel. On a entendu parfois dans les médias : pourquoi les intellectuels se taisent-ils ? Cela pose la question préalable de savoir ce qu’est un intellectuel dans la société moderne. Gramsci disait déjà qu’il y a sans doute des intellectuels qui travaillent plus avec les mots qu’avec les mains, mais il n’y a pas de « non-intellectuel ». Tout le monde pense, et de plus en plus. Il y a eu une sorte de sacerdoce intellectuel, cristallisée dans la grande figure des intellectuels-conscience-critique, de Zola à Sartre. Puis Foucault a dit que cette figure s’effaçait et qu’on entrait dans l’époque des « intellectuels spécifiques », spécialisés dans la division du travail. Il n’y aurait plus désormais cette espèce de conscience universelle dépositaire des grandes causes.
En revanche, le problème du rapport entre milieux intellectuels, mouvement social et politique est assez problématique. Bourdieu, vu le rôle qu’il a été appelé à jouer, est très préoccupé par ce problème. Il avait théorisé le fait que la sociologie, en tant que discipline scientifique, imposerait une sorte de devoir de réserve déontologique par rapport à un engagement politique. Or Bourdieu s’est de plus en plus engagé politiquement. Ce n’est pas un engagement de parti, certes, mais ce n’en est pas moins un engagement politique. Du coup, il peine à définir la fonction de l’intellectuel. Il est tenté par une fonction d’expertise et de pédagogie, de passeur de connaissances et de fonctionnaire de l’universel.
C’est une solution peu satisfaisante. Bourdieu est strictement opposé à la notion « d’intellectuel organique » revendiquée par Gramsci. Sa conception d’un intellectuel pédagogue et expert au service des autres, c’est pourtant un peu ce que l’on a (par contresens à mon avis) reproché à Lénine ; c’est-à-dire l’idée d’un intellectuel qui apporterait de l’extérieur ses lumières scientifiques au mouvement social et ouvrier. Il s’agit plutôt, selon moi, de créer les conditions d’une production collective de connaissances et de pratiques critiques.
Deux remarques à ce propos sur la pensée politique de Marx. Il est devenu quasiment banal de prétendre que Marx aurait été un grand philosophe, voire un théoricien intéressant de l’économie, mais qu’il n’y aurait pas chez lui de pensée politique. C’est là une ignorance crasse. Il y a bien un problème de la politique chez Marx. Ne fût-ce que parce qu’il n’a pas vraiment connu les formes modernes de représentation parlementaire. Mais il n’en pense pas moins la politique à sa manière. Pour lui, la politique ne se confond pas avec l’État. Il fonde une politique de l’opprimé. Comment ceux qui sont exclus de la politique étatique peuvent-ils inventer de la politique à leur manière ?
On reconnaît volontiers aujourd’hui la validité critique de la théorie de Marx, mais on lui reproche de ne pas livrer clés en main un modèle de société. C’est précisément parce qu’il rompt avec les grandes constructions utopiques pour chercher les réponses réelles, à l’œuvre dans les contradictions effectives, et non issues des élucubrations doctrinaires de tel ou telle. Inutile de chercher chez lui les plans d’une cité parfaite. Les titres de ses principaux travaux portent le nom de « critique » : Critique de l’économie politique, Critique de la philosophie du droit, etc. Il ne propose pas une théorie positive et dogmatique de la bonne société, mais une critique corrosive de l’ordre existant, afin que, de cette critique, surgissent les résistances et les germes d’autres possibles. Il s’agit de développer ces possibles inscrits dans le réel à partir de la dynamique même des mouvements et des expériences concrètes.
Les revendications portées aujourd’hui par les « nouveaux mouvements sociaux » n’expriment pas un rejet de la politique. Elles traduisent certainement une méfiance et une distance par rapport au jeu politique tel qu’il existe. Mais elles expriment aussi une volonté de réinvestir le terrain de la politique, y compris lorsqu’elles croient le nier ou s’en évader.
S’agit-il d’un nouvel engagement ? Il n’y a pas trente-six manières de s’engager. Plutôt que d’un nouvel engagement, il s’agirait d’une remobilisation.
Beaucoup de choses ont été dites à ce propos à la fin des années quatre-vingt. On mêle dans la confusion certaines tendances lourdes des sociétés contemporaines avec les effets conjoncturels de profondes défaites politiques. Derrière le retrait de la politique et dans les modalités de renouvellement des mouvements sociaux, il y a bien sûr le poids de la contre-révolution stalinienne, de la débâcle des régimes bureaucratiques, de la « déchirure » et du génocide cambodgien… À une autre échelle, il y a aussi l’incroyable cynisme et la banqueroute morale des années Mitterrand. Tout cela se paye.
Mais je voudrais distinguer les facteurs qui relèvent de tendances historiques et les effets plus conjoncturels des flux et reflux des rapports de forces. Il y a toujours eu des hauts et des bas dans la lutte des classes. Il y a des rythmes sociaux et des cycles de mobilisation. J’ai entendu l’expression de « résistance globale » à propos du mouvement antimondialisation : c’est le nom que s’est notamment donné le mouvement catalan contre la mondialisation.
Cela devrait nous inciter à réfléchir sur la manière dont, dans ces mouvements sociaux, se recompose quelque chose qui n’est pas totalement nouveau, mais qui agit sous des formes nouvelles : l’ouverture au monde, la curiosité, un certain type d’internationalisme. Autant les années de recul, les horribles années Thatcher-Reagan, ont été des années de résistance défensive, de repli sur les réalités locales ou nationales, autant les nouvelles générations militantes émergentes s’inscrivent directement dans le contexte de la mondialisation, sont immédiatement interpellées par ses effets et se projettent vers l’avant.
C’est vrai des mouvements étudiants. Avant 1968 il y eut une effervescence dans les grandes écoles en France. Aujourd’hui, aux États-Unis, les facultés en pointe contre la mondialisation libérale sont les plus huppées. C’est à Harvard que l’on trouve le mouvement le plus fort (contre les sweat shop – les « ateliers de la sueur » –, contre l’exploitation du tiers-monde, ou contre le travail des enfants).
Cet engagement international, reste plus limité dans le mouvement syndical. Mais, il apparaît avec vigueur dans le mouvement paysan, qui est le premier de ces mouvements sociaux à avoir reconstruit une sorte d’« internationale » agraire. Ce mouvement que l’on considérait souvent comme le plus prisonnier du clocher, du village, est celui qui se projette le plus vite dans la solidarité mondiale contre les géants de l’agroalimentaire et de la dictature financière. Parce que des militants comme ceux de la Confédération paysanne ne sont pas seulement solidaires des pays du tiers-monde ; ils ont les mêmes adversaires : Monsanto, Novartis, les grands semenciers… Il y a là quelque chose de nouveau, porteur d’espérance.
Débat
Un auditeur : J’ai eu le sentiment que vous évacuiez un peu vite la question du mouvement ouvrier. Où en est-on du point de vue du mouvement ouvrier ? Où en est-on avec la notion de travail aliéné ? Est-ce que ça existe encore comme concept ? Est-ce qu’on peut encore être dans une perspective de libération de cette aliénation ? Ou bien, au contraire, est-ce que le travail aliéné va se résoudre par sa quasi-disparition ?
D’autre part, et c’est une question plus personnelle, Le Capital commence par un très difficile chapitre concernant le problème de l’argent. Je remarque qu’il n’y a pas de capital sans argent. Qu’est-ce que c’est que l’argent ? Ce n’est pas parce que c’est un chapitre difficile qu’il ne faut jamais en parler. Je me demande où en est la réflexion théorique sur cette question de l’argent. Parce qu’autrement on risque toujours de moraliser le problème avec la question des profits. Il me semble qu’il y a là une question théorique importante. Je n’ai pas de théorie là-dessus, mais je m’inquiète d’une position uniquement moralisatrice. Je ne suis pas contre la morale mais enfin Marx ne s’est certes pas situé uniquement dans cette perspective. Il y a donc là un problème difficile que je ne vois pas abordé dans les réunions publiques. Voilà.
Daniel Bensaïd : Sur le mouvement ouvrier, il y a un problème de vocabulaire. J’hésite aujourd’hui à parler de mouvement ouvrier, mais pas parce que je penserais que les classes ont disparu. Dans les années quatre-vingt, on a beaucoup parlé de la disparition de la classe ouvrière. Mais personne ne songe à parler de disparition de la bourgeoisie. Il y a une concentration sans précédent de richesses, de propriétés. Il est donc bien difficile de douter de l’existence d’une bourgeoisie. Mais s’il y a une bourgeoisie, il doit bien y avoir son contraire. L’un ne va pas sans l’autre. Les classes n’existent que dans un rapport antagonique. Cela fait un couple, un couple tumultueux : s’il y a encore des bourgeois, il doit y avoir des prolétaires quelque part, quel que soit le nom dont on les affuble (ouvriers, prolétaires, travailleurs salariés).
L’approche théorique est du reste largement corroborée par la réalité statistique. Le prolétariat industriel a baissé significativement dans la population active au cours des vingt dernières années, mais il représente encore plus du quart de la population active. Comme disent Beau et Pialoux dans leur enquête sur Montbéliard, les ouvriers sont peut-être devenus invisibles, mais ils existent toujours. La distinction me paraît intéressante. Parler de classe ouvrière ne renvoie pas uniquement à un recensement sociologique mais aussi à une représentation discursive, à des repères symboliques, à des images. La classe ouvrière, ce n’est pas seulement des gens qui auraient la même condition, qui se vivent comme une collectivité qu’on peut appeler classe. C’est aussi le produit d’expériences, de luttes, de discours. Le vocabulaire crée des valeurs.
C’est pourquoi je suis pour mener les batailles de vocabulaire. Non par dogmatisme borné, mais parce que la façon de parler est aussi une façon de penser. Je suis exaspéré par l’inflation d’euphémismes et de périphrases : on ne dit plus qu’il faut révolutionner le monde, mais qu’il faut faire de la transformation sociale ; on ne parle plus de lutte des classes, mais de « conflictualité sociale ». On met des patins aux mots pour ne pas rayer le parquet. On finit par penser en demi-teinte, en camaïeu, gris sur gris. Remettons de la couleur au vocabulaire. Appelons un chat un chat ! C’est plus clair et cela donne un peu plus de repères.
Un autre motif de réticence à utiliser le terme de « mouvement ouvrier » et de lui préférer celui de « mouvements sociaux », c’est que, dans la culture politique française en particulier, le terme « ouvrier » est très lié à une certaine image de l’ouvrier industriel. C’est différent en anglais ou en allemand, où Arbeiter ou Worker a un sens plus large, plus proche de travailleur. Ouvrier, chez nous, est tout de suite associé à l’ouvrier industriel. Il y a en France une culture ouvriériste qui vient de loin, du syndicalisme révolutionnaire, que le Parti communiste a entretenue avec à la clef une méfiance tenace envers les intellectuels. Il y a à cela des racines lointaines, qui remontent aux rapports problématiques entre le mouvement ouvrier naissant et la petite bourgeoisie jacobine de 1848 ou de 1871. Les mémoires du communard Lefrançais sont très éclairantes à ce sujet. Toute la littérature de Nizan est ainsi fondée sur le complexe de l’intellectuel comme traître en puissance, transfuge de classe, candidat à la cooptation sociale.
J’hésite donc, peut-être à tort, à employer le terme d’« ouvrier » parce que des tas de gens qui sont aujourd’hui dans la condition ouvrière au sens large ne s’y reconnaissent pas et ne s’y estiment pas représentés. Qu’est-ce qu’une caissière de grand magasin, si l’on considère sa place dans la division du travail, son revenu salarial et son rapport à la propriété des moyens de production ? Elle peut posséder un pavillon en banlieue, mais est-ce qu’elle accumule du capital, des actions, des stock-options ? Évidemment non. Et même si elle détient trois sicav, elle n’a pas voté les fermetures de Danone ou de Lu.
Un terme plus vieillot en apparence, celui de « prolétariat », me paraît finalement plus adéquat pour évoquer le monde de l’exploitation, dont la figure ouvrière, telle qu’elle a été représentée par le cinéma et la littérature, n’est qu’un moment. Elle apparaît réductrice par rapport à ce qu’il en est aujourd’hui des rapports de classe.
Travail aliéné ? Bien sûr, le travail est aliéné, et plus que jamais en un certain sens. L’idée de travail aliéné renvoie chez Marx à la séparation des travailleurs d’avec les moyens de production. La perte de maîtrise par le travailleur des moyens et des finalités de la production, c’est plus vrai que jamais. Et ce n’est pas seulement vrai dans les activités traditionnelles de production, on en est aujourd’hui à la pleine taylorisation de certains travaux dits « de service ». Je reviens à mon histoire de caissière. Les codes-barres, qui ont l’air de simplifier le travail, en réalité l’automatisent et l’intensifient. Les pools de saisie de textes sur ordinateur, aujourd’hui, c’est aussi du travail à la chaîne. Vous avez des entreprises sous-traitantes en Tunisie ou au Maroc qui comptabilisent le nombre de signes à l’heure que tape une claviste. Le mouchardage au travail ce n’est peut-être plus, ou plus seulement le contremaître sur le dos de l’employé. Mais regardez les contrôles horaires, à la seconde près, intégrés dans les appareils électroniques qui enregistrent automatiquement les pauses et les temps de non-travail. Il y a dans tout cela une aliénation du travail toujours existante, voire renforcée, y compris par les nouvelles technologies de contrôle et les nouvelles formes d’organisation du travail qui vont avec.
Le problème, c’est : comment en sortir ? Il y a un vrai paradoxe, ou une contradiction irrésolue. Vous avez évoqué Marx. Je ne veux pas insister, mais on est quand même obligé d’y revenir. C’est une critique fondatrice de nos sociétés. Cependant, il y a un problème irrésolu chez lui. D’un côté, il n’arrête pas de décrire les effets du travail salarié comme une mutilation physique et mentale du travailleur ; en même temps il soutient que ce sont ces mêmes travailleurs estropiés du travail qui sont la seule force de libération possible porteuse d’une autre société en puissance. Comment passer de cette situation de subordination et d’assujettissement au travail et à la machine (un véritable dressage), à une libération. Est-ce qu’une classe qui subit autant de domination n’est pas condamnée à reproduire sa soumission jusque dans ses propres tentatives d’émancipation ? N’est-elle pas condamnée à reproduire des pratiques de domination ? Babeuf disait déjà sous la terreur que les siècles d’oppression avaient rendu le peuple barbare.
Pour sortir de ce cercle vicieux, Marx avançait une réponse que j’appelle un pari sociologique : le développement industriel allait créer une classe ouvrière de plus en plus nombreuse et de plus en plus consciente, suivant une sorte de loi des grands nombres. À l’épreuve du siècle écoulé, cet optimisme apparaît bien discutable. Je pense beaucoup de mal de la tradition classificatoire de la sociologie française. C’est une tradition positiviste : on crée des catégories et on met les gens dans ces tiroirs, dans ces cases. Vous ne trouvez pas chez Marx de sociologie des classes dans ce sens positiviste. Il analyse une dynamique du conflit social. Certains faux problèmes ont longtemps constitué de véritables casse-tête : où ranger un maître porion, un ingénieur qualifié ? Marx ne se pose jamais la question de ces cas limites. Il raisonne sur de grandes polarités. Les cas limites individuels sont indécidables. Ce qui compte, ce sont les grandes distributions de forces et la façon dont elles se structurent dans le conflit.
Un livre développe ce qui est à mon avis un modèle d’analyse dynamique du rapport de classes. C’est La Formation de la classe ouvrière anglaise d’EP Thompson. La formation de la classe ouvrière anglaise ne se réduit pas au fait qu’il y ait des ouvriers dans les filatures mécaniques qui remplacent le tissage à main. Les termes mêmes de « formation de la classe ouvrière » incluent le fait que s’est constituée une représentation du monde à travers des expériences, des destructions de machines, un discours d’égalité, une notion d’économie sociale. Les individus ne sont pas répartis dans des cases. Dans leurs représentations et dans leurs luttes, ils se construisent une image d’eux-mêmes.
Chez Bourdieu, les dominations ont une telle logique de reproduction et d’auto-reproduction qu’on ne voit plus très bien comment briser leur cercle vicieux. C’est ce que lui a reproché un de ses anciens collègues, Passeron, soulignant qu’il existe, dans les pratiques sociales, des éléments de résistance et d’émancipation. La force de travail est certes une marchandise, mais ce n’est pas une marchandise comme une autre. Elle est vivante, elle résiste à la marchandisation, consciemment ou inconsciemment. C’est déjà le cas lorsque les gens se battent pour défendre le droit à une minute de pause-café, ou le droit d’aller pisser sur le temps de travail.
J’ai critiqué dans Marx Intempestif ce que l’on appelle l’« individualisme méthodologique anglo-saxon », une sociologie fondée sur le calcul des comportements individuellement rationnels. Si tout était réductible au calcul individuel, il y aurait presque toujours intérêt à ne pas faire grève puisque, si la grève est victorieuse, le non-gréviste bénéficiera de ses acquis comme les autres ; et si elle est vaincue, le briseur de grève aura gagné l’estime du patron. il est gagnant dans les deux cas. Mais ce calcul individuel, inspiré de la théorie des jeux, n’intègre pas ce qui se passe dans une collectivité réelle. Le non-gréviste risque de subir la rétorsion de ses collègues. Ils vont pisser dans son vestiaire, couler ses pièces. C’est aussi ça un travailleur collectif. Et ce sont ces pratiques moléculaires qui font qu’il y a de la résistance.
Quant à la question de l’argent, c’est un thème populaire aujourd’hui, parce qu’il embraye sur un imaginaire social très ancien, y compris d’origine chrétienne. La question de l’argent part des deniers de Judas. L’argent est suspect depuis la Bible et les Évangiles. La culture chrétienne originelle est très critique par rapport à l’argent. Péguy a écrit un livre magnifique intitulé L’Argent. Pour lui, l’argent, c’est ce qui corrompt, c’est la richesse illusoire.
La démarche de Marx est très différente. Ce qu’il critique, c’est d’abord le fétichisme de l’argent. On croit qu’il y a là un objet social tout puissant, mais l’argent n’est pas une pierre miraculeuse. Son analyse de l’origine de l’argent est passionnante. C’est une matière homogène, sécable et rare, qui peut mesurer et représenter la richesse et l’abstraction du temps de travail. C’est une longue histoire que la genèse de l’échange monétaire. L’argent n’est que la cristallisation matérielle d’un rapport social. Ce qui caractérise le capitalisme, c’est que la vraie domination n’est pas celle de l’argent, mais celle du capital. Le capital revêt bien des formes au fil de ses métamorphoses. L’argent n’est qu’une de ses manifestations. Le capital, c’est certes le capital monétaire et bancaire (celui qui circule sous forme de monnaie), mais c’est surtout le capital machine, le capital marchandise, la forme générale de la richesse accumulée, dont l’argent est un moment et une facette.
On est loin avec Marx d’une critique moraliste de l’argent qui est passablement hypocrite. Mitterrand fut un champion de ce genre de critique. Il se faisait fort de n’avoir jamais d’argent sur lui. Il ne circulait pas avec des liasses de billets. Il comprenait très bien que le capital et l’argent ce n’est pas toujours la même chose.
C’est important pour comprendre les sociétés modernes. On peut partir de la dénonciation de l’argent sale, mais c’est implicitement supposer qu’il y a de l’argent propre. Qu’est-ce que l’argent propre ? Qu’est-ce que la « pureté » de l’argent ? Il est important de bien resituer cela dans une critique plus fondamentale du capital dont l’argent est seulement un aspect.
Un auditeur : Quand vous avez évoqué l’éveil du politique, vous l’avez centré sur l’investissement de l’État américain dans la fonction militaire, disciplinaire et répressive. Je comprends et je souscris tout à fait à vos inquiétudes, mais vous semblez ignorer que, malgré la grande fracture entre l’État et la société civile que vous avez très bien analysée, c’est tout de même sur l’État et vers l’État que tendent d’abord à s’exercer les mouvements sociaux. Pour cette simple raison que seul l’État peut faire rentrer des réformes dans l’État et les garantir dans la durée. Il y a quelque temps, à Toulouse, je vous ai entendu revaloriser le droit par rapport aux luttes politiques. Effectivement, hors de l’État et du politique (c’est quand même un aspect essentiel de la fonction politique) qui a autorité pour élaborer et imposer la loi à l’ensemble de la société ?
Un autre aspect (parce que vous avez tendance à souligner le côté le plus négatif de l’État), c’est que la fonction de l’État et du droit dans le progrès social est quand même une tradition absolument marquante de tout le mouvement socialiste.
Daniel Bensaïd : Tout d’abord sur la revalorisation du droit. Il ne faut certainement pas considérer le droit comme une simple illusion, comme un simple truquage des dominants. Bien évidemment le droit est la traduction, l’inscription (certainement déformée) de rapports de forces. Mais quand on se bat pour la légalisation de l’avortement ou pour une loi sur les 35 heures, on entend exprimer et inscrire dans le droit un point d’appui pour des luttes futures. Le mouvement ouvrier, le mouvement social, n’a pas cessé de mener des batailles juridiques. La journée de
8 heures, c’est une lutte sociale qui doit trouver sa traduction sur le terrain du droit.
L’idée aujourd’hui affirmée de la loi introduisant une dimension d’objectivité dans les rapports sociaux (avec ses limites) est d’un autre ordre que la simple relation contractuelle. C’est un enseignant respectable et non pas un gauchiste ébouriffé – Supiot, professeur à Rennes – qui dénonce, dans le développement des formes juridiques contractuelles au détriment de la loi, une re-féodalisation du lien social. Le contrat interindividuel reconduit des rapports de domination et de subordination individuels, alors que la loi est censée créer un espace public commun, impersonnel, qui n’est pas une pure illusion juridique. Cela me tient tellement à cœur que j’ai demandé à Monique Chemillier-Gendreau de me confier ses textes sur les contradictions et les paradoxes du droit international, pour les publier en volume dans la petite collection que j’anime chez Textuel. Elle y aborde le tribunal pénal international, le droit et le devoir d’ingérence, etc.
En revanche, sur l’État, on peut avoir une querelle terminologique lourde de malentendus. Il faut essayer de s’entendre sur le fond. Moi, je reste fidèle à Marx, pas par bigoterie orthodoxe, mais parce que l’idée, souvent mal comprise, du dépérissement de l’État reste un fil conducteur important, à condition de bien comprendre qu’il s’agit du dépérissement de l’État en tant que corps séparé. Ce qui est en question, c’est la professionnalisation et la bureaucratisation de la fonction politique. Cela ne veut pas dire dépérissement de la politique.
Il peut en effet y avoir, et elle a fait des ravages, une interprétation antipolitique de Marx, inspirée de la fameuse formule de Saint Simon, selon laquelle l’État disparaîtrait au profit de l’administration des choses. Il ne resterait qu’une pure gestion dépolitisée, administrative, de la chose économique ou sociale. Non, tant qu’il y a de grands choix à faire, tant qu’il faut décider entre plusieurs possibilités, il y a de la politique.
Pour lui échapper, on invoquait souvent, après 1968, l’abondance promise qui dispenserait d’avoir à choisir. C’est un joker auquel j’ai renoncé définitivement. Pour deux raisons. D’abord parce que la notion d’abondance est discutable. Elle implique une sorte de prospérité absolue et de saturation des besoins. On ne voit pas pourquoi, si les besoins eux-mêmes sont historiques, évolutifs et non fixés naturellement une fois pour toutes, qui déciderait que l’on a atteint le niveau d’abondance qui dispenserait de tout arbitrage ? Si on renonce au joker de l’abondance, on devra décider de priorités sociales, par exemple entre la protection de l’environnement, la réduction du temps de travail, une augmentation de la consommation, etc. Il y a pluralité de propositions en débat. Donc, il y a de la politique.
La pluralité de partis, de projets, de confrontations et de libre débat est le moyen de faire apparaître ces choix. Je dirai donc qu’il y a une interprétation gestionnaire du dépérissement de l’État, mais ce n’est pas la seule possible. En revanche, l’idée de réduire la délégation de pouvoir, la professionnalisation, la spécialisation des corps de l’État, constitue un fil conducteur difficile mais qui doit être suivi. Quand vous dites que la loi émane de l’État, je ne suis pas d’accord. Non : c’est l’État qui émane de la souveraineté populaire laquelle constitue le vrai pouvoir législatif.
Pour des libéraux qui se réclameraient de la philosophie politique de Montesquieu, il devrait y avoir des choses particulièrement choquantes dans le fonctionnement actuel des institutions européennes : le pouvoir législatif européen, c’est le Conseil de l’Europe, autrement dit ce sont les exécutifs qui légifèrent. Le problème se pose également sur le plan des institutions internationales. Je suis très perplexe (mais pas nécessairement contre) quant à la question de la Cour pénale internationale. Qui décide ? Qui nomme les juges ? Et surtout, de quel pouvoir législatif émane cette justice ? Il n’existe pas de pouvoir législatif international ; donc, les juges nommés vont énoncer la loi qu’ils vont ensuite appliquer ! C’est exorbitant.
Un point qui m’irrite particulièrement, c’est la façon dont la presse a mis en scène ce problème de souveraineté. Il y a dix ans, on ne parlait pas de « souverainisme ». Le mot même est une boîte noire. Il stigmatise l’idée de chercher dans un repli national des réponses aux problèmes actuels. Je ne le crois pas du tout. Dès que l’on veut chercher des réponses aux questions de l’immigration, de l’internationalisation des services, dans un renforcement des frontières nationales, on met le doigt dans l’engrenage réactionnaire du « produisons français » et « travaillons français ». Ce vocabulaire n’a pas été inventé par Le Pen. Il a seulement ajouté : « travaillons français ». Il en va de même avec les questions des quotas et des lois sur l’immigration.
Appelons ça du nationalisme républicain si l’on veut, mais la notion péjorative de « souverainisme » introduit une confusion délibérée entre un nationalisme réactif et la question de la souveraineté populaire démocratique. Elle aboutit ainsi à s’accommoder du dessaisissement institutionnel auquel on assiste. Il faut retravailler cette notion de souveraineté. La loi n’est pas l’émanation de l’État. La loi et l’État relèvent d’un pouvoir constituant populaire. C’est à cela qu’il faut revenir.
Marx posait en revanche un problème très compliqué sur lequel il faut avouer que l’on n’a pas de bonne réponse disponible. Il y a, dans la tradition du mouvement ouvrier français, une sensibilité libertaire du mouvement social, qui oppose à la démocratie représentative, la démocratie dite directe. Les mots sont maladroits et en partie simplificateurs. Il y a toujours de la représentation. Le problème est de savoir comment la contrôler et comment la contraindre. Ou bien on accepte un certain degré de représentation, ou bien on a un système de mandat impératif. Dans une grève, on peut concevoir un mandat impératif sur des choix à court terme. Dans une délibération sur des choix de société, quand on doit choisir entre la réduction du temps de travail, l’augmentation des salaires ou l’investissement dans la protection de l’environnement, on trouve l’idée de la responsabilité de l’élu par rapport à ses mandants, mais pas nécessairement celle du mandat impératif qui empêcherait la formation d’une volonté générale en réduisant la vie publique à une addition de points de vue parcellaires se neutralisant mutuellement. Si l’on veut une vraie délibération, il faut que les gens puissent changer d’opinion et qu’ils ne soient pas liés avant même que la discussion ait lieu, à l’horizon parcellaire d’une localité, d’une entreprise, d’une université. Le débat a justement pour objectif de faire émerger une volonté générale, une volonté commune. Le problème, ce sont les modalités de contrôle des élus, mais il y a bien une forme de représentation.
On tourne autour de ces questions, notamment quand on parle de démocratie participative. Ce n’est pas la panacée. Je connais bien l’expérience souvent prise en exemple de Porto Alegre. J’ai fait de très longs séjours au Brésil, et à Porto Alegre, tout au long des années quatre-vingt. J’y ai vu naître l’expérience en question. Elle est passionnante et problématique. On ne le dit pas assez ici. Il y a une double représentation : le conseil municipal, d’un côté, élu au suffrage universel, et un contre-pouvoir, de l’autre, qui est l’assemblée des associations de quartier. C’est une grosse ville d’un million d’électeurs environ. Les comités de quartier du budget participatif réunissent entre 50 000 et 100 000 personnes. C’est une minorité active très importante, mais c’est tout de même minoritaire par rapport au suffrage universel. Depuis la quinzaine d’années que l’expérience existe, il est entendu que le dernier mot revient à l’assemblée des comités, donc à une forme de « démocratie directe » ; le conseil municipal ratifie et officialise les décisions au terme d’une navette. Le Parti des travailleurs étant majoritaire dans les deux instances, il n’y a pas eu pour le moment de conflit majeur entre les deux sources de légitimité. Mais cela pourrait arriver. Se poserait alors le problème de savoir qui prime d’une démocratie participative, active mais minoritaire, et de la représentation au suffrage universel. Le dénouement dépendrait de bien des facteurs et des rapports de forces, non seulement au niveau local, mais aussi national voire international.
Je crois que c’est sur ces questions que l’on peut faire avancer le problème, non en se bloquant sur des affrontements symboliques et des questions de vocabulaire.
Un auditeur : Je voudrais poser une question pour revenir plus concrètement sur le thème de la soirée, « les nouvelles formes de revendication », qui nous pose problème à nous qui sommes souvent des citoyens engagés parce que, par rapport à notre culture, elles ne se placent pas tout à fait dans les mêmes conditions que ce à quoi on était habitués. Ces nouvelles formes de revendication sont spectaculaires, violentes, assez individualistes et pourtant elles sont efficaces.
Tout le monde verra à quoi je fais allusion, mais pour donner des exemples ce sont des actions style José Bové, les actions qui ont défrayé la chronique l’année dernière dans une brasserie de la région de Strasbourg où les salariés avaient menacé de faire exploser des charges à l’intérieur de l’usine, ce qui avait effrayé un peu tout le monde et en particulier les syndicats constitués qui disaient : « nous, on respecte l’outil de travail », alors que là l’outil de travail n’avait pas à être respecté, puisque le projet de l’entreprise était de tout démonter et de tout transporter ailleurs.
Ces positions sont aussi un peu individuelles, un peu catégorielles, on voit souvent des actions qui surgissent spontanément de la base avec création de collectifs en dehors des syndicats, et les syndicats s’y rallient après coup. Donc des actions très centrées sur un objectif à court terme, très précises et sans grande envergure. Et pourtant ça marche, puisqu’avec ces actions on obtient des résultats.
Alors, est-ce qu’il faut s’attendre à des formes d’action de ce type dans le futur ? Est-ce que les citoyens que nous sommes doivent les entériner ? Dans le cas du tunnel sous le Mont-Blanc, une contestation assez forte s’est exprimée par la voie légale, puisque les habitants concernés ont participé à un référendum. Mais on leur a dit que leur référendum était illégal. Donc ceux qui utilisent la manière légale se voient balayés et ceux qui utilisent les formes non légales sont entendus. C’est quand même un paradoxe.
Face à tout cela, comment les citoyens doivent-ils réagir ? Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça débouche réellement sur des perspectives, ou est-ce que ce n’est pas un peu quelque part un encouragement de ces nouvelles formes de contestation parce que cela arrange le pouvoir d’amuser un peu la galerie ?
Daniel Bensaïd : Les formes spectaculaires de lutte ne sont pas toutes inédites au même titre. Certaines tiennent à une donnée relativement nouvelle, qui est l’effet en retour de la médiatisation. Le côté spectaculaire de l’action n’est pas que du spectacle. Il crée aussi un événement. Il y a des secteurs ou des mouvements sociaux qui ont particulièrement réfléchi à l’utilisation de l’impact médiatique. Par exemple, un mouvement comme Act-Up s’est construit dans une large mesure là-dessus, comme mouvement minoritaire qui a su utiliser l’ampli médiatique. Ce fut aussi le cas au début du mouvement des chômeurs.
Il y a aussi les formes symboliques de contestation de mouvements de jeunes qui apparaissent un peu partout dans le monde. On ne les connaît pas très bien en France. Ce sont les Tute Bianche en Italie, Reclaim the street en Angleterre, le Mouvement de résistance globale en Catalogne, les mouvements des campus américains contre les ateliers de la sueur, etc. Ces mouvements utilisent le symbolique et l’impact médiatique comme moyens de construire le mouvement. On pourrait se pencher sur l’histoire des pratiques symboliques dans les mouvements sociaux : la chanson, les formes de culture populaire s’emparant des outils qui existent à une époque donnée.
De même, le recours à la violence dans la lutte sociale n’est pas inédit, loin s’en faut. Ce sont aujourd’hui les travailleurs de Celatex dans les Ardennes, ou cette entreprise alsacienne dont les salariés ont menacé de faire sauter l’usine. Ce sont là des formes d’exaspération sociale qui renouent avec des pratiques anciennes de destruction de l’outil de travail comme dernier recours. La destruction des champs d’OGM, ou le fait de renverser les barrières des propriétés, ou les occupations de terre au Brésil ou au Mexique participent d’une dynamique commune. Il y a une tradition dans le mouvement paysan. Sans remonter très loin, on se souvient des luttes des comités d’action viticoles au début des années soixante-dix…
Il y a en revanche une nouveauté : c’est que le rapport à la violence est très différent de ce qu’il était il y a trente ans. Ma génération avait une vision de la violence libératrice et presque innocente. C’était celle du Che, de la résistance vietnamienne. C’étaient des violences positives, en tout cas dans l’imaginaire, perçues comme très légitimes face à l’oppression. Quelque chose a basculé à la fin des années soixante-dix.
J’appartiens à une organisation qui a eu une réputation, non pas de violence, mais de savoir-faire dans le spectaculaire. On a souvent utilisé la violence sur un mode parodique. Les anciens se souviendront de la venue à Paris du Général Ky, qui était à l’époque leader du Sud Vietnam. Il était extrêmement protégé. Nous avons voulu montrer que, malgré cette protection, nous aurions pu le tuer. Nous avons pris pour cela des risques importants. Et nous nous sommes contentés de lui envoyer… une bombe de peinture, pour indiquer que ça aurait aussi bien pu être une bombe tout court. Mais nous nous fixions toujours des limites. Avant les événements de l’ambassade américaine en Iran, en 1979, il était fréquent d’occuper des ambassades pour protester. Aujourd’hui, si on veut occuper l’ambassade américaine, on risque de se faire descendre sans sommation. Ce n’est plus du symbolique. Il y a eu une perte d’innocence. Les sociétés sont beaucoup plus violentes socialement, la répression beaucoup plus impitoyable. Dans ce contexte, la légitimité de la violence devient plus problématique. On le sent bien dans les formes de résistance et de contre-violence à Seattle ou à Gênes.
Dans l’affaire de Gênes, il y a eu tentative de criminalisation du mouvement antimondialisation. Il est à peu près prouvé par les enquêtes que l’initiative de la violence revient largement à la police italienne. Il y a toujours dans ces cas une part de provocation. Il y a toujours des gens plus ou moins violents. Mais la violence de Gênes a très peu entamé la légitimité de la manifestation. Dans un mouvement ascendant de 200 000 manifestants, quelques voitures renversées et un peu de casse, c’est l’écume des choses. En revanche, ce qui est grave, c’est l’assassinat à balles réelles par la police d’un manifestant.
Dans ce contexte, ce qui semble apparaître, c’est une nouvelle culture de la violence, d’inspiration anglo-saxonne, qui est l’autodéfense ou la défense passive. La question devient : comment organiser une résistance collective et non une manif offensive avec cocktails Molotov ? L’idée-force est de ne pas céder à l’autorité, de se mettre en position de légitime défense et non pas d’agressivité.
Cette question de la violence est aujourd’hui très obscurcie et idéologiquement surchargée. La révolution est disqualifiée par son identification à la violence, comme si les contre-révolutions n’avaient pas, dans l’histoire, été infiniment plus cruelles et violentes que les révolutions ! Vous êtes révolutionnaire, donc vous êtes violent par goût et par choix ! C’est devenu un leit-motif médiatique pour éviter d’avoir à discuter de la logique sociale et de son changement radical. J’ai eu une discussion là-dessus avec le sénateur Henri Weber. Lui qui est un grand démocrate disait sans même mesurer la portée de ses paroles : « Vous voulez exproprier le grand capital, et vous croyez qu’il se laissera faire ? Il se délocalisera, il émigrera… Puisqu’il ne se laissera pas faire il faut se résigner à ce qu’il se mette hors-la-loi, à ce qu’il aille à l’encontre de la volonté populaire, plutôt que de recourir à la coercition. On ne peut rien faire contre cela. » Voilà donc un (social)-démocrate qui baisse d’avance les bras lorsque la propriété privée se soustrait à la loi commune et défie la démocratie. Ce sont pourtant deux droits qui s’affrontent, et, entre deux droits, c’est bien, en définitive, la force qui tranche.
Ce qui renvoie d’ailleurs au problème du fondement du droit. S’il n’y a pas de droit divin, le droit tire forcément son origine du pouvoir constituant, et ce pouvoir est constamment révisable.
Quand on demandait aux enfants d’immigrés désireux d’acquérir la nationalité française de prêter une sorte de serment solennel sur la Constitution, je trouvais ça scandaleux parce que, moi, né en France, on ne me demande pas cet engagement. Je suis citoyen, je suis obligé de respecter les lois de ce pays, mais j’ai aussi le droit d’œuvrer à leur changement et à leur modification.
Enfin, à propos des « nouvelles revendications individuelles et catégorielles » : l’évolution sociale va dans le sens d’une affirmation croissante de la singularité de chacun et de chacune. Pour Marx – qui n’a rien à voir avec l’esprit de caserne et le collectivisme bureaucratique – il y a trois critères de progrès humain : la réduction du temps de travail (en tant que travail contraint) ; la relation entre les sexes (qui est le modèle du rapport à l’autre et la première expérience de l’altérité) ; enfin la différenciation des besoins qui fait de chacun et de chacune un être singulier et irremplaçable. Ces critères ne sont donc pas le nombre de tonnes de charbon et d’acier, encore qu’ils puissent y contribuer.
L’aspiration individuelle prend bel et bien dans les luttes actuelles une part croissante. Elle est porteuse d’une exigence démocratique. Elle peut aussi refléter le fait que l’individu devient le simple support d’un rapport de consommation marchande. L’affirmation de la singularité individuelle débouche aussi bien sur une aspiration démocratique que sur la réduction de cette individualité à un individualisme consommateur. Entre les deux, le partage n’est pas joué d’avance.
L’autre problème, qui est lié, est celui des revendications catégorielles et corporatives. Quand on regarde l’histoire du mouvement ouvrier, on constate qu’il n’est pas né d’une seule pièce. Il s’est cristallisé autour d’expériences et de luttes de catégories particulières. On a reproché aux cheminots, au début de la grève de 1995, de défendre des intérêts corporatifs et catégoriels. Il y avait bien, au départ de la lutte, une revendication catégorielle sur les retraites. Et alors ? Cela peut être le point de départ d’un mouvement solidaire et collectif. La dynamique même a fait apparaître que ses enjeux allaient bien au-delà et posaient le problème général du régime des retraites et du service public. D’où le slogan spontané du « Tous ensemble, tous solidaires ! », Le mouvement social s’est toujours cristallisé autour de luttes et de pôles symboliquement forts. Billancourt fut « la forteresse ouvrière » pendant toute une période, les cheminots sont une référence, les mineurs jadis…
Ce qui serait gênant, ce serait d’en rester au corporatif. Mais c’est souvent seulement un point de départ défensif, de défense d’acquis inscrits dans un rapport juridique, dans des organisations catégorielles où se lit le rapport de force. Le mouvement ouvrier s’est constitué à partir de métiers et de traditions particulières. Si on examine la sociologie du mouvement ouvrier en 1848, on voit que ce sont des artisans joailliers, des imprimeurs, des ébénistes, des tailleurs, des cordonniers.
Sur les coordinations, il y a deux choses à souligner. On a beaucoup parlé du phénomène, à juste titre, lors des grèves de 1986, puis des grèves des infirmières. Elles exprimaient deux choses. D’abord, l’affaiblissement de la représentation syndicale, l’entrée en activité de gens qui ne sont pas forcément syndiqués et qui ne sont pas représentés par les délégués syndicaux habituels. Le collectif de lutte doit donc trouver sa propre forme de représentation. Elles exprimaient aussi une aspiration démocratique contre les formes de délégation et de bureaucratisation prégnantes dans les organisations syndicales. Mais ces formes d’auto-organisation ne traduisent pas pour autant une tendance linéaire et inéluctable. Elles soulignent surtout la souveraineté des assemblées généralisée. Les délégués ne sont que des délégués. Le lieu décisoire est l’assemblée. En 1968 encore, c’était loin d’être la règle.
Les formes d’organisation varient. Dans les grèves de 1995, il y a eu, proportionnellement, peu de coordination. Les intersyndicales ont prévalu. D’autant que les coordinations de 1986-1988 ont contribué à renouveler les pratiques et les organisations syndicales elles-mêmes. Notamment dans la santé, à la poste et dans les télécommunications, ou chez les cheminots. D’après les résultats des élections professionnelles, la montée en puissance des Sud exprime ce renouvellement. Je ne dis pas qu’il n’y a que les Sud qui méritent attention, il se passe aussi des choses dans la CGT, la CFDT, etc.
Mais le corporatisme n’est pas nécessairement celui du métier. Il peut aussi y avoir un corporatisme du local. Les habitants des vallées de la Maurienne et de Chamonix veulent se refiler le mistigri du passage des camions. Le référendum d’initiative locale est important, mais à un moment donné il faut bien arbitrer du point de vue de l’intérêt général. On ne peut pas se contenter de dire : « Nous refusons la merde chez nous, mettez-la à côté ! » On en revient au fait que l’addition des souverainetés locales ne fait pas une grande démocratie. On ne peut pas décider des grandes questions d’aménagement du territoire ou de la politique énergétique par simple addition d’aspirations locales. À un moment donné, il faut bien une transaction et un arbitrage central.
C’est un des problèmes de la planification. Elle doit accorder un droit de veto et de contrôle suspensif à ceux qui sont concernés au plus près par la décision. Mais il doit subsister un arbitrage d’intérêt général. On peut se demander si on a vraiment besoin de ce type de transport routier. Si la réponse est non, ce n’est ni la Maurienne ni aucune autre vallée qui doit en pâtir, c’est une autre politique de transports qui doit être recherchée. Mais le débat doit avoir lieu, sous peine de dresser les gens les uns contre les autres en essayant de se refiler les déchets et les pollutions.
Un auditeur : Parmi les nouvelles formes de revendications collectives, il y a le problème de la taxe Tobin. Elle a été évoquée au Parlement européen, et il s’en est fallu de très peu pour qu’elle soit adoptée. Et cela l’aurait été si les députés européens appartenant à votre groupe politique avaient soutenu cette proposition et ils ne l’ont pas fait. J’aimerais savoir comment vous expliquez la position de la LCR sur ce point ?
Daniel Bensaïd : Là, c’est le militant qui est interpellé. Comme quoi je peux difficilement dissocier le titre de philosophe qu’on me colle de l’engagement militant. Le problème du vote de Krivine au Parlement européen est anecdotique. Le fond de l’affaire, c’est plutôt de voir son rapport avec le débat actuel.
Sur le vote lui-même, il n’y a pas de mystère. Il a été très controversé au sein même de la Ligue. Mais il faut savoir ce que sont les procédures de vote au Parlement européen : un vote électronique, taylorisé, on n’a pas le temps de se consulter. Alain Krivine décrit très bien cela dans une tribune du Monde. Comment voter sur la qualité des chocolats belges et sur la taxe Tobin en une minute ! Alain a pris ses responsabilités. Là, on est dans le mandat non impératif et on peut discuter a posteriori qui a eu tort et qui a eu raison. J’avoue que je n’ai pas une réponse assurée. Je pense plutôt qu’il a eu tort et que, pour des raisons pédagogiques, il aurait fallu voter pour, même si les termes de la motion étaient formellement inacceptables.
Car ce n’était pas évident et le vote n’était pas précisément celui que vous dites. Il ne s’agissait pas de décider d’instaurer la taxe Tobin. Le Parlement européen n’en a d’ailleurs pas le pouvoir. Ce n’était pas la question posée. Il y a eu deux votes. Tout cela n’a pas été rapporté avec précision dans la presse.
Un premier vote mettait simplement à l’ordre du jour la discussion sur la taxe Tobin. Cela nos élus l’ont bien sûr voté. Il aurait pu y avoir alors un consensus entre les députés pour voter une motion minimale d’ouverture du débat sur le principe de la taxe et sur ses modalités. La deuxième motion, celle que Krivine n’a pas votée, ne se contentait pas de ça. Ses initiateurs ont a priori limité la portée de la taxe Tobin, avant même la discussion en lui donnant pour but « d’améliorer le fonctionnement des marchés », etc. C’est cela qu’Alain Krivine n’a pas voté.
On peut estimer qu’il fallait passer outre, que l’important, c’était le symbole. Cela se discute. Le problème qui était soulevé, et qui rebondit aujourd’hui, n’est pas là. Quand Jospin est arrivé au pouvoir, il a consulté une commission d’experts socialistes sur la taxe Tobin, qui lui a recommandé de l’enterrer. Aujourd’hui, il y a une inflexion du discours chez Jospin (et chez Schröder). C’est compréhensible à cause de la récession. Tobin, le père légitime de la taxe qui porte son nom, intervient maintenant pour dire qu’il y a des ébouriffés dangereux qui se sont emparés de son idée mais que, pour lui, ce n’était pas du tout ça. Je suis complètement solidaire d’un mouvement comme Attac, pour qui la taxe Tobin ne révolutionne pas le monde mais a une portée pédagogique. Si l’on établit une taxe de 0,1 ou 0,2 % sur les transactions financières pour créer un fonds de redistribution pour l’aide au tiers-monde, qui va le contrôler ? Qui va déterminer les critères de distribution ? Une question en amène une autre. S’il y avait vote sur la mise en place de la taxe proprement dite, nous la voterions en discutant les modalités d’application. Le contre-sommet de Porto Alegre, qui aura lieu en février, sera beaucoup plus large que l’an dernier, mais il sera également plus différencié sur les propositions et les solutions.
Des réunions se sont tenues l’été dernier au Mexique entre Attac, la Centrale unique des travailleurs du Brésil, Via Campesina (l’internationale paysanne dont est membre la Confédération paysanne en France). Elle rassemble de grosses composantes des mouvements sociaux de résistance à la mondialisation capitaliste pour définir une position commune sur les questions de la dette, de la clause sociale, etc. Ces questions seront moins consensuelles maintenant. Sur les paradis fiscaux, les libéraux disent qu’il faut réglementer pour contrôler le mouvement des capitaux « terroristes ». Dès le lendemain, Berlusconi prend la mesure inverse pour qu’on ne mette pas le nez dans ses affaires. C’est une bagarre qui commence. On entre dans une nouvelle étape du mouvement de résistance. Ce mouvement, je ne l’appelle pas antimondialiste. C’est le vocabulaire de la presse : « les antimondialistes ont manifesté ici ou là ». Non, ce n’est pas la mondialisation en soi qui est en cause. Des gens qui se réclament comme nous de l’internationalisme, de l’ouverture, de la solidarité sans frontières, je ne vois pas pourquoi ils seraient gênés par la mondialisation. Mais il y a leur mondialisation et la nôtre. Ce ne sont pas les mêmes. Il suffit de mettre les pieds dans une de ces manifestations pour le vérifier : quoi de plus « mondialisé » aujourd’hui que le mouvement paysan Via Campesina ? Nous ne sommes pas contre la mondialisation en général, mais contre la mondialisation financière marchande, libérale, inégalitaire, antisociale, contre les plans d’ajustements structurels du FMI qui mettent en banqueroute un pays comme l’Argentine.
L’Argentine connaît aujourd’hui une rechute dans la désalphabétisation, dans la désindustrialisation, dans la dépendance et le sous-développement. Son principal produit d’exportation, c’est désormais le soja pour le bétail américain et européen. Quand on doit négocier sa place sur le marché mondial en tant que mono-producteur de soja, on ne pèse pas très lourd dans l’OMC et dans le concert international.
Trois ou quatre jours avant les attentats du 11-Septembre, est paru dans Le Monde un article de Dominique Lecour et François Ewald sur la question des OGM. Dominique Lecour, philosophe, est spécialiste de la philosophie des sciences, plutôt républicain chevènementiste, et il défend l’idée d’un certain progrès de la raison et de la science. Cet article disait : « Arracher les OGM, c’est obscurantiste, comme les ouvriers anglais qui détruisaient les machines dans les années 1820. » Il signe ce papier avec François Ewald, ancien disciple de Michel Foucault, aujourd’hui gourou du Medef ! Ce même François Ewald organisait l’an dernier des déjeuners culturels au siège de Medef (en pleines négociations sur le PARE et sur la réforme des allocations chômage !) où étaient invités Blandine Kriegel et Alain Finkielkraut afin de nouer des échanges fructueux avec un certain milieu intellectuel. Le but évident était de blanchir l’image du Medef et de promouvoir la représentation du patronat éclairé. Ce qui me choque, c’est qu’Ewald, un ultralibéral, et Lecourt, un républicain chevènementiste, forment un curieux attelage pour dire d’une seule voix : les antimondialistes et les anti-OGM veulent faire tourner la roue de l’histoire et du progrès scientifique à l’envers.
Mais ce qui gêne José Bové comme nous, ce n’est pas la recherche sur les OGM ou la recherche médicale. Ce qui constitue vraiment une menace pour l’humanité, c’est ce que j’appelle les noces barbares du marché et de la technique, de la recherche génétique et des monopoles pharmaceutiques, des OGM et de Novartis. C’est là qu’est le problème. Le risque que les innovations servent à mettre au point le projet Terminator, c’est-à-dire l’interruption du cycle de reproduction des semences, et à transformer des paysans en prolétaires soumis, année après année, aux exigences des semenciers. Ce n’est pas un problème d’obscurantisme ou de technique. C’est un problème social.
Sur toutes ces questions, il est important de se battre pied à pied et de faire la clarté. Je ne suis pas contre le progrès en général, j’estime seulement que le progrès technique n’entraîne pas automatiquement le progrès social. Il peut même provoquer des régressions. C’est sur ce point que porte le débat.
Un auditeur : Vous faisiez référence, en parlant de Gênes, à la tentative de criminalisation des mouvements de résistance à la mondialisation libérale. Ne croyez-vous pas que la crise politique planétaire qui s’ouvre est l’opportunité d’une criminalisation beaucoup plus large de toute forme de résistance ? Je fais allusion au vote des pleins pouvoirs à Bush, qui est venu comme un chèque en blanc à une politique qui n’était même pas définie. Pour l’anecdote, je rappellerai qu’il n’a eu qu’un seul vote contre. On n’est même pas dans les vingt députés qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs à Pétain. Cela fait quand même un peu frémir.
Et quelques jours après, il a fait un discours devant le Congrès qui est une véritable déclaration de guerre, non pas simplement contre Ben Laden, mais à toutes les résistances au modèle américain. Est-ce que vous avez lu ce texte ? Est-ce que vous pouvez nous en faire une interprétation et nous dire votre position et comment vous vous situez par rapport à ce que je vois, moi, comme une nouvelle menace très préoccupante pour toutes les formes de représentations sociales, y compris celles qui restent dans le cadre démocratique.
Daniel Bensaïd : La tentative de criminalisation du mouvement de résistance à la mondialisation a effectivement échoué à cause de la croissance des manifestations qui n’ont pas cessé de se développer depuis Seattle.
Ce qu’a saisi au bond Bush, dans son discours du 20 septembre, c’est l’occasion d’accentuer une politique déjà amorcée avant le 11-Septembre, qui conçoit le maintien de l’ordre international, non pas sur un rapport entre États régi par le droit international et par les institutions du type de l’Onu, mais au contraire comme l’exercice d’un droit unilatéral de maintien de l’ordre international réduit à des opérations de police et de châtiment. Cela vient de loin. Noriega (ancien président du Panama et agent de la CIA) était un pourri, mais la descente américaine au Panama pour le capturer était déjà en dehors de toute norme de droit international. Elle a fait 5 000 morts. C’est passé à peu près inaperçu, en 1989, alors que l’attention était concentrée sur les événements de Roumanie. Dans la dernière période, quoique vous pensiez de l’intervention de l’Otan au Kosovo, le discours de légitimation a suivi la fameuse rhétorique des administrations américaines sur « les États voyous ». Bien que l’Union soviétique et le péril qu’elle était censée représenter aient disparu, les budgets d’armement sont restés et sont même repartis spectaculairement à la hausse.
La notion « d’États voyous » traduit une judiciarisation du vocabulaire politique. La délinquance, ce n’est pas la guerre. On va traiter les voyous internationaux comme on traite les petits dealers, par une opération de basse police. La France a mis le doigt dans cette logique en s’associant, sans véritable débat ni vote parlementaire, aux opérations de l’Otan : puisque ce n’est pas une guerre, il n’y a pas à la déclarer, ni d’ailleurs à se soumettre au droit de la guerre ou aux conventions de Genève sur les prisonniers.
Le discours de Bush du 20 septembre contient des formulations terribles. J’attire votre attention sur la dénomination initiale de « justice illimitée », qui a de quoi faire bondir. D’abord, qui énonce la justice ? Qui est mandaté pour administrer cette « justice illimitée » ? Qu’est-ce que l’idée d’une « justice illimitée » ? Le rapport entre les délits et les peines est traditionnellement défini comme un rapport de proportion et d’équilibre, symbolisé par la balance. Une justice sans limites, sans mesure, c’est le corollaire de la « croisade » annoncée : l’administration autoritaire de l’idée que l’on se fait du bien et du bon droit, sans limite juridique. C’est proprement hallucinant.
Vous direz qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, mais le fait que ce discours puisse être tenu et diffusé comme quelque chose de normal, voire de légitime, est très inquiétant. « Notre guerre contre la terreur, dit Bush, commence par le mouvement Ben Laden, mais elle ne se termine pas là. Elle ne se terminera que lorsque chaque groupe terroriste capable de frapper à l’échelle mondiale aura été repéré, arrêté et vaincu. » Mais qui définit le terrorisme ? Où commence et où finit la résistance dans l’Intifada, où commencerait le terrorisme permettant de criminaliser Arafat ? Les définitions sont extrêmement fluides et ce ne sont pas le Petit Robert ou Alain Rey qui vont fixer le sens du terme pour l’éternité.
Qu’il n’y ait pas de malentendu : je désapprouve totalement, pour des raisons tant morales que politiques, les attentats de New York. Bernard-Henri Lévy prétend que tenter de les expliquer, ce serait déjà les justifier. Je ne vois pas pourquoi. On peut essayer de comprendre et condamner. Analyser le monde tel qu’il va, cela ne me paraît pas plus justifier les attentats du Hamas dans les pizzerias. Cela permet en revanche de comprendre que la politique de Sharon fabrique tous les jours de nouvelles générations désespérées de candidats kamikazes, et qu’il y en aura d’autres. Quand un peuple est écrabouillé, humilié, parqué dans des camps depuis cinquante ans, il ne peut rien en résulter d’autre. Quand on parle de « territoires occupés », c’est qu’il y a un occupant. Pour des gamins de Gaza, un soldat israélien, c’est un occupant. Tirer sur ce soldat, est-ce du terrorisme ? C’est du « terrorisme » comme les fusillés de « l’Affiche rouge » étaient des terroristes aux yeux des occupants allemands.
Il faudrait citer tout l’article de Bush : « Cette guerre ne ressemblera pas à la guerre d’il y a dix ans contre l’Irak, avec une libération rapide des territoires et une conclusion rapide. Elle ne ressemblera pas à la guerre aérienne au-dessus du Kosovo il y a deux ans, où aucune force terrestre n’a été utilisée et où aucun Américain n’est mort, elle comprendra des frappes spectaculaires diffusées à la télévision et des opérations secrètes, secrètes jusque dans leur succès. » C’est l’annonce d’une guerre secrète, de coups bas où tout est permis. Quand on commence à raconter des choses comme ça, la logique est en marche. La frontière entre combattants et civils, malmenée depuis longtemps (depuis notamment les bombardements de terreur sur des populations civiles), s’efface. Ce fut le cas lors des bombardements de l’usine pharmaceutique du Soudan qui visaient soi-disant Ben Laden. Dans le vocabulaire désormais consacré, ce sont des dommages collatéraux. Suivant cette vision, les kamikazes du 11-Septembre pourraient fort bien dire que l’attaque du Pentagone, c’était un objectif militaire et que les passagers des Boeing ne sont eux aussi que des dégâts collatéraux. La vision américaine, c’est exactement ça.
Certains se sont indignés contre Berlusconi déclarant que la civilisation occidentale a le droit de donner des leçons étant donné sa supériorité. Mais les Américains ne disent pas autre chose quand ils parlent de croisade du Bien contre le Mal. Au nom de qui ? De quel Bien ? C’est une terrible spirale qui s’enclenche là. Il ne faudrait pas que ça encourage quiconque à imaginer que les Talibans et Ben Laden puissent être les nouveaux champions de l’anti-impérialisme.
Cet anti-impérialisme serait celui des imbéciles, comme l’antisémitisme fut le socialisme des imbéciles. Le mouvement ouvrier était un vecteur de rationalité dans la lutte politique. S’il n’y a en Amérique latine des phénomènes comparables au fondamentalisme islamique, ce n’est pas parce que l’Islam serait mauvais et les Latino-Américains chrétiens, mais parce que l’histoire de la lutte des classes en Amérique latine a produit une autre forme de culture politique. Quand on parque des gens exclus de toute activité productive régulière, sous assistance alimentaire internationale, avec comme seule perspective de végéter dans des camps pendant des dizaines d’années, il ne faut pas s’étonner que leur désespoir s’exprime sous une forme religieuse. Avant l’expérience de la modernité, l’Europe a connu elle aussi les millénarismes religieux, l’histoire des hérésies et des fanatismes religieux. Sans rien justifier, on peut essayer de comprendre. On ne peut pas dire aux gamins de Gaza : « Organisez des syndicats et prenez modèle sur des parlementaires britanniques courtois et policés. » Quelle est l’insertion sociale et l’avenir de ces adolescents ? De quoi vivent-ils ?
Je reste pourtant raisonnablement et très modérément optimiste. Le mouvement qui germe dans les résistances à la mondialisation peut donner à ces problèmes d’autres formes d’expression et ouvrir d’autres perspectives. Au Maroc, aujourd’hui, ou en Tunisie, ce sont de tous petits groupes, mais le fait qu’ils puissent s’insérer dans un mouvement international de résistance à la mondialisation composé de syndicats, de mouvements de paysans, esquisse la possibilité de briser le face à face entre fondamentalisme religieux et pouvoir autoritaire des militaires en Algérie ou en Tunisie.
Il faut comprendre que le mouvement islamiste peut incarner un projet politique dans des États qui résultent de découpages et de partages coloniaux historiquement récents. Quand l’Irak a envahi le Koweït, c’était une atteinte à la souveraineté d’un État reconnu par l’Onu. Pour les Irakiens en revanche, ces frontières étaient une création vieille d’un demi-siècle à peine, dont le but était de créer un périmètre pétrolier partenaire des pays occidentaux. Et c’est vrai aussi de nombre de tracés frontaliers en Afrique.
Devant la brutalité de la crise, ces États, au lieu de consolider des proto-nations modernes, ont tendance à se décomposer dans des pratiques clientélaires ou des appartenances ethniques. Quelle est la légitimité de l’État quand le seul service de la dette représente pour certains pays africains bien plus que les budgets cumulés d’éducation et de santé ? Qu’est-ce qui peut, dans ces conditions, assurer la cohésion sociale ? C’est le règne des appartenances vindicatives, des États en miettes. L’échec de l’État-nation comme horizon d’intégration se traduit par une quête de légitimité dans la généalogie et la recherche des origines. L’appartenance n’est plus définie par la politique mais par les origines, le sang, la terre et les morts.
À propos des conflits dits « ethniques » (le terme a significativement remplacé la traditionnelle « question nationale » des Balkans) en Yougoslavie, certains ont voulu croire qu’il s’agissait d’un produit de la décomposition des régimes staliniens. Je n’ai bien sûr aucune indulgence pour ces régimes, puisque ce fut un des motifs de notre exclusion du Parti communiste en 1966. Mais l’ethnicisation et la confessionnalisation de la politique sont une tendance qui ne se limite pas aux Balkans, au Moyen-Orient ou à certaines zones de l’Afrique.
Devant la crise des structures nationales de création récente extrêmement fragiles socialement, la référence à la « communauté des croyants » peut apparaître à des peuples brutalisés comme une issue fonctionnelle. On peut alors se sentir finalement membre de cette communauté bien plus que citoyen libyen ou syrien. En tout cas, ce sont des références concurrentes ou combinées, non stabilisées. C’est pourquoi, construire un imaginaire et des représentations où l’appartenance de classe joue un rôle prépondérant, ce n’est pas spontané, mais, si les conditions existent, et je pense qu’elles existent, c’est ce qui peut soutenir une alternative aux logiques confessionnelles ou communautaires.
J’ai signé, pour la première fois de ma vie, au début de l’Intifada, un texte « en tant que juif ». Qu’est-ce qu’être juif ? J’ai eu comme tout le monde des oncles et des tantes, des cousins qui sont partis en fumée à Auschwitz. À ce titre-là, j’hérite d’une Histoire. En général, je me définis d’abord par mes engagements politiques internationalistes et pas par une destinée venue des profondeurs originelles. Sauf face à un antisémite. Peut-être faut-il ajouter maintenant : et face à un sioniste. Lorsque l’État d’Israël et les institutions communautaires en France prétendent parler au nom de tous les juifs, je me sens violé. Je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi ils parleraient en mon nom, au nom de mes parents, de tous les juifs communistes qui sont morts dans les brigades internationales pour leurs convictions politiques et non pour la terre sainte.
C’est important pour rappeler que le conflit du Moyen-Orient n’est pas un conflit religieux, contrairement à ce que tend à imposer la provocation de Sharon sur l’esplanade des Mosquées. Si on discute politique, d’origine juive ou pas, je me sens plus proche d’Elias Sanbar ou de Leïla Shahid que de Sharon ou de Shimon Perès. Nous ne sommes pas séparés par des frontières ethniques et par le droit du sang. La politique introduit de la rationalité et du sens historique dans la déraison. On choisit ses causes et son camp. On ne subit pas une nature. On n’est pas rivé à une hérédité et à un destin généalogique. Construire le conflit politique c’est chercher les forces sociales capables de le dénouer ? On doit mettre en relief des appartenances et des solidarités de classe, qui traversent les frontières des religions, des nations, etc. Faire en sorte que, de l’autre coté de la frontière, l’autre, croyant ou pas, puisse aussi se penser comme un travailleur, se définir comme citoyen, parler un langage commun.
Dans le vocabulaire comme dans les pratiques, il y a des références concurrentes. Déterminer laquelle peut l’emporter et laquelle peut prévaloir est affaire de politique. C’est une course de vitesse. Mais il ne suffit pas de mettre l’accent sur les rapports de classe. Encore faut-il que cette conscience embraye sur une réalité effective. On peut dire qu’en Algérie, une part de l’alternative aux militaires et au GIA, c’est le mouvement culturel et social kabyle. Il est très important pour le moment que la revendication culturelle n’ait pas pris une tournure exclusivement communautaire, mais soit inscrite dans l’articulation du culturel et du social. Il y a la langue, le tamazirt, mais il y a aussi la situation sociale d’ensemble en Algérie. Dans les manifs, on a aussi entendu scander : « Nous sommes tous des Algériens ! » La revendication kabyle n’exclut pas la référence commune, parce qu’il y a l’histoire commune forgée dans la lutte de libération algérienne.
De même, le mouvement zapatiste au Mexique, à la différence du Sentier lumineux au Pérou, n’a pas développé ses revendications sur le terrain ethnique. Il demande la redéfinition du droit des communautés indigènes dans la Constitution mexicaine, c’est-à-dire la reconnaissance de ces droits dans une reformulation de la nation mexicaine.
Mais si, alors que ces mouvements ne sont pas dans une logique de séparation ethnique ou confessionnelle, le mouvement ouvrier se décompose socialement, quel sera le vecteur du rassemblement social ? En Algérie, 400 000 emplois salariés ont été supprimés ces dix dernières années. En Argentine, les piqueteros qui bloquent des routes sont essentiellement des chômeurs. Dans ce pays, le chômage a atteint de telles proportions que les gens ne peuvent pas faire grève puisqu’ils sont exclus massivement de l’activité productive. Il y a eu en juillet un congrès de
2 000 délégués des piquets de blocage des routes et leur premier geste a été une minute de silence en hommage au jeune tué à Gênes. La mondialisation, la nôtre, c’est aussi ça !
En même temps, il y a de quoi s’inquiéter. Aux élections mexicaines de juillet dernier, la chute du PRI a sanctionné un parti pourri jusqu’à la moelle, mais ce qui constitue à première vue une victoire démocratique va très vite se révéler comme une défaite sociale face à la politique libérale de Vicente Fox, ex-président de Coca-cola, qui va accélérer le démantèlement des services sociaux, héritages de la révolution mexicaine. Il est d’ores et déjà le principal soutien des États-Unis pour le projet de grande zone de libre-échange latino-américaine sous hégémonie états-unienne.
Mon optimisme est donc mesuré. Je dis seulement que nous sommes sortis de la séquence sombre des années 1977-1979 ou 1992-1993. Il y a un sursaut des résistances. On n’est plus dans l’impuissance. Mais on est encore loin de ce qu’il faudrait.
L’histoire est ouverte et incertaine. Pour la déterminer nous-mêmes, il faut agir, sans certitude de réussir.
Revue Parcours, les Cahiers du Grep
Midi-Pyrénées, saison 2001-2002, n° 25-26
www.danielbensaid.org