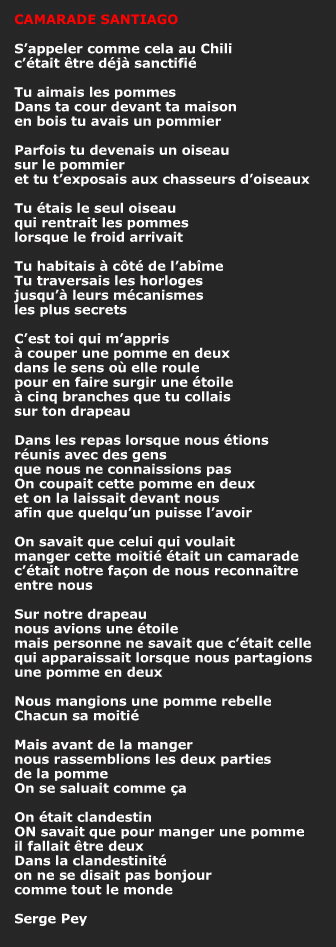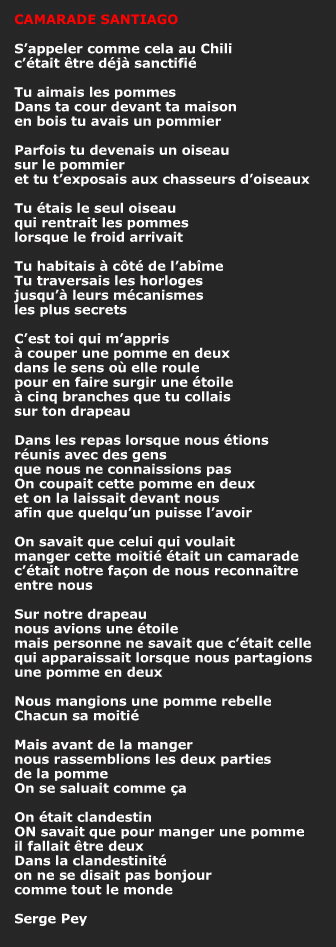
Le très beau film de Carmen Castillo1, Calle Santa Fe, sort cette semaine à Paris dans les salles, et il sortira ensuite dans plusieurs villes. À la fin de la dictature chilienne Carmen est retournée à Santiago avec le projet de racheter la maison où son compagnon, Miguel Enriquez, secrétaire général du Mir, a été abattu le 6 octobre 1974 et elle-même grièvement blessée. Elle a l’intention d’en faire un lieu de mémoire et d’activité pour le mouvement social renaissant. Son film, où se croisent sans complaisance un itinéraire personnel, une histoire collective (celle des militants du Mir), et celle du pays lui-même est une sorte de film d’apprentissage à rebours. Un retour à la vie, à travers des visages, des témoignages, des souvenirs, la plupart terriblement émouvants : ces militants et militantes (beaucoup de femmes admirables dans ce film) ont été vaincus, sans doute, mais, dans leur victorieuse défaite, la force de vie et la dignité de résistance l’a emporté sur la peur et l’humiliation.
Loin d’une commémoration nostalgique d’un passé perdu, le film de Carmen Castillo est une œuvre de transmission, où les générations d’hier et d’aujourd’hui, le passé et le présent, ne cessent de se croiser dans un subtil jeu de miroir. Une haute idée de ce qu’est et ce que peut un être humain. À voir et à faire voir, sans tarder.
Daniel Bensaïd : Carmen, au bout des 2 h 40 de ce film, on a l’impression d’un long parcours, d’un travail au fil duquel tu t’es toi-même transformée, tu es parvenue à conjurer tes fantômes sans les trahir le moins du monde, jusqu’à abandonner le projet initial de rachat de la maison pour te plonger dans le tourbillon moléculaire d’une renaissance sociale et politique.
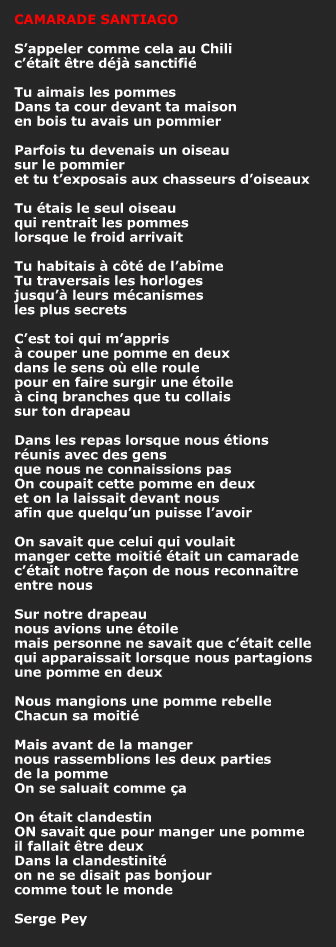 Carmen Castillo : Au départ du film, je pensais que mon engagement, la politique, c’était du passé. Et je suis partie de cette maison comme lieu de résistance. Un lieu qui donne du sens à ma vie. Mais quand j’y suis retournée, je ne savais plus ce qui se passait au Chili. Entre 2002 (où j’ai tourné les premières images de la maison) et 2005 (fin du tournage), j’ai fait plusieurs voyages au cours desquels j’ai redécouvert peu à peu la politique et l’engagement. En y allant, les premières fois, je redoutais l’arrogance des vainqueurs, la fatigue des vaincus, la tristesse d’une société de consommation où le luxe côtoie la pauvreté, l’endettement, le délabrement des systèmes d’éducation et de santé. Comment faire de la politique dans ce pays si tu n’as pas le moindre intérêt pour la classe qui gouverne ce pays ? Je suis tombée dans une mélancolie profonde. Et puis j’ai rencontré un mouvement, une créativité, une inventivité, liées à une grande lucidité. Car on voit bien la difficulté à renouer les fils de ce passé qui ne passe pas : pas parce qu’il est mort et qu’on le veille avec nostalgie, mais au contraire parce qu’il est toujours vivant. Vivant dans la mémoire des vaincus et dans les mémoires populaires.
Carmen Castillo : Au départ du film, je pensais que mon engagement, la politique, c’était du passé. Et je suis partie de cette maison comme lieu de résistance. Un lieu qui donne du sens à ma vie. Mais quand j’y suis retournée, je ne savais plus ce qui se passait au Chili. Entre 2002 (où j’ai tourné les premières images de la maison) et 2005 (fin du tournage), j’ai fait plusieurs voyages au cours desquels j’ai redécouvert peu à peu la politique et l’engagement. En y allant, les premières fois, je redoutais l’arrogance des vainqueurs, la fatigue des vaincus, la tristesse d’une société de consommation où le luxe côtoie la pauvreté, l’endettement, le délabrement des systèmes d’éducation et de santé. Comment faire de la politique dans ce pays si tu n’as pas le moindre intérêt pour la classe qui gouverne ce pays ? Je suis tombée dans une mélancolie profonde. Et puis j’ai rencontré un mouvement, une créativité, une inventivité, liées à une grande lucidité. Car on voit bien la difficulté à renouer les fils de ce passé qui ne passe pas : pas parce qu’il est mort et qu’on le veille avec nostalgie, mais au contraire parce qu’il est toujours vivant. Vivant dans la mémoire des vaincus et dans les mémoires populaires.
Je croyais que la société était tombée dans une amnésie indifférente. Et, en traversant les murs invisibles de la société, en allant de l’autre côté du mur qui cache à la vue un Chili de résistance populaire, j’ai retrouvé Miguel, Allende, nous autres, tels que nous étions au début de notre histoire. Une tradition présente et réinventée à la fois. Concrètement, le hip-hop par exemple, les centres muralistes, les noyaux politiques des poblaciones qui essaient – de façon très minoritaire, bien sûr, mais puissante – de faire vivre l’énergie mémorielle des vaincus.
Je suis en quelque sorte retournée sur les lieux du crime. On retourne toujours sur les lieux de la tragédie. Mais, à la différence de ce qui se passe dans ces retours tragiques, je suis convaincue que ces dix mois de clandestinité vécus avec Miguel dans la maison de la calle Santa Fe, c’est tout et le meilleur de ce qu’on peut attendre de toute une vie. Qu’est-ce que cette intensité de la vie quotidienne, cette luminosité des gestes quotidiens les plus simples : faire la cuisine, raconter des histoires aux enfants, faire l’amour ? C’est tout simplement la résistance qui donne leur intensité particulière aux choses les plus banales et les plus simples. Une vie sans cela est très terne. Très ennuyeuse.
Je pensais que tout cela était fini, que Pinochet et dix-sept ans de réaction libérale avaient éradiqué cette histoire. Et bien, non. Il faut le dire à mes amis, pour qu’ils se battent, ici, là-bas. Il faut tout réinventer.
Daniel : Plusieurs interventions de militants et militantes évoquent les erreurs politiques commises, la rigidité, le dogmatisme. Le prix est très lourd : 800 militant(e)s du Mir tués ou disparus. D’où le déchirement qui s’exprime dans certains témoignages : comment reconnaître ces erreurs sans en conclure que tous ces sacrifices, toutes ces souffrances étaient inutiles et n’ont servi à rien. La question est lancinante. Elle revient sous une autre forme dans le témoignage des enfants de militants qui ont été « abandonnés » par leurs parents dans une sorte de crèche collective en 1978 au moment où la direction a décidé « le retour » au pays des exilés. Toi-même, tu es restée séparée près de douze ans de ta fille…
Carmen : Ce que j’ai compris en rencontrant les militants qui restent actifs, liés entre eux, c’est combien ce fut déchirant, à cause de la survie (et parfois de la culpabilité qu’éprouvent les survivants) de remettre en cause certaines décisions politiques qui sont devenues des erreurs par la rigidité de leur application.
Il y eut notamment deux grands moments. En 1973, au lendemain du coup, « le Mir ne s’exile pas ». Puis, en 1978, la décision du retour clandestin. Les deux ont été débattus. Après, il y a eu de réelles dérives militaristes. Alors on peut se poser des questions, tout en restant fidèles à cette simple chose : continuer, continuer malgré tout. Continuer en inventant, parce que les inégalités, les injustices sont toujours là, parce que les tortionnaires n’ont pas été jugés, parce que les corps des disparus n’ont pas été retrouvés, parce que les résistants n’ont pas été amnistiés ou réhabilités. Pinochet est mort dans son lit. Des prisonniers politiques arrêtés sous « la démocratie » sont encore détenus. Des militants rentrés d’exil sont encore illégaux. Il y a ces jours-ci six jeunes indiens mapuches en grève de la faim contre la répression.
Par rapport à cette génération qui a continué dans un contexte pareil, notre responsabilité de transmission est compliquée, mais énorme. Malgré notre longue marche de défaite en défaite (jusqu’à la victoire finale !?), c’est important d’affronter cette complexité. Si nous ne rappelons pas à la fois qu’il n’y a pas de vraie vie sans l’engagement que nous avons connu, si nous ne disons pas aux enfants, aux parents, que cette lutte, c’est le meilleur que nous ayons fait, alors oui nous aurons été doublement vaincus. Si on ne dit pas à nos enfants ce que nous avions dans la tête, nos rêves et nos désirs, le jour où nous les avons laissés, à ces enfants qui ont une blessure à vie, si nous ne leur expliquons pas le désir qu’avaient ces femmes et ces mères de lutter pour leur dignité, alors rien n’aurait plus de sens. On a la responsabilité d’expliquer pourquoi nous l’avons fait. C’est la seule possibilité pour que nos enfants grandissent dans un rapport à la réalité. Je me suis toujours dit que si je disais à ma fille (Camila) qui a grandi loin de moi que je m’étais trompée sur toute la ligne, ce serait faux.
Daniel : Il y a dans le film, parmi bien d’autres, un témoignage magnifique des parents des trois frères Vergara assassinés par la dictature. La mère raconte avec beaucoup de force et de sobriété à quel point elle a eu peur, combien elle était consciente du risque, quand ils lui ont annoncé leur volonté de militer au Mir. Elle dit qu’après leur mort, elle était une loque, qu’elle a voulu mourir, mais qu’elle s’est reconstruite en comprenant ce qu’ils lui ont appris : leur logique était une logique de lutte et de vie, alors que la sienne était une logique de peur et de mort. Elle n’avait que la peur à leur opposer alors que ses fils lui expliquaient la vie. À l’occasion du quarantième anniversaire de l’assassinat du Che, on a assisté à une véritable campagne de presse le présentant comme un fou suicidaire ou sanguinaire qui aurait entraîné ses compagnons dans une aventure morbide. J’imagine qu’on pourrait en dire autant ou presque de Miguel. Pourtant, le film soutient le contraire, qu’il y avait de la raison dans ces révoltes et une énorme volonté de vie, pas morbide du tout. Il y a quelque chose de suspect dans cet acharnement, quarante ans après (comme chez Sarkozy, toutes proportions gardées, à propos de 68), de vouloir assassiner la mémoire après avoir assassiné les hommes. Comme si les vainqueurs ne dormaient pas tranquilles, comme s’ils n’étaient pas si sûrs de leur victoire.
Carmen : On avait raison de croire que c’était possible de changer le monde. La lucidité du Mir (qui avait vu venir le coup d’État) est aujourd’hui reconnue par les historiens.
On savait que l’ennemi se préparait. On avait fait le choix, non pas de l’affronter seuls, mais d’organiser la résistance populaire, dans les quartiers, dans les entreprises, à la campagne, car le Chili ne se prêtait pas à une guerre de guérilla comme celle de Cuba, ou celle tentée par le Che en Bolivie. Mais un ancien responsable du Mir rappelle dans le film que le Mir n’a eu que huit ans pour se préparer, entre sa fondation en 1965 et le coup de 1973. Ses dirigeants avaient pour la plupart moins de trente ans. Miguel avait trente ans quand ils l’ont tué. Le camarade dit modestement dans le film que nous avons fait ce que nous pouvions avec ce que nous savions.
Ce qui reste vivant, c’est le désir. Ils ne peuvent pas tuer ce désir. Nous avons touché au mystère de la jouissance. Ils ne nous le pardonnent pas. Ils n’en finissent pas d’assassiner la mémoire et la gaieté (car c’est ce que j’ai voulu montrer à travers les extraits de documents, cet extraordinaire élan d’enthousiasme et de gaîté qui était le nôtre). La mort, c’est l’affaire de la bourgeoisie. Ce que mon film transmet, c’est une mémoire douloureuse, mais aussi ça, une mémoire du bonheur.
Daniel : Un moment particulièrement fort du film, c’est l’évocation de la dissolution du Mir en 1989 sur décision de la direction en exil, sans débat ni consultation des militants, alors que la plus dure période de la dictature s’achevait. Une militante interviewée raconte qu’elle a voulu se suicider en apprenant cette décision qui reste d’ailleurs inexplicable et inexpliquée dans ton film.
Carmen : La dissolution du Mir est un grand mystère de l’histoire. Il y a eu par la suite des tentatives de recréer le Mir. Aujourd’hui, l’esprit du Mir existe (on le voit avec le grand meeting d’hommage à Miguel en 2004), mais pas l’organisation. Le témoignage de Maria-Cristina, c’est un choix que j’ai fait, pour dire, en trois minutes, l’inexplicable. C’est très difficile la politique en exil, la perte de contact avec la réalité, cela peut conduire au suicide.
Beaucoup ont pleuré. Aujourd’hui existent des groupes d’action populaire qui font un travail quotidien et qui, sous des noms divers, se réclament de cette tradition.
Daniel : À la fin du film, tu as une conversation avec un jeune qui te persuade de renoncer au projet concernant le rachat de la maison. Tu sembles convaincue de renoncer, mais sans tristesse, comme si c’était un nouveau départ.
Carmen : Je me suis rendu compte que ces jeunes, c’était nous. J’ai retrouvé Miguel. La même vivacité, la même insolence, le même désir d’apprendre, sans se raconter d’histoire. Ces noyaux militants d’aujourd’hui s’approprient la tradition et la mémoire des vaincus, parce qu’ils y trouvent une source de dignité, mais sans reprendre à leur compte la rhétorique épique et héroïque.
Daniel : Tu as déjà eu l’occasion de rencontrer plusieurs publics lors de projections, de notre génération mais aussi de la nouvelle génération. Quelle impression tires-tu de ces rencontres ?
Carmen : J’en suis très émue. Je voulais combattre la volonté d’écraser nos mémoires qui contiennent autant de bonheur que de douleur. Et dans les discussions surgissent non pas des nostalgies et des regrets, mais des questions d’aujourd’hui, pour aujourd’hui. Je craignais que l’on parle beaucoup du passé. Et on parle beaucoup du présent. C’est cela qui m’intéresse.
Rouge n° 2230, 6 décembre 2007
www.danielbensaid.org