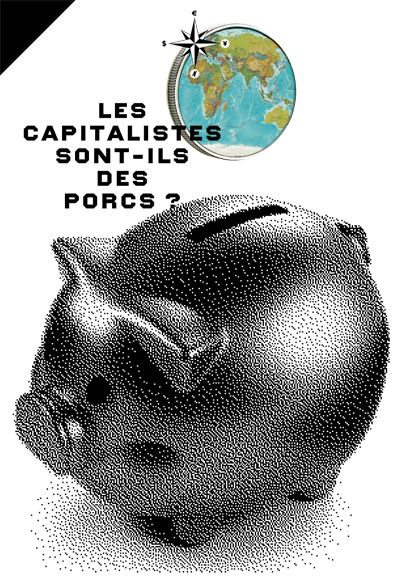
Ce texte, « Un plan d’urgence pour sortir de la crise », constitue le chapitre V (partie I) du livre d’Olivier Besancenot et de Daniel Bensaïd, Prenons parti. Pour un socialisme du XXIe siècle, Mille et une nuits, Fayard : janvier 2009.
La crise actuelle va donner lieu à de nouvelles réglementations. Les libéraux fanatiques s’effacent devant leurs rivaux hétérodoxes, Joseph Stiglitz, George Soros ou Paul Krugman, et tous les prêcheurs d’un New Deal, qui n’ont cessé de répéter que la maladie provenait du dérèglement et qu’une bonne régulation en serait le remède.
C’est oublier un peu vite que la dérégulation libérale n’était pas le fruit d’un caprice doctrinaire. Elle visait à rétablir des profits érodés dans les années 1960 et 1970 par les résistances et les conquêtes sociales. Revenir à l’État social et aux recettes keynésiennes consisterait à reconstruire ce qui a été détruit. Et si tant est que cela soit possible dans une économie mondialisée, cela ne ramènerait nos sociétés qu’à la case départ. Le capitalisme n’aurait en rien réglé son problème insurmontable, celui de produire en surcapacité et de façon anarchique. Comme le dit fort bien Jean-Marie Harribey, coprésident d’Attac, « réguler n’est pas régler ».
Il est prévisible que les possédants agiront comme ils l’ont toujours fait. Ils établiront et utiliseront les règles quand ils en auront besoin. Ils les contourneront (en toute légalité) quand elles leur pèseront. Et ils les changeront à nouveau lorsque la situation s’y prêtera. Est-il besoin de rappeler que Roosevelt, président des États-Unis lors de la Grande Crise, fit adopter en 1933 le Glass-Steagall Act qui contraignait les banques à séparer les activités de financement et d’investissement (les banques d’affaires) de celles de dépôt (les banques dites « de détail »). En 1999, à la veille d’entrer dans le véritable âge d’or des 2000 rugissantes, les banquiers l’ont fait abroger. Et les capitalistes ont applaudi des deux mains à ce débouché financier offert aux profits tirés de la production.
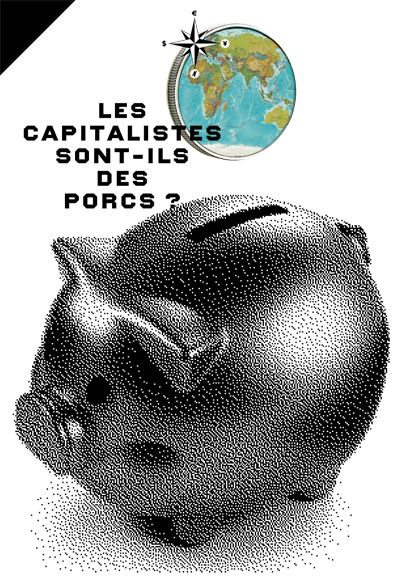 En finir avec la libre circulation du capital financier
En finir avec la libre circulation du capital financier
Limiter les parachutes dorés, revoir les normes comptables, revoir les critères et le statut des agences de notation ? Ce serait la moindre des choses. Ce sont des correctifs aux défauts les plus criants ou les plus scandaleux du système. Ces mesures ne vont même pas, comme la pétition lancée au printemps 2008 par des économistes critiques, jusqu’à l’abrogation de l’article 56 du traité de Lisbonne interdisant toute restriction aux mouvements du capital financier. Ni à réclamer l’abrogation de l’article 48 du même traité qui, au nom de la « liberté d’établissement », laisse au capital la possibilité d’aller où les conditions sont les plus favorables, et aux institutions financières la liberté de trouver asile où bon leur semble.
D’aucuns parlent du retour de l’État providence ou de l’État social sous prétexte que des banques seraient nationalisées. Ce n’est pourtant pas le cas, loin s’en faut. L’État n’aura même pas un droit de vote lors des conseils d’administration des établissements bancaires dans lesquels il détient une participation de 34 %. Pourtant, le très libéral Nicolas Baverez définit la banque comme un « bien public de la mondialisation » : « Sous le choc actuel de l’effondrement du crédit se profile un oligopole bancaire hautement rentable et assuré de sa pérennité du fait de la présence forte des intérêts publics et d’une immunité illimitée contre le risque de défaut. Voilà pourquoi les banques demeurent le banc d’essai de la mondialisation. Du fait de leurs caractéristiques, elles ont la nature d’un bien public qui génère des gains de productivité considérables pour l’économie en cas de bon fonctionnement, et des destructions majeures en cas de dysfonctionnement. » On s’attend alors à ce que ce bien public revienne à une gestion publique sous contrôle public, conforme à sa « nature ». Au prix d’un retournement de haute voltige, la conclusion est inverse : « D’où la nécessité d’une régulation qui doit intégrer la dimension mondiale du risque et se frayer un chemin étroit entre les deux moyens les plus sûrs d’aboutir à un krach bancaire, la déréglementation et la nationalisation. » Pour cet économiste du juste milieu (libéral), l’État assure donc aux banques une « immunité illimitée » pour les pertes et une assurance tous risques pour les profits.
Laurence Parisot s’est empressée de convoquer un G5 patronal pour préciser qu’il est bon que l’État joue son rôle en volant au secours de la finance, à la condition que ce soit à titre provisoire et qu’il promette de se retirer gentiment dès que les affaires auront repris leur cours lucratif. Autrement dit, de socialiser les pertes avant de reprivatiser les profits. Alors que certains économistes héroïsent le capitalisme en lui attribuant « une éthique du risque », l’État intervient en réalité temporairement comme l’assureur des banquiers menacés de faillite. Le risque, c’est pour les autres, pour les travailleurs licenciés, précarisés, surendettés, qui ne bénéficient pas de la même indulgence ni des mêmes arrangements.
Un grand service bancaire public
S’attaquer réellement au système impliquerait de réunifier toutes les banques dans un seul service public bancaire, en expropriant les intérêts privés, sans rachat ni indemnités. Celui-ci aurait le monopole du crédit afin de financer les priorités sociales, d’orienter l’investissement vers la satisfaction des besoins, de financer de grands travaux de reconstruction et de rénovation des services publics, d’impulser la transition énergétique.
S’attaquer au système, ce serait placer ce service public de crédit sous le contrôle des salariés et des usagers, lever le secret bancaire et l’anonymat de certains placements, établir un contrôle public et une taxation sur les mouvements de capitaux.
Solidarité internationale des peuples…
La brutalité de la crise va exacerber la lutte pour le partage des territoires, le contrôle des ressources énergétiques, la sécurisation des voies d’acheminement, autrement dit renforcer la logique de guerre et de militarisation, et ce d’autant plus qu’en période de récession et d’inflation l’économie d’armement est un moyen classique de soutien des États à l’industrie. Au lendemain du 11 septembre 2001, les États-Unis ont officialisé la doctrine de la « guerre préventive », s’émancipant ainsi des règles en vigueur du droit international et s’autorisant à intervenir militairement, avec ou sans la bénédiction de l’Onu, où et quand ils le veulent. Le corollaire, c’est l’adoption, sous prétexte d’antiterrorisme, de législations d’exception et de criminalisation préventive, dont le Patriot Act est le modèle. Elles généralisent la présomption de culpabilité au détriment de la présomption d’innocence. La loi de rétention de sûreté, la criminalisation des résistances sociales, la détection de la dangerosité dès l’âge de trois ans s’inscrivent dans cette logique.
Contre la mondialisation armée et les nouvelles guerres impériales, nous exigeons le retrait des troupes françaises d’Afghanistan et d’Afrique, le retrait définitif de la France de l’Otan et le démantèlement de ses bases (contre lesquelles une manifestation européenne aura lieu à Strasbourg au printemps 2009), la destruction de toutes les armes de destruction massive, la réduction des budgets militaires, la nationalisation des industries d’armement et un plan pour leur reconversion.
La crise, les guerres, le changement climatique risquent d’amplifier les déplacements de population et les mouvements migratoires. Le capitalisme va exploiter cette misère pour diviser les travailleurs, opposer les nations aux nations, les ethnies aux ethnies, attiser de nouvelles guerres de religion. Il va exploiter la vulnérabilité des travailleurs sans papiers pour faire pression sur les conditions de vie et de travail de tous. Plus que jamais, nous lui opposons la solidarité avec les travailleurs immigrés, l’exigence de régularisation des sans-papiers et du droit de vote pour les immigrés, un principe de citoyenneté de résidence fondé sur un approfondissement du droit du sol.
Le bouclier social
S’attaquer au cœur du système, ce serait adopter un bouclier social pour protéger les travailleurs des dégâts de la crise : relever les salaires, les pensions et les retraites ; annuler l’endettement des catégories sociales appauvries, interdire les licenciements boursiers, faire cesser les suppressions de postes dans la fonction publique, créer un fonds mutualisé pour la formation et la reconversion des salariés et garantir la pérennité de leur revenu, adopter un plan de relance coordonné au niveau européen. Il faudrait pour cela abroger le traité de Lisbonne, briser le carcan des critères de Maastricht et du pacte de stabilité, en finir avec l’indépendance de la Banque centrale européenne, réorienter radicalement la construction européenne en commençant par l’harmonisation des droits sociaux et du système fiscal et en ouvrant un réel processus constituant.
S’attaquer à la crise énergétique, climatique, alimentaire, ce serait revoir radicalement le mode de vie et de développement. Les biens publics inaliénables (eau, air…) devraient être sanctuarisés et un plan de reconversion énergétique élaboré par les collectivités au lieu d’être confié à la loi de la concurrence marchande. Le « trou de la Sécu », le
1,5 milliard pour le RSA, le 1,2 milliard de la Banque mondiale pour l’aide alimentaire d’urgence, et même les 30 milliards annuels nécessaires selon la FAO pour nourrir les milliards d’êtres humains victimes de la faim, apparaissent bien dérisoires à côté des centaines de milliards que les gouvernements sortent soudain de leur chapeau. La vraie question, c’est de savoir qui va payer, du capital ou du travail ?
Devinez ! Pour la France, l’augmentation du besoin de financement devrait atteindre
154 milliards d’euros en 2009 pour couvrir le déficit budgétaire, le remboursement d’emprunts arrivant à échéance, les nouveaux besoins liés à la création du « fonds souverain à la française » cher à M. Sarkozy. Où les trouver ? En lançant de nouveaux emprunts pour lesquels les investisseurs sollicités seront plus exigeants que jamais, en soldant à la baisse ce qui reste à privatiser, en ponctionnant des acomptes (il est question de 2 milliards d’euros) sur les recettes des entreprises (encore) publiques, en puisant dans les réserves de la Caisse des dépôts1 ?
Ce sont autant d’expédients aux effets provisoires et incertains. Ce sont donc forcément les travailleurs qui paieront le gros de la note. Si ce n’est par l’augmentation des impôts, ce sera par la compression salariale, par les coupes dans les budgets et les services publics, par le déremboursement des dépenses de santé, etc. C’est déjà le cas, et depuis trop longtemps.
Il s’agit maintenant d’inverser la tendance : par l’augmentation de tous les salaires, des pensions et des minima sociaux ; par le recul du chômage, la transformation des heures supplémentaires et temps partiels en emplois véritables, qui économiserait des dépenses sociales et renflouerait la Sécurité sociale ; par la suppression du bouclier et des niches fiscales (dont le manque à gagner est évalué à 70 milliards par la commission des Finances de l’Assemblée nationale) ; par le rétablissement des cotisations sociales des entreprises, l’arrêt des subventions à ceux qui délocalisent, l’adoption d’un impôt fortement progressif sur le revenu et sur les profits ; par l’interdiction de l’évasion vers les paradis fiscaux dont le préjudice est estimé à un minimum de 40 milliards ; par le plafonnement des dividendes (en 2007, les entreprises ont distribué en dividendes 8,1 % de leur valeur ajoutée contre 3,2 % en 1982) et leur transfert à un fonds de mutualisation pour financer l’interdiction des licenciements2.
On a beaucoup parlé de crise de confiance. La confiance va et vient, comme les cours capricieux de la Bourse. La crise de croyance, elle, est durable. Les dieux du marché, la foi en leur toute-puissance sont morts. L’heure est venue d’un anticapitalisme aussi décomplexé que l’est le « pur capitalisme » prédateur.
Janvier 2009
www.danielbensaid.org
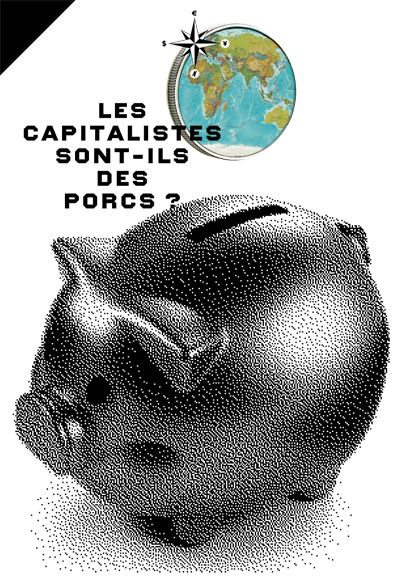
Documents joints
- La Tribune, 20 novembre 2008.
- Voir Michel Husson, « Un capitalisme toxique », Inprecor n° 541-542, septembre-octobre 2008.