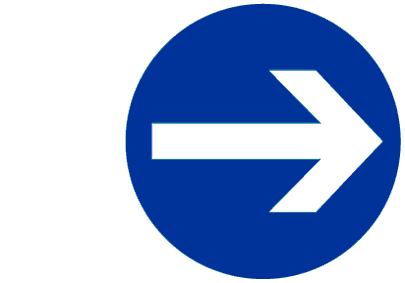
Les derniers seront les premiers. Aucun doute, nous sommes une arrière-garde, « et non seulement une arrière-garde, mais une arrière-garde un peu isolée, quelquefois un peu abandonnée1 ». Et nous sommes si infimes, si petits à leurs yeux, en « masse politique et sociale », qu’ils ne nous aperçoivent pas, que « nous n’existons pas pour eux2 ». Comme l’a dit Gérard Miller, quiconque n’est pas invité au mariage d’ouverture d’un dirigeant socialiste peopeulisé, n’existe pas socialement.
Du moins n’y a-t-il dans notre carrière « aucun rebroussement, aucun renoncement ». Des erreurs, sans doute. Des défaites, bien sûr. Mais pas de débâcles morales, pas de défaites honteuses. Des défaites honorables, qui autorisent à garder les armes et à recommencer. Honte, en revanche, à cette gauche qui a « désappris le socialisme pour apprendre à gouverner », à cette gauche d’opinion et non plus de militance et de conviction. « Vae tepidis. Malheur aux tièdes. Honte aux honteux. Malheur et honte à celui qui a honte3. »
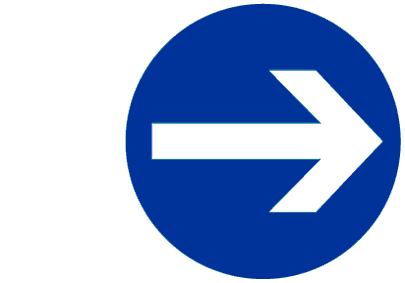 Car les derniers seront les premiers. Car nous reconstruirons et nous recommencerons. Nous reviendrons. Nous revenons déjà. Parce que nous sommes « placés à la brèche », et que « nos fidélités sont des fidélités dans les bourrasques ». La morosité et la mélancolie de l’époque trahissent un besoin de politique, de politique malgré tout, un besoin de liberté profane, de ne plus subir un destin mais de choisir sa propre histoire, sans la moindre certitude d’y parvenir.
Car les derniers seront les premiers. Car nous reconstruirons et nous recommencerons. Nous reviendrons. Nous revenons déjà. Parce que nous sommes « placés à la brèche », et que « nos fidélités sont des fidélités dans les bourrasques ». La morosité et la mélancolie de l’époque trahissent un besoin de politique, de politique malgré tout, un besoin de liberté profane, de ne plus subir un destin mais de choisir sa propre histoire, sans la moindre certitude d’y parvenir.
Résignations postmodernes. Porteuses d’espérance au seuil du XXe siècle, les politiques d’émancipation y ont subi une défaite historique. Non, comme le prétendent ceux qui s’obstinent à confondre les révolutions et leur contraire, avec la chute du Mur de Berlin et la désintégration de l’Union soviétique. Ce ne furent que l’épilogue d’une longue et double défaite. Face à l’ennemi principal, de longue date identifié pour tel, et aussi face à l’ennemi que l’on crut secondaire, l’ennemi intime, le parasite bureaucratique qui use et démoralise de l’intérieur.
La révolution passive néolibérale en est l’aboutissement et le point d’orgue. Une contre-révolution préventive, à l’image des guerres du même nom, qui vise à parfaire l’œuvre de dépolitisation dont ont toujours rêvé les classes dominantes : plus de classes sociales, plus de travail salarié et de capital, plus de possédés et de possédants. Ni droite, ni gauche ! Une communion solennelle au centre ! Versailles avec Montmartre. Jaurès et Barrès main dans la main sur la colline inspirée ! Plus de grève, plus de luttes. Tous unis dans l’effort, « gagnant-gagnant », et que le fayot méritant gagne quand même davantage !
L’Union soviétique et la Chine populaire furent présentées par d’aucuns comme les modèles d’un développement soustrait à la logique impitoyable du capital. L’effondrement de l’une et la conversion libérale de l’autre ont eu pour effet boomerang que beaucoup se sont sentis orphelins d’un modèle social et d’une perspective stratégique. Point n’est besoin de regretter la caricature despotique que fut leur « socialisme réel » et réellement inexistant, pour constater que l’irruption sur le marché mondial du travail de centaines de millions de travailleurs russes, chinois, ou est-européens, privés de droits et de protections sociales, constitue une défaite historique qui tire à la baisse les conditions de vie des travailleurs. Cette pression s’exercera longtemps encore sur leurs capacités de résistance jusqu’à ce qu’ils reprennent confiance en leurs forces et imposent leurs droits.
Dans les années 1970, face à l’épuisement de l’expansion d’après guerre, les gauches de gouvernement et les directions syndicales ont cru sauver le compromis social des années de croissance en révisant leurs exigences à la baisse. Ce fut le temps des « compromis historiques » et des « recentrages syndicaux ». Les envolées lyriques sur la grande « union des forces du travail et de la culture », l’ambition déclarée de « vivre mieux » et de « changer la vie » affichées en 1972 par le Programme commun de la gauche en France, firent long feu. L’horizon se réduisit peu à peu à la gestion de l’économie de marché, de l’orthodoxie monétaire, et de la modernisation libérale.
Les rhétoriques postmodernes furent l’expression et le ferment de ce changement de climat. L’apologie du liquide contre le solide, le goût du fragment contre la totalité, le renoncement aux grands récits, accompagnent comme leur ombre les ajustements libéraux, l’individualisation des salaires et des horaires, la flexibilité du travail et la fluidité des capitaux. L’heure est au zapping, aux révoltes sporadiques, aux identités kaléidoscopiques. L’événement se perd dans le fait-divers. La croyance en l’incroyable supplante la conviction raisonnée. Le poids des images accable la pensée. Le goût minimaliste de la miniature, des menus plaisirs, de la petite gorgée de bière, la rétraction de la durée dans l’instant, neutralisent toute ambition stratégique.
Moments utopiques. Coulées au long des « trente glorieuses » dans le moule de l’État social keynésien, grisées par l’illusion d’un progrès irréversible, les gauches de gouvernement se sont trouvées fort dépourvues lorsque fut venue la contre-offensive libérale des années 1980. Pour ceux qui refusèrent alors d’accompagner docilement l’aggiornamento capitaliste, ce fut l’heure des résistances. Un moment stoïcien. Tenir, ne pas céder aux caprices du temps et aux sirènes de la résignation. Persévérer, même si l’époque devenait de plus en plus opaque, et si l’horizon s’obscurcissait de manière inquiétante. Refuser de célébrer le fait accompli. Rester fidèle, continuer malgré tout, pour avoir le droit de recommencer. Ne pas consentir !
Avec le soulèvement zapatiste de janvier 1994 au Chiapas, les grèves de l’hiver 1995 en France, les manifestations de Seattle contre le sommet du G8 en 1999, le fond de l’air a repris des couleurs. La croisade du Bien s’est enlisée en Irak et en Afghanistan. Le volcan latino-américain gronde, tenant en échec le projet impérial d’un grand marché des Amériques. Moins de douze ans ont donc suffi pour que le discours triomphaliste de Bush senior, promettant au monde une ère de paix et de prospérité indéfinie, s’efface derrière la proclamation de la guerre sans limites par Bush junior. Pour que les nouvelles idoles chancellent, et que reculent les broussailles du mythe libéral. Aujourd’hui comme hier, gisent à terre les politiciens en qui les opprimés avaient mis leur espoir. Et, comme hier, « ils aggravent encore leur défaite en trahissant leur propre cause4 ».
L’hymne aux « valeurs » éclipse les programmes. Ce climat nauséeux de résignation et de restauration est propice aux échappées utopiques de l’exil et de l’exode. La gamme des évasions imaginaires est vaste : utopies réactionnaires de l’harmonie naturelle et de la « deep ecology » ; utopies philanthropiques, qui « déplorent sincèrement la détresse des pauvres » ; utopies compassionnelles, sponsorisées par la Banque mondiale, qui « prétendent faire de tous les hommes des bourgeois » sans s’attaquer de front au fléau de la dette et à la privatisation du monde ; utopies libertaires des microrésistances et des microsolutions qui laissent en l’état les méga-problèmes engendrés pas le despotisme de la marchandise.
Entrent alors en scène le cortège bigarré des faiseurs de miracles et des marchands de bonheur domestique tempéré, l’imposant aréopage des économistes fatalistes et la cohorte bruyante des magiciens doctrinaires, traçant sur la comète les plans du meilleur des mondes possibles, le chœur de ceux qui croient – ou le feignent – que la solution de tous les maux est dans l’échange équitable ou dans un système de garanties mutuelles qui feraient « de la concurrence un bénéfice pour tous5 ». Au lendemain de cuisantes défaites, ces fermentations sont sans doute nécessaires et fécondes, à condition de les purger des mythes qui les hantent, de libérer leurs rêves vers l’avant de la nostalgie des paradis perdus, de déchiffrer dans la poussière du réel les traces du possible.
Pertes et résurgences de la question politique. L’irruption des mouvements altermondialistes, l’écho du processus révolutionnaire bolivarien, l’irruption de la jeunesse des banlieues, la reprise des luttes étudiantes et lycéennes, n’ont pas suffi à inverser la spirale négative des privatisations, des délocalisations, des réformes de la protection sociale, de la dislocation du droit du travail. Faute de victoires sociales, les espoirs de changement se reportent alors sur les alternatives électorales dont beaucoup veulent encore espérer, avec de moins en moins d’illusions, un moindre pire.
Cette ruée au centre, cette négation du conflit, cette union sacrée des classes sur l’autel de l’entreprise, triomphent au moment où se fait sentir un pressant besoin de politique. Des grands commis de la mondialisation marchande prennent eux-mêmes conscience des effets désastreux et des dangers d’un capitalisme financier ensauvagé par la boulimie de profit, qui lacère les solidarités, concentre de manière indécente la richesse, lamine les amortisseurs de la rébellion sociale. Des voix modérées s’inquiètent du divorce entre le citoyen et l’actionnaire « vivant dans des galaxies distinctes », et de la schizophrénie du salarié appelé un jour à se licencier lui-même au nom de son intérêt de « petit porteur »6. D’autres s’élèvent pour demander de nouvelles formes de régulation entre l’économie, le social et la politique : « Seul le retour improbable de la politique (mais sous quelles formes et à quel niveau ?) permettra de redécouvrir les voies d’un développement plus équilibré 7. » Ce retour est pourtant bien moins improbable qu’un développement équitable du « capitalisme total ».
Les gauches en leur labyrinthe. Face aux grandes peurs crépusculaires et aux prophéties de malheur écologique, les dirigeants des gauches faillies sont en quête d’un nouveau grand dessein. Le problème est pourtant plus profond et plus grave qu’une simple panne d’imagination réparable grâce à l’effort conjugué de quelques cerveaux fertiles.
Avec l’effondrement et l’explosion de l’Union soviétique, les Partis communistes ont perdu leur référent matériel et leur source de légitimité illusoire. Incapable de renouveler significativement son assise sociale après 1968, le Parti communiste français a ainsi vu fondre les bastions industriels sur lesquels il avait bâti sa représentativité sociale depuis le Front populaire et la Libération. Incapable de régler ses comptes avec son passé, il est entré en état de mutation permanente. Mutation vers quoi et jusqu’où ? Mutation vers la mutation ? La dissolution de la Démocratie de gauche italienne (produit de la métamorphose de l’ancien Parti communiste en nouvelle social-démocratie) dans un nouveau Parti démocrate est saluée comme « l’ultime mue des communistes italiens » et comme « la clôture définitive de l’expérience historique inaugurée en 1921 à Livourne »8. L’ultime mue, ou le dernier soupir.
En contribuant activement au démantèlement et à la privatisation des services publics, à la dérégulation financière, à l’édification d’une Europe libérale, les partis sociaux-démocrates ont miné leur électorat populaire. Cherchant dans les classes moyennes la relève d’une base ouvrière en voie d’évaporation (au point d’effacer de son vocabulaire le mot même de « travailleur »), le Parti socialiste français a sapé par ses réformes gouvernementales ses appuis traditionnels dans les secteurs de la fonction publique, de l’enseignement, et de l’administration. Issues pour une large part de la noblesse d’État, ses élites dirigeantes ont noué, privatisations aidant, des rapports organiques avec les états-majors industriels et financiers du patronat9. Comme si cela ne suffisait pas, comme si cette mue silencieuse n’était pas déjà consommée, Pascal Lamy l’exhorte à assumer encore davantage son ralliement au despotisme de marché ! Comment s’étonner alors des transhumances et des porosités idéologiques. Quand il n’y a plus grand-chose à quoi rester fidèle, parler de trahison n’a plus guère de sens.
Alors que la droite ne jure plus que par la matérialité prosaïque de la chose économique, la gauche du centre, pour cacher sa conversion fervente aux délices du marché, célèbre des idéaux désincarnés et des idoles creuses. Ses partis historiques tiennent un discours pathétique de la refondation, de la rénovation, de la modernisation sans contenu. Lancée en 2003 par Dominique Strauss-Kahn comme une bouleversante nouveauté à la tribune du congrès socialiste de Dijon, la formule magique d’un « réformisme de gauche » eut passé naguère pour un maladroit pléonasme. Avec une gauche sans réforme et de moins en moins de gauche, elle devient involontairement humoristique.
Rénovation sans nouveauté. Refondation sans fondements.
À l’instar des redites de la mode radoteuse, ce formalisme du renouveau piaffe sur place dans la répétition du même.
Nouvelles gauches ? Le basculement au centre de la social-démocratie, l’interminable agonie des partis staliniens, la reprise timide des luttes sociales, ouvrent un espace à gauche de la gauche reniée. Pas un espace vide qu’il suffirait d’occuper, mais un champ de forces tiraillées par de puissants pôles magnétiques. Un espace instable, traversé de trajectoires aux bifurcations et aux rebroussements déconcertants. Comme l’ont montré les lendemains de la victoire du Non au traité constitutionnel européen, il n’est pas facile de transformer des victoires électorales défensives en dynamiques politiques et sociales offensives. L’agrégat des refus ne fait pas un projet commun. D’un discours radical contre la guerre et les discriminations à l’opportunisme électoral et gouvernemental le plus grossier, le chemin est parfois fort court. Le ralliement à l’ordre social-libéral de deux forces motrices du mouvement altermondialiste, le Parti des travailleurs brésilien et de Rifundazione comunista en Italie, en est la preuve. La déconnexion des luttes sociales et du jeu électoral fait que, sur le terrain institutionnel, l’heure est aux coalitions de centre-gauche, quand ce n’est, comme en Allemagne, aux grandes coalitions avec la droite de droite.
Principal dirigeant de Rifundazione comunista et président de l’Assemblée nationale italienne depuis les 2006, Fausto Bertinotti estime que la gauche européenne est aujourd’hui confrontée au défi le plus difficile de son histoire : celui de sa propre survie10. Il voit se dessiner un mode de domination misant sur la passivité des masses, faisant de l’entreprise un synonyme de l’intérêt général, effaçant toute frontière entre gauche et droite. Afin de « garder le jeu ouvert » et de préserver une possibilité d’alternative, l’unité de « deux gauches » – l’une, « troisième voie » ou « nouveau centre », social-libérale ; l’autre, radicale – deviendrait nécessaire sous peine d’avoir à constater qu’il n’y a plus de gauche du tout. Ou, ce qui reviendrait presque au même, une gauche électorale sans racines sociales d’un côté, et une gauche sociale combative sans électeurs de l’autre11. Une nouvelle dialectique entre ces deux gauches ne reproduirait nullement, d’après Bertinotti, la vieille opposition formelle entre réforme et révolution ; elle signifierait au contraire leur dépassement en acte.
Censé justifier la collaboration gouvernementale de Rifundazione comunista, ce ramage n’aborde pas le vif de la confrontation entre les projets politiques dont seraient porteuses ces deux gauches. Il ne se préoccupe pas davantage de savoir s’ils sont compatibles, au prix de quels compromis, et au bénéfice de quel allié hégémonique. Il se contente de les situer spatialement – du « centre gauche » à la « gauche radicale ». Toujours relatives, les positions spatiales ne disent rien, ou bien peu, sur les contenus et les pratiques politiques. Une robuste sagesse populaire enseigne que, pour s’aventurer à souper avec le diable, il faut une grande cuillère. Celle des organisations révolutionnaires en Europe est encore bien courte. L’union dans la confusion tourne toujours à l’avantage des dominants. Dans le cadre des rapports de forces réellement existants, la gauche radicale ne serait pas l’alliée mais l’otage de la gauche libérale. Croyant sortir de sa marginalité, elle se fondrait dans le gris camaïeu de la gestion subalterne et désorienterait ceux qui commencent à compter sur elle pour reconstruire l’espoir12.
Une patience pressée. Les alliances, en politique, ne sont pas affaire d’habileté, mais d’objectifs à atteindre et de rapports de forces. Sans quoi elles se réduisent à la manœuvre où, la plupart du temps, tel est pris qui croyait prendre. L’unité pour quoi faire ? Avec qui ? Sur la base de quels rapports de forces ? Dans son discours au congrès de fondation de Die Linke, en juin 2007, Oskar Lafontaine a martelé : « Nous sommes le parti de l’État social ». Et : « Il faut une nouvelle gauche qui dise : oui, nous voulons restaurer l’État social »13 !
La formule est aussi vague que fausse. On n’en reviendra pas aux mêmes modes de régulation, aux mêmes espaces politiques, aux mêmes formes de sécurité sociale fondée sur la stabilité et la pérennité de l’emploi, qu’à l’époque fordiste. Pour inverser le rapport entre capital et travail, détérioré depuis trente ans, il faudrait reconquérir les services publics et les étendre à l’échelle européenne, restaurer et renforcer le droit du travail, harmoniser à la hausse les salaires, les horaires de travail, et les systèmes de protection sociale, décréter une « nuit du 4 août » contre les privilèges fiscaux… Il faudrait rompre avec les critères de convergence en vigueur depuis Maastricht et avec le Pacte de stabilité, reprendre le contrôle politique de l’outil monétaire, affronter les lobbies de l’armement, de l’énergie, et des médias. Autrement dit, faire tout le contraire de ce qu’ont fait et de ce que font, depuis plus de vingt ans, les gouvernements de gauche et de centre-gauche.
Derrière les controverses programmatiques et les divergences sur les alliances, se dessinent des perceptions différentes des rythmes politiques et de leurs discordances. Comment concilier l’urgence des résistances et le temps long de la reconstruction ? Reconstruire sur les ruines du siècle des extrêmes sera lent et difficile. Il y faudra de la conviction et du courage, du sang et des larmes peut-être. Une lente impatience, sans doute. Une patience pressée, aussi. Sous peine de sacrifier l’urgente nécessité de changer le monde à des succès électoraux éphémères, à une prétendue efficacité illusoire, à l’ébriété de l’instant qui prépare et annonce la gueule de bois du lendemain.
Un fil dans le labyrinthe. La revendication altermondialiste d’un autre monde possible n’a pas (encore) abouti à une politique alternative. Le remue-ménage de la mondialisation se traduit aujourd’hui par de nouvelles dépossessions, de nouvelles prédations, et de nouvelles « enclosures », touchant le vivant et les savoirs. Au XIXe siècle, la crise de « la modernité restreinte » a mis en évidence les faiblesses d’une logique libérale fondée sur l’individualisme possessif et la réciprocité généralisée du contrat. Au prix de convulsions sociales, de guerres et de révolutions, elle fut temporairement surmontée grâce aux grandes formes de solidarité et de protection collectives arrachées de haute lutte. En indexant sur le statut du travail une sécurité sociale relative et une forme de propriété sociale (dont le régime des retraites par répartition est partie prenante), cette « société salariale » est parvenue, grâce à une croissance exceptionnellement soutenue, à conjurer les ravages de la désaffiliation sociale et de la concurrence de tous contre tous et toutes. L’entrée en crise de cette « modernité organisée » relance de plus belle la machine à inégalités, discriminations, exclusions14. Les solidarités sont déchirées. Les statuts collectifs, démantelés. Les risques, individualisés. Le travail, émietté et dispersé. Les assurances, privatisées. La « société du risque » (très inégalement partagé) devient celle du sauve-qui-peut général, du triomphe des mobiles et de l’apothéose des gagnants. Périssent les perdants et les scotchés !
Cette « grande transformation » présente tous les symptômes d’une crise historique de la loi de la valeur et du type de société qu’elle régit. Il serait cependant prématuré d’affirmer que « l’époque salariale est finie », ou que l’on serait « passé de l’affrontement entre le capital et le travail sur la question des salaires à l’affrontement entre la multitude et l’État autour de l’instauration d’un revenu citoyen »15. Étroitement liées, la question du travail et celle de la propriété sont les deux grands défis politiques de l’époque qui s’ouvre. Le choix est entre une logique concurrentielle impitoyable – « l’haleine glacée de la société marchande », écrivait Benjamin –, et le souffle chaud des solidarités et du bien public. Cette logique implique d’oser des incursions résolues dans le sanctuaire de la propriété privée et de construire un espace public en expansion, sans lequel les droits démocratiques eux-mêmes seraient voués à dépérir. Pour ne pas s’égarer dans les labyrinthes d’une politique au jour le jour, nul besoin de modèles, un fil d’Ariane suffirait, qui permette de démêler les compromis qui rapprochent du but de ceux lui tournent le dos.
Les prophéties qui, il y a dix ans à peine, annonçaient « la fin du travail » ont fait long feu. Le dénigrement systématique du travail comme pure aliénation et le culte néolibéral de sa « valeur » théologique (gagner sa vie à la sueur de son front) ne sont, au fond, que l’envers et l’endroit d’une même médaille. Il est question aujourd’hui de « travailler plus » – et plus longtemps – pour gagner moins. Le travail continue à jouer un rôle central dans la reconnaissance sociale, dans l’accès aux systèmes de protection, dans les conditions de l’autonomie personnelle. Près de 90 % de la population française est couverte socialement à partir du travail, y compris dans les situations de chômage ou dans les régimes de retraite. La captation par la droite conservatrice de « la valeur-travail » cherche à déplacer l’opposition entre travail et capital vers celle, culpabilisante, entre « ceux qui se lèvent tôt » et ceux qui sont censés se prélasser sur le mol oreiller de l’assistanat. À la moraline patronale, il est plus que jamais actuel, pour des raisons aussi bien sociales, écologiques, que démocratiques, d’opposer la nécessité de travailler moins mais mieux, et de travailler tous et pour vivre plus.
Et pourtant, elles luttent… Face aux dégâts des crises sociales et écologiques, l’urgence de changer le monde est plus pressante que jamais. Les doutes sont aussi forts quant aux forces capables d’y répondre, et quant à la possibilité même d’y parvenir. S’il s’avérait que les classes et leur lutte s’affaissent au profit d’appartenances exclusives – tribales, ethniques, ou confessionnelles –, que le cercle de fer de la reproduction sociale et le fétichisme absolu de la marchandise accablent « l’homme unidimensionnel » au point d’anéantir en lui toute velléité de résistance, s’imposeraient deux conclusions aussi désespérantes l’une que l’autre. Soit que l’émancipation fut un beau rêve, aujourd’hui brisé, et qu’il faudrait désormais se contenter de corriger à la marge les inégalités et les injustices. Soit que, seuls dépositaires d’un potentiel critique face aux oppressions subies par le commun des mortels, les intellectuels seraient appelés à jouer le rôle de conscience morale universelle et d’experts scientifiques du nouvel ordre mondial. Sans les contradictions inhérentes au logiciel du capital et sans l’émergence d’une conscience critique dans et par les luttes, l’ambition de changer le monde relèverait en effet d’un pur volontarisme éthique ou d’une utopie doctrinaire.
Il n’y a pas à regretter l’image d’Épinal d’un Prolétariat majuscule en grand chevalier héroïque de l’émancipation. La pluralité des contradictions sociales, les différenciations au sein du salariat, l’apparition d’un « travail diffus », la discordance des temps et des espaces sociaux, obligent à penser au pluriel les forces de changement pour répondre au défi de leur rassemblement. La déconcentration et la dispersion des sites de production, l’individualisation des salaires et des horaires, la généralisation de la flexibilité, la pression du chômage et de la précarité, multiplient les différenciations et fragmentent les collectifs. Derrière le magma confus des « classes moyennes », émerge un prolétariat à la fois élargi et fragmenté, dont l’unité n’est pas une donnée naturelle mais une construction politique à réaliser.
Deux lectures de ces évolutions s’opposent. L’une y voit une extension du prolétariat aux secteurs employés dans les services ; l’autre, une croissance explosive des classes moyennes. Ce mythe a inspiré la stratégie électorale de Giscard en 1974, avec un certain succès, et celle de Lionel Jospin en 2002, avec le résultat désastreux que l’on sait. Entre-temps, l’euphorie des « trente glorieuses » a fait place à la morosité des trente piteuses. Plus de la moitié de la population est aujourd’hui persuadée que la vie sera plus dure pour les générations à venir qu’elle ne l’est pour elle-même. Plus de la moitié imagine pouvoir se retrouver un jour sans toit. Le portrait-robot tracé hier de « l’homme moyen » idéalisé correspond désormais à 10 % plutôt qu’à 70 % de la population. La crainte monte que « le long processus de promotion et de mobilité sociale se retourne en menace de chute et de déclassement16 ». L’écart de revenu entre trentenaires et quinquas se creuse, l’inadéquation entre diplômes et emplois s’accentue, l’avenir de la protection sociale est sombre. Prétendre dans ces conditions que, « si la classe ouvrière n’est plus fordiste, c’est une victoire », est une ânerie pure et simple17. Tout dépend de savoir au profit de qui, et dans quelle direction, se fait la sortie du fordisme. La dérégulation libérale du marché du travail, la flexibilité imposée, l’individualisation salariale ne signifient pas davantage de liberté pour les travailleurs, mais – les statistiques sur les accidents du travail, le stress, les dépressions, les suicides, en témoignent – de nouvelles servitudes, de nouvelles pathologies, de nouvelles souffrances, qui ne valent pas mieux que les anciennes.
Bourgeoisie et prolétariat seraient désormais « des curiosités historiques, la lutte des classes une vieille lune, les grèves et les syndicats des souvenirs18 » ? L’histoire de l’humanité ne serait donc plus celle de la lutte des classes ? Et pourtant, elles luttent !
La politique perdue et retrouvée. La politique se meurt ? Une certaine politique, du moins. Une autre renaît dans les pratiques et les luttes sociales. La force de Le Pen fut de faire de la politique quand d’autres se contentaient de gérer les affaires courantes. Nicolas Sarkozy l’a compris, qui construit son image en trompe l’œil sur la réhabilitation de la volonté politique (ou de son simulacre médiatique) contre le fatalisme économique.
La subordination de la politique à une marche inéluctable du progrès historique eut hier pour résultat de forclore la question de la justice sociale. La subordination de la décision démocratique à la volonté anonyme des marchés aboutit aujourd’hui au même résultat. Affirmer le primat de la politique sur l’histoire et sur l’économie, c’est rouvrir au contraire les questions de la justice et de l’égalité, qui sont ses véritables enjeux.
Ce texte constitue le chapitre V d’Un nouveau théologien, B.-H. Lévy, paru aux éditions Lignes en janvier 2008.
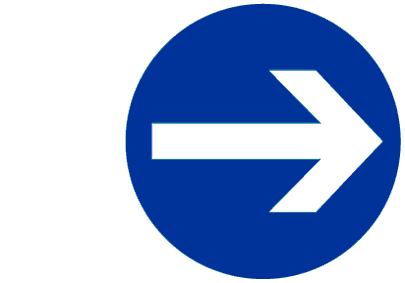
Documents joints
- Péguy, Notre jeunesse, Paris, Folio, 1993, p. 101.
- Ibid., p. 130.
- Péguy, Un nouveau théologien, M. Laudet, Paris, Gallimard, 1936, p. 67.
- Walter Benjamin, Huitième thèse sur le concept d’histoire.
- Avant l’essor de la grande industrie, la demande précédait l’offre et « la production suivait pas à pas la consommation ». Depuis, « la production commande la consommation et l’offre la demande », de sorte qu’il n’est plus possible de ramener le travail complexe socialisé au travail simple du « travailleur immédiat » : « Les rapports sociaux ne sont pas des rapports d’individu à individu, mais de travailleur à capitaliste, de fermier à propriétaire foncier, etc. Effacez ces rapports, et vous aurez anéanti toute la société. », Karl Marx, Misère de la philosophie, Paris, UGE 10-18, 1966, p. 361.
- 300 millions d’actionnaires dans le monde et quelques dizaines de milliers de gestionnaires aux gratifications exorbitantes monopolisent la quasi-totalité de la richesse boursière de la planète.
- Jean Peyrelevade, Le Capitalisme total, Paris, Seuil, « La République des idées », 2005, p. 10.
- Le Monde, 4 mai 2007.
- Le nombre de postes dans la fonction publique a diminué de moitié en vingt ans, les contrats à durée déterminée représentent désormais deux tiers des embauches, le Parti socialiste qui recueillait encore 74 % du vote ouvrier en 1981 n’en recueillait plus que 13 % en 2002 (contre 33 % à l’extrême droite).
- Fausto Bertinotti, « Massa critica et novo soggetto politico », in Alternative per il socialismo, n° 2, août 2007.
- Ibid.
- Au Brésil, le paiement rubis sur l’ongle de la dette au FMI a privé la réforme agraire et le programme faim zéro des ressources budgétaires nécessaires. En Italie, après avoir érigé la non-violence en principe programmatique, Rifundazione comunista a voté les expéditions militaires dans le cadre de l’Otan, l’austérité, et purge ses rangs. En Italie comme au Brésil, la conversion brutale de la gauche au social-libéralisme s’est soldée par l’exclusion du Parti des travailleurs ou de Rifundazione d’élus restés fidèles aux principes constitutifs de leur parti.
- Discours d’Oskar Lafontaine en juin 2007 lors du congrès constitutif de la nouvelle organisation de gauche « Die Linke » (la gauche), issue de la fusion entre une petite dissidence de la social-démocratie dans l’ancienne Allemagne de l’Ouest, le PDS (héritier social-démocratisé de l’ancien parti communiste d’Allemagne de l’Est), et un nouveau courant issu principalement de milieux syndicalistes radicaux.
- Voir Peter Wagner, Liberté et discipline. Les deux crises de la modernité (Paris, Métaillé, 1996) ; et Robert Castel, L’Insécurité sociale (Paris, Seuil, 2003)
- Toni Negri, Good by, Mister Socialism, Paris, Seuil, 2007, p. 240. Il est tout aussi hasardeux et carrément insensé de prétendre, au moment où la spéculation boursière organise la concurrence en temps réel et où les constitutionnalistes européens entendent graver dans le marbre le principe d’une « concurrence libre et non faussée », que « la concurrence n’est plus une dimension fondamentale de l’économie » (ibid., p. 212).
- Le Monde 24 janvier et 24 mai 2007.
- Toni Negri, op. cit., Paris, Seuil, 2007, p. 187 et 140.
- Jean Peyrelevade, op. cit., p. 59 et 91.