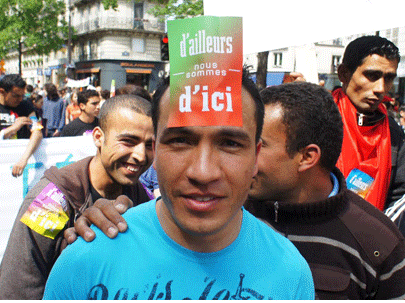
Ce texte recoupe très largement le chapitre sur l’étranger intérieur du Pari mélancolique paru chez Fayard en septembre 1997. Il est antérieur à cette parution.
Tout ce qui était humain devient étranger
Heiner Müller
L’universel, c’est le local moins les murs
Miguel Torga
Au cours de la Révolution française émerge une figure moderne de l’étranger, déterminée par son rapport à l’État-nation, en rupture avec le cosmopolitisme des Lumières. L’opposition national/étranger prend alors le pas sur le clivage philosophique humanité/sauvagerie. Dans la tradition cosmopolitique, l’espace public nouveau ne conçoit pas encore la clôture du national. Illimité, il demeure garanti par l’universalité de la Raison. C’est pourquoi la déclaration des Droits est universelle. La nation qui se constitue dans l’épreuve se pense d’abord comme un exemple offert au genre humain.
La Convention n’est qu’une réalisation partielle du congrès de l’univers.
Métamorphoses de l’étranger
Anacharsis Cloots est le représentant typique de cet universalisme. Pour lui, la notion même d’étranger est « une expression barbare » qui traduit « le morcellement du monde », mais la nature ne connaît point d’étranger. Son propre destin illustre parfaitement le changement de perspective opéré à travers l’expérience révolutionnaire. Dans l’élan initial, l’idée de patrie prime celle de nation. La patrie d’un peuple libre, insiste Saint-Just, « est ouverte à tous les hommes de la terre ». « Lieu de l’agir révolutionnaire », selon l’expression de Sophie Wahnich, la patrie signifie une appartenance politique volontaire.
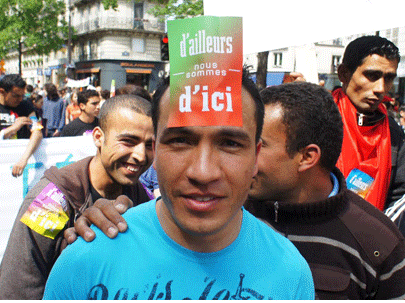 Une cosmopolitique de notre temps
Une cosmopolitique de notre temps
Ouverte à l’autre, la philosophie des Lumières est foncièrement cosmopolitique. Différent de l’ancien cosmopolitisme stoïcien, ce cosmopolitisme moderne traduit une nouvelle vision du monde, pluraliste et perspectiviste, consécutive à la conquête du nouveau monde. Le terme est consacré au milieu du XVIIIe siècle par Le Cosmopolite ou le citoyen du Monde de Fougeret de Montbron. Grand penseur de cette intersubjectivité constituante, Kant avance, dans son Projet de Paix perpétuelle, l’hospitalité universelle comme le seul principe inconditionnel de droit international, principe réciproque puisque, la terre étant ronde, on est inévitablement conduit à s’y rencontrer, à s’y croiser, à s’accueillir les uns les autres. Avec l’idée d’une planète désormais explorée la gestation du principe national, illustré par les révolutions française et américaine, le problème d’un « nouvel ordre mondial » se trouve alors posé une première fois. En effet, « le problème de l’établissement d’une constitution civile parfaite dépend du problème de l’établissement d’une législation qui règle les relations extérieures des États et ne peut être résolu sans lui9 ». Il s’agit par conséquent « d’introduire une force unifiée et, par suite, une situation cosmopolitique de sécurité publique des États ».
Ce projet hante depuis toutes les tentatives institutionnelles d’établir une coopération pacifique entre États, de la Société des nations à l’Organisation des Nations unies. Au moment où il écrit son Idée d’une histoire universelle, Kant comprend bien que sa proposition puisse apparaître incroyablement « romanesque ». Mais il maintient son projet à vrai dire « étrange et apparemment absurde » de « vouloir rédiger l’histoire d’après l’idée du cours qu’il faudrait que le monde suive ». Car l’idée que l’on se fait de l’histoire peut jouer un rôle par elle-même et favoriser l’avènement d’un millénium philosophique. Si l’objectif poursuivi n’est pas promis avec certitude, il n’en contribue pas moins à fixer le but de l’effort à fournir. Ce but sera donc celui d’un « grand organisme politique futur », d’un « État cosmopolitique universel » qui arrivera un jour à s’établir10.
L’idée de cet État cosmopolitique universel, dans le contexte même où elle est formulée, est étroitement associée à celle d’un « progrès régulier du perfectionnement de la constitution politique sur notre continent », et à la recherche obsédante d’un « fil conducteur » permettant de démêler le sens de l’histoire universelle. Elle présuppose une universalité abstraite de la Raison, équitablement répartie et partagée, qui doit venir à bout des ombres et des préjugés. Dans son portrait de Voltaire, « dernier écrivain heureux », Roland Barthes a bien souligné cet optimisme d’une époque où tout semble devoir s’arranger avec le triomphe des Lumières. Contrairement à cette attente, la Révolution française devait porter à l’avant-scène deux formes contemporaines du conflit : la guerre moderne entre nations et la lutte acharnée entre les classes.
À l’épreuve de cette double expérience, l’universalité cosmopolitique des Lumières se transforme en universalité internationaliste du mouvement prolétarien. L’espace cosmopolitique de Kant est encore, comme celui de Newton, homogène et vide. L’espace international de Marx, de Rosa Luxemburg, de Lénine, sera rempli de classes, de nations, de rapports de dépendance et de domination façonnés par la circulation du capital et l’expansion impérialiste.
L’internationalisme, c’est précisément la conjugaison du national et du social sous condition du social. Les solidarités de classe transgressent les frontières et cherchent toujours à reconnaître, dans le camp opposé, un autre soi-même. Mais ces solidarités ne peuvent pas ignorer l’organisation spatiale et géopolitique. Le monde n’est pas, comme voulait le croire Cloots, une somme d’individus doués de raison, directement plongés dans une intersubjectivité éthique et communicationnelle. Leur existence concrète est le produit de multiples déterminations, sociales, nationales, sexuelles. C’est bien cet espace réel, et non pas imaginairement neutre, qu’il convient d’organiser sur d’autres principes, internationalement. Stratégiquement parlant, cela signifie que « le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s’ériger en classe dirigeante de la nation, devenir lui-même la nation », et il est « encore par là national ». C’est seulement « du jour où tombe l’antagonisme des classes à l’intérieur de la nation » que « tombe également l’hostilité des nations entre elles11 ».
L’histoire du mouvement révolutionnaire depuis la moitié du XIXe siècle se joue dans cette dialectique des classes et des nations. Les révolutionnaires internationalistes sont, à leur manière, des pionniers du « sans frontières » et du « sans papiers ». Jan Valtin, bourlinguant, « sans patrie ni frontière ». Trotski, errant de Alma Ata à Prinkipo et Coyoacan sur une « planète sans visa ». Che Guevara, arpentant les Amériques, le Vietnam et le Kivu, pour échouer en Bolivie. Et les footloose rebels de l’IWW. Marx lui-même, et Lénine dans son train plombé.
Tous ceux-là ont rêvé, grand angle, d’une citoyenneté mondiale et d’une fraternité planétaire. L’espace les a rattrapés et dépassés. Le rêve a viré au cauchemar. L’« erreur » du socialisme de Staline comme celui des socialistes prompts à l’union sacrée n’est autre chose que le « socialisme national », utopique et réactionnaire, le « socialisme dans un seul pays ». Cette utopie réactionnaire s’accommode d’ailleurs fort bien d’un internationalisme abstrait, dominical, sans contenu pratique, comme d’un « internationalisme socialiste » (sinistre formule consacrée sous Brejnev pour légitimer un droit d’ingérence bureaucratique dans les pays frères).
La réalité nationale ne saurait être purement et simplement absorbée dans le socialisme pur de la lutte des classes, parce que les nations pour une époque donnée, « les particularités nationales forment l’originalité des traits fondamentaux de l’évolution mondiale » : « L’originalité nationale représente le produit final le plus général de l’inégalité du développement historique12 ». C’est pourquoi la lutte révolutionnaire commence sur l’arène nationale, à l’échelle où se nouent les rapports de forces inscrits dans un espace politique donné, mais s’élargit et se poursuit de manière ininterrompue à l’échelle internationale, car « c’est seulement à l’échelle mondiale qu’on pourra réconcilier le développement inégal de l’économie et de la politique13 ».
Sous le choc de la Première Guerre mondiale, Lénine a parfaitement saisi, en relisant la grande Logique de Hegel, cette dialectique révolutionnaire de l’universel et du singulier, qui n’intervient pas dans la cosmopolitique des Lumières. Lorsqu’Hegel parle de « l’universel qui englobe en soi la richesse du particulier », Lénine souligne dans les marges de son exemplaire annoté : « Formule magnifique ! “Pas seulement abstraitement un universel, mais l’universel qui englobe en soi la richesse du particulier, de l’individuel, du singulier” (toute la richesse du particulier et du singulier !) !! Très bien14. » La politique constitue l’inscription dans un espace-temps particulier d’une universalité de l’espèce, non pas donnée naturellement, mais visée et réalisée historiquement.
La mondialisation comme achèvement cosmopolitique de l’idéal des Lumières signifierait alors l’extinction de la politique dans l’administration mondiale des choses et dans la morale privée. Or, la dialectique de l’universel et du particulier, de l’enrichissement mondial et de l’appauvrissement du particulier, continue à jouer, de sorte que « chaque nouveau cran dans la mondialisation techno-économique hausse d’un cran équivalent la balkanisation ethno-culturelle de la planète15 ». L’unification marchande déplace ailleurs le principe de différenciation qu’elle prétend abolir. Elle ne produit que de l’universalisation manquée et mutilée. Il n’y a pas dès lors à s’étonner si « le rétrécissement des appartenances vécues sert de contrepoids à la planétarisation affichée de l’horizon » (sous domination) : « Il ne suffit pas à une culture mondialisée d’être supranationale pour être cosmopolite. » Elle porte au contraire les couleurs de la puissance dominante. Le téléspectateur européen sera donc plutôt américain : « L’audiovisuel démocratique d’aujourd’hui ne mondialise pas les auditoires nationaux », mais seulement le modèle culturel déjà dominant.
L’hyperrationalisme des élites cosmopolitiques nourrit donc la recherche identitaire et la resacralisation. Le Gatt, le FMI et l’Alena ont pour envers la révolte indienne du Chiapas. L’Eldorado européen pulvérise une Europe orientale et centrale où chaque nation veut tenter seule sa chance. L’universalisme moral de Jürgen Habermas s’efforce vainement de moraliser ce cosmopolitisme de la marchandise et non plus de la raison : « Relativiser sa propre façon de vivre pour légitimer les revendications d’autres formes d’existence ; reconnaître l’égalité des droits aux étrangers et aux autres, avec leur idiosyncrasie et leur intelligibilité ; ne pas projeter sa propre identité comme si elle était universelle ; ne pas marginaliser ce qui s’écarte de sa propre identité ; assurer l’augmentation ininterrompue de la tolérance16. » Ces commandements de bon aloi tournent à vide sans résoudre le moins du monde les défis politiques réels.
Une perspective universaliste et pluraliste n’est pourtant pas nécessairement communautaire. Les insurgés du Chiapas, en ne proposant pas la séparation mais une reformulation de la nation mexicaine, donnent un bel exemple de dialectique concrète de l’universel le plus universel (« intergalactique ») et du particulier le plus singulier (la communauté indigène). Ainsi compris, l’internationalisme reste la réponse la plus appropriée au nouvel état du monde. Ce qui prétend effacer sans redéfinir le lien social les lieux et les paysages des nations, abolit en réalité l’espace du politique au profit du profit et d’institutions auxiliaires d’un capital réellement sans frontières. L’Europe « post-nationale » de la monnaie unique, résurgence désaccordée de la cosmopolitique du XVIIIe siècle, réactive alors l’idée corollaire d’une histoire universelle orientée dans le sens d’un progrès inéluctable. Il faudrait tout accepter au nom d’une loi de l’histoire, devant laquelle toute réticence, toute réserve, ou résistance, deviendrait archaïque et conservatrice. « Faire l’Europe revient alors à faire que l’Histoire se fasse », et peu importe quelle Europe !
On applaudit en même temps, sans craindre la contradiction, aux peuples qui sortent de leurs cages dans l’ancienne Union soviétique ou dans l’ancienne Yougoslavie, sans voir que le mouvement des plaques tectoniques n’a aucune raison d’arrêter ses effets sur les lignes de l’ancien partage, et qu’il travaille aussi l’Italie, l’Espagne, la Belgique, demain pourquoi pas l’Allemagne réunifiée. Car il n’est ni sûr ni fatal que « le renforcement des interdépendances et la disparition de l’exception socialiste » rendent à l’idée internationaliste sa noblesse d’antan. Le jeu de bascule entre la mondialisation abstraite, monétaire et marchande, et les particularismes identitaires vindicatifs peut parfaitement s’imposer comme la forme contemporaine, « postmoderne », de la barbarie de notre temps. Rien ne prouve que l’État le plus grand soit le meilleur, parce que plus proche de l’universel, comme le suggérait l’idéal kantien du « grand organisme politique futur ». Mais la réciproque du small is beautiful n’est pas convaincante non plus.Reste donc à trouver la bonne échelle. Une échelle mobile, sans doute.
Prétentaine n° 9-10, « Étranger, fascisme, antisémitisme, racisme », avril 1998
Institut de recherches sociologiques et anthropologiques (Irsa)
Université Paul-Valéry, Montpellier-III
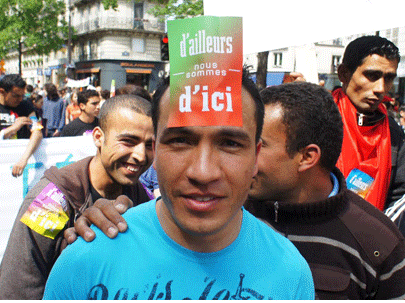
Documents joints
- Sur la question de l’étranger dans la Révolution française, voir la superbe thèse de Sophie Wahnich, L’Impossible Citoyen, l’Étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1997.
- Archives parlementaires, tome 62, 34e annexe, 17 avril 1793, p. 594.
- Lénine, Œuvres, tome XIX, Moscou, Éditions du Progrès, octobre 1913, p. 489.
- Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, tome II, « L’Impérialisme », Paris, Seuil, 1984, p. 67.
- Voir Sami Naïr, Le Regard des vainqueurs, Paris, Grasset, 1992 ; Sami Naïr et Javier de Lucas, Le Déplacement du monde, Paris, Kimé, 1996.
- Voir Anne Tristan, Clandestine, Paris, Stock, 1993.
- Bertrand Badie et Marie-Claude Smouts (sous la direction de), L’International sans territoire, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 13.
- Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, livre V, Paris, Flammarion, 1997, p. 345.
- Emmanuel Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, « Septième proposition », Paris, Bordas, 1988, p. 18.
- Ibid., p. 24 et 25.
- Karl Marx et Friedrich Engels, Manifeste du Parti communiste, Paris, Éditions sociales, 1966, p. 64.
- Léon Trotski, La Révolution permanente, Paris, Gallimard, 1964, p. 13.
- Ibid., p. 204.
- Lénine, Cahiers philosophiques, Paris, Éditions sociales, 1973, p. 96.
- Régis Debray, Cours de médiologie générale, Paris, Gallimard, 1991, p. 83.
- Jürgen Habermas in David M. Rasmussen, Universalism vs Communitarism. Contemporary Debates in Ethics, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 1990.