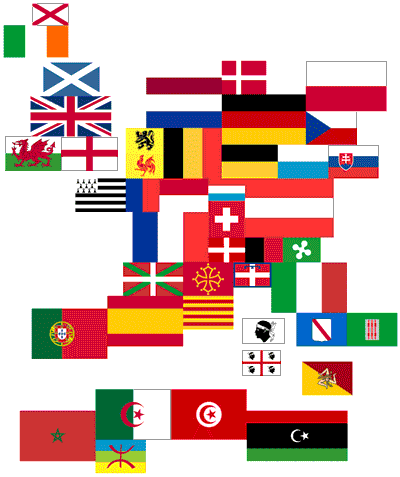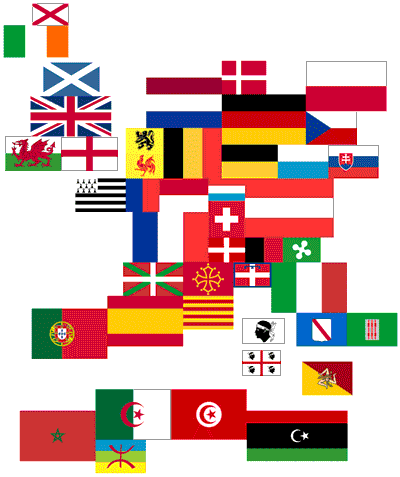
Le président du Fonds monétaire international, Michel Camdessus, déclarait récemment dans un entretien que nous sommes « tous des mutilés de l’universel ». Il faut que la situation soit grave. Car le fondé de pouvoir du capital international n’est guère prodigue de ces profondeurs philosophiques. La mondialisation tant louée comme synonyme d’ouverture « sans frontières » est en effet, dans la réalité, une mondialisation marchande, abstraite et inégalitaire, qui nourrit en retour les paniques identitaires, la névrose des différences, le cramponnement au local, la rhétorique de la proximité, l’angoisse de l’enracinement.
Tous des mutilés. Le diagnostic n’est pas faux : mutilés du corps, mutilés du cœur, mutilés de l’esprit et de la langue. Mais chez les mutilés aussi, certains le sont plus que d’autres, et mieux vaut encore être du côté des mutilés dominants que des mutilés dominés, doublement mutilés, mutilés au carré. Dont les sans-papiers et les sans-papières, nouveaux parias de la mondialisation, sont devenus l’emblème. Avant d’entrer dans le vif du sujet, j’aimerais évoquer en quelques mots ce qui, à mes yeux, se trouve à l’arrière-plan de cette mutilation généralisée. Ce que j’appelle un dérèglement de la mesure du monde. Si l’on considère deux grandes manifestations de la crise de civilisation en cours, la crise dite du travail (la formule me paraît inexacte) et la crise écologique, elles renvoient à une même contradiction : la crise de la mesure marchande. Plus le travail devient social, collectif, abstrait, plus il incorpore de savoirs accumulés, et plus il devient difficile, irrationnel même, de mesurer ce travail au temps de production abstrait déterminé par l’échange marchand. Le chômage et l’exclusion massifs et durables sont la sanction de cette irrationalité liée à une crise non du travail en général mais d’un rapport social spécifique entre travail salarié et capital. De même, le rapport des sociétés humaines à leur environnement met en jeu des équilibres de longue ou de très longue durée. Qu’il s’agisse de la déforestation, de l’effet de serre, du stockage des déchets, nos choix affectent notre maison commune pour des dizaines d’années, des siècles voire des millénaires. L’évaluation de ces dégâts ne saurait être ramenée à l’arbitrage immédiat et à la courte vue des marchés. C’est pourtant ce qui se passe. Même quand s’opère une prise de conscience planétaire, par exemple lors des récentes conférences de Kyoto et de Buenos Aires, sur les périls du réchauffement, la réplique des dominants, en l’occurrence les États-Unis, consiste à réclamer l’institution d’un marché des droits à polluer.
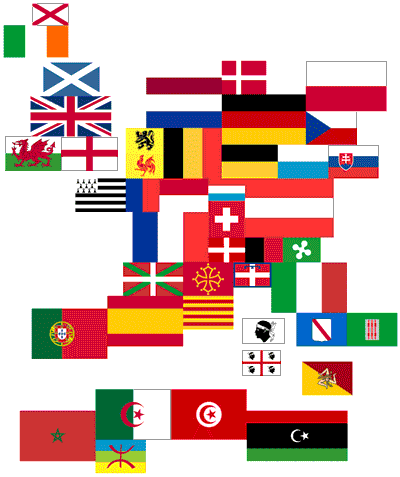 Après les marchés, le déluge ?
Après les marchés, le déluge ?
Crise de la mesure donc ? Elle se traduit au quotidien par un remue-ménage des lieux et des rythmes de la politique. Aristote savait déjà que la politique s’inscrit dans des conditions très précises d’espace et de temps, de distance et de rythme. En son temps, c’étaient ceux de la cité. Puis il y eut les empires, les cités de la Renaissance, les nations. Aujourd’hui, ni les espaces nationaux débordés par la mondialisation de l’économie, du droit, de l’information, ni les rythmes des mandats électoraux, débordés par la vitesse des messages, des décisions, de la circulation, et par les conséquences à très long terme de certaines décisions, ne sont adéquats à l’exercice d’une souveraineté politique. La montée en puissance de la notion de gouvernance trahit une forme de résignation à cet abandon, réduisant la politique à une gestion administrative dépolitisée. C’est une confirmation du risque entrevu par Hannah Arendt « que la politique disparaisse complètement du monde », mais d’une autre manière qu’elle ne l’avait prévu.
Et l’étranger, dans ce bouleversement ?
Nous ne l’avons pas perdu de vue. Le désajustement du monde se traduit par un gigantesque processus de déterritorialisation/reterritorialisation, par un réaménagement des espaces et des échelles, par une redéfinition du dedans et du dehors, par un chevauchement des ensembles, par un nouveau dispositif des voisinages et des intimités. Il peut aussi aboutir à une nouvelle représentation, voire à une guerre des appartenances. L’affaissement des appartenances nationales trouve sa contrepartie dans la revendication d’appartenances ethniques, communautaires ou religieuses (qui ont l’avantage dans le procès de mondialisation d’être immédiatement nomades).
Historiciser la nation
Il se trouve que l’on vient de célébrer le trois-cent cinquantième anniversaire du traité de Westphalie, considéré comme l’acte de baptême de l’Europe des États-nations. C’est dire à quel point notre univers géopolitique familier (celui des cartes colorées métamorphoses de l’Europe politique dans les écoles) est récent et précaire. D’ailleurs, ces mêmes cartes sont toujours surchargées de pointillés ou de traits gras qui indiquent le déplacement des frontières, du traité de Vienne à celui de Yalta, en passant par l’unité allemande (la première), l’unité italienne ou le traité de Versailles.
Ce constat en appelle un autre. Loin de former un couple naturel, l’association entre la République et la Nation, entre la nationalité et la citoyenneté, si présente dans le débat français, est hautement problématique. Dans le vocabulaire de Rousseau, la « patrie » désigne encore une appartenance politique élective fondée sur l’adhésion volontaire à des principes et non sur un lieu de naissance. La première déclaration des droits de l’homme se veut universelle et la Constituante n’est que le premier élément d’un congrès de l’univers conforme à la vision cosmopolitique des Lumières. C’est pourquoi la formule de « l’étranger patriote » appliquée à Anacharsis Cloots ou à Thomas Paine n’est pas à l’époque paradoxale.
L’identification de la république à la nation est donc le résultat d’un processus historique qui s’étend sur près d’un siècle, qui passe par les guerres nationales, les guerres napoléoniennes, les révolutions de 1848, les conquêtes coloniales, et qui n’est pleinement consommé qu’après la défaite de la Commune, sous la IIIe République. C’est alors seulement que la République prend la forme canonique à trois dimensions : la nation (et l’institution du code de la nationalité), l’armée nationale, et l’école de la République. Mais, même alors, la République, en ce qu’elle garde quelque chose de son élan initial d’universalité continue d’excéder la nation retranchée dans ses lignes et ses frontières.
Si l’État-nation, réalisant la correspondance plus ou moins harmonieuse entre un territoire, un marché, un État, est bien devenu le modèle de l’organisation géopolitique, il n’a pas pris partout, loin s’en faut, la forme relativement homogène qui caractérise le cas français. L’Autriche-Hongrie d’hier, la Yougoslavie, l’Union soviétique, ou plus près de nous l’Espagne, la Grande-Bretagne même ont toujours été des États plurinationaux. Et que dire de la Belgique ? Ou du résultat de l’unification italienne tardive ?
La mondialisation remet en branle le kaléidoscope.
Elle fait circuler non seulement les marchandises et les capitaux, mais les populations. Elle effrange les frontières, établit de nouveaux espaces régionaux, enclave des zones franches, superpose les tracés diplomatiques, juridiques, économiques, écologiques. L’anglais dispose de deux mots (borders et frontiers) pour marquer la différence entre la frontière moderne, avec ses douanes et ses bureaux de change, et ce qu’on appelait jadis « les marches », ces lointains où les limites se brouillent et se perdent. La mondialisation, ainsi que l’indiquent les développements du droit international, ramènerait en force les notions cosmopolitiques de la vision kantienne du monde, conjuguant des appartenances multiples et croisées, mais avec pour contrepartie des replis et des fermetures communautaires.
Cette situation de transition, de « déjà plus » et de « pas encore », est chargée également de promesses et de périls.
L’étranger intime
Notre vocabulaire est imprégné dans une large mesure d’une sémantique des temps et des espaces qui est toujours celle héritée de la Révolution française. Pour ne pas être trop long, je me contenterai de renvoyer à ce propos aux études de Reinhart Koselleck (Le Futur passé), ou de Jean-Marie Goulemot (Le Règne de l’histoire). C’est dans cet horizon spatio-temporel que s’inscrit et se dessine peu à peu la silhouette contemporaine de l’étranger. Je dois l’essentiel sur ce point au très beau livre de Sophie Wahnich : L’Impossible Citoyen.
Au fil du processus révolutionnaire, l’antonyme nation/étranger s’impose au détriment de l’antonyme humanité/sauvagerie, caractéristique de la cosmopolitique du XVIIIe. Le destin du « baron prussien » député à la Convention Anacharsis Cloots est la tragique illustration de cette évolution. Pour Cloots, homme des Lumières, la notion même d’étranger est encore « une expression barbare ». D’abord accueilli et fêté dans la fraternisation révolutionnaire comme une sorte de délégué de l’humanité, il est, au fur et à mesure que la guerre durcit le sentiment national, frappé de suspicion avant d’être accusé « d’avoir habité la France en nomade » et exécuté dans les charrettes du printemps 1794.
En fait, les conditions d’accès à la citoyenneté (qui ne se distingue pas alors de la nationalité) fluctuent avec la vague révolutionnaire. Dans la Constitution de 1791, sont requis cinq ans de « domicile continu » sur le sol français. Partisan convaincu d’une citoyenneté nomade dérivée d’un droit naturel et clairement découplée de la nationalité, le citoyen américain Joël Barlow critique ces conditions. Pour lui, la communauté souveraine est définie comme une communauté politique ouverte aux étrangers comme aux nationaux. La Constitution de l’An I, du 24 juin 1793, donne de la citoyenneté la définition la plus ouverte, marque de l’apogée du processus révolutionnaire. Est alors « admis à l’exercice des droits de citoyen français » tout étranger qui vit en France depuis une année, vit de son travail ou acquiert une propriété, épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard. La citoyenneté est ainsi fonction d’une activité sociale et l’altérité est essentiellement politique (les ennemis de la révolution).
Moins de deux mois plus tard, le 1er août 1793, Garnier de Saintes présente à la Convention son projet de loi sur les étrangers. L’involution a commencé. Il préconise l’institution de certificats d’hospitalité, qui n’est plus désormais un acte amical désintéressé mais doit être demandée et méritée. La population est invitée à collaborer à la surveillance systématique de l’espace public. L’étranger devient doublement suspect, souligne Sophie Wahnich : du point de vue du temps et de l’espace où se joue le destin de l’humanité, parce qu’il représente un avant et un ailleurs. On commence à protester à la tribune contre « le cosmopolitisme du jour, cette philosophie puérile ». Le congrès français ne s’inscrit plus dans la perspective d’un congrès de l’univers. Le « parti de l’étranger » devient la figure de toutes les peurs.
Ainsi se dénoue dans le triomphe du paradigme national « le paradoxe de l’étranger » ou le « paradoxe de l’universalité annoncée » : la territorialisation des identités scelle la « clôture du projet révolutionnaire ». Jusqu’à la cristallisation définitive du fait national, cette fermeture demeurera cependant précaire. La République des Jules parachève l’absorption de la révolution par la république et de la république par la nation, en instituant notamment une gestion nationale de la force de travail à laquelle est directement liée (comme le démontre Gérard Noiriel) la codification de la nationalité. Mais ce durcissement national correspond aussi déjà à une transformation de sa fonction politique sur le plan international. Derrière l’aspiration nationale, à charge démocratique, des débuts, surgit ce que Hannah Arendt appelle « le nationalisme tribal de l’âge impérialiste ». L’étranger va prendre durablement le visage tantôt débonnaire tantôt menaçant des masques exotiques de l’exposition coloniale.
Ce jeu d’ouvertures et de fermetures successives de l’espace met à l’épreuve la notion d’hospitalité, dont on sait que Kant faisait, dans sa paix perpétuelle, le seul principe de droit cosmopolitique. Parce que la terre est ronde, les hommes qui se déplacent sont appelés à se rencontrer et à se rendre les uns chez les autres. Ils doivent y être accueillis en amis, étant entendu que le droit de visite ne se confond pas avec le droit d’installation. Inspirée du droit naturel, l’hospitalité demeure donc un recours privé contre les défaillances de l’institution politique. On comprend que, portant atteinte à ce droit, la loi Debré de 1997 ait soulevé un mouvement de protestation civique. Elles abolissaient la tension fertile et nécessaire entre ce que Derrida appelle l’inconditionnalité de la Loi (non écrite) et la conditionnalité des lois (écrites ou positives). Loin de relever d’une compassion moralisante, la querelle était hautement et crucialement politique.
Au-delà, elle rejoignait d’évidence les questions soulevées quelques mois auparavant par la lutte des sans-papiers et l’évacuation symbolique de Saint-Bernard. Là encore, derrière l’appel à la générosité humaine, pour la régularisation des sans-papiers, était posée la question décisive de la société que nous voulons être et de son rapport avec une nouvelle image de l’étranger. Un étranger qui ne soit plus assigné à un ailleurs, à un lointain obscur et menaçant, mais un étranger intérieur, intime et familier, un voisin. Cette métamorphose de l’étranger, liée aux flux de la mondialisation, à la relativisation des frontières, à une nouvelle topologie du dedans et du dehors, est l’enjeu d’une redistribution des appartenances et des rapports.
Dans les années soixante et soixante-dix, l’étranger intérieur avait la figure sociale du « travailleur immigré ». Le discours d’un Premier ministre socialiste qualifiant en 1983 les grèves des ouvriers de Citroën de grèves islamistes est à ce propos désastreux au sens fort du terme. Dans les mots et dans l’imaginaire, l’étranger n’était plus situé par son rôle (et son appartenance sociale) mais par une référence religieuse communautaire. Un tel déplacement sémantique balise le terrain de l’offensive par laquelle le clivage national/étranger tendrait à supplanter le clivage de classe. Cette distribution des appartenances, des lignes de fracture, du front conflictuel, n’est pas donnée par une essence ou une substance naturelle de l’être social. Elle se joue en permanence dans les luttes, dans les mots, dans les représentations.
En sortant de l’ombre, en revendiquant au grand jour leur droit d’avoir des droits, en exigeant leur place dans la communauté des citoyens, les sans-papiers ont commis un acte décisif. Ils ont refusé l’image du clandestin dans laquelle s’investissent les nouvelles peurs et les nouveaux fantasmes de l’étranger. Ils ont laissé entrevoir un nouveau rapport à l’étrangeté. En ce sens, ils n’ont pas seulement émis des revendications élémentaires. Ils ont produit de la politique, au sens fort du terme, en apportant leur contribution à une idée de la citoyenneté en nécessaire renouvellement.
J’estime pour ma part, même si l’idée choque encore, que l’avenir est au découplage entre nationalité et citoyenneté. On est bien parvenu dans notre pays (mais rien n’est irréversiblement acquis) à privatiser les appartenances religieuses et à laïciser l’espace public. Ce fut un rude combat. La tendance à la circulation, au brassage des populations, est irréversible. Le traité de Maastricht (qu’on l’approuve ou pas) institue une citoyenneté européenne pour les personnes d’origine communautaire, alors que des travailleurs turcs vivant et travaillant en Allemagne depuis des années, ou des Maliens en France, restent privés de droits civiques (dont le droit de vote). Tout cela est lourd de contradictions et de litiges. D’autre part, la crise algérienne provoque une nouvelle immigration vers la France. J’ai rencontré, il y a quelques jours, dans une réunion une jeune femme kabyle qui est en France depuis 1983, qui a trois enfants français nés en France, mais qui ne veut pas demander la nationalité française : pendant la guerre d’indépendance, son grand-père et son oncle ont été raflés dans un village près de la ligne Morice et brûlés vifs par l’armée française.
Le plus simple serait de donner une définition strictement civique et sociale de la citoyenneté : des droits et des devoirs là où l’on vit et travaille, rejoignant la vieille maxime « ceux qui sont ici sont d’ici ». Ce qui signifierait aussi privatiser la nationalité comme on a privatisé la religion, c’est-à-dire reconnaître un droit d’appartenance et des droits collectifs, culturels, linguistiques, éventuellement scolaires, comme dans les États plurinationaux, sans que l’accès à la citoyenneté soit soumis à une condition de nationalité. Je connais l’objection et le danger : troquer l’homogénéité de l’espace républicain pour une mosaïque communautaire à l’américaine. C’est un défi. Dont l’issue n’est pas fatale. La force centripète de l’intégration dépend surtout du travail en commun, des succès de la scolarisation, de la politique de l’habitat, et surtout d’épreuves historiques ou d’événements fondateurs vécus en commun. Si la référence communautaire prend le dessus sur la référence de classe c’est d’abord en raison du chômage et de l’apartheid scolaire qui renvoient chacun et chacune à sa communauté comme principal espace de socialisation.
Précisons toutefois qu’une telle perspective n’abolit pas la différence entre le droit de visite et le droit d’installation. L’universalité humaine n’est pas un décret ni une origine octroyée, mais un devenir et une construction, dont on mesure la difficulté dans le cas du droit international. Tant que la communauté internationale est médiée par des États (nationaux ou non), la citoyenneté suppose un système de droits et de devoirs. Le droit d’installation n’échappe pas à cette règle : il a aussi ses devoirs. Mais une clarification de l’idée de citoyenneté permet de poser le débat en d’autres termes.
L’équation européenne
Et puis, il y a aussi l’autre étranger, le petit étranger que chacun de nous porte au profond de soi, l’étranger qu’il fut et qu’il redeviendra, car « n’oublie jamais que toi aussi tu fus étranger en Égypte… ». Notre étrangeté s’inscrit aujourd’hui dans l’incertitude de l’humanité européenne et de son avenir.
Le discours public s’acharne d’autant plus à diffuser une mythologie européenne, à nous présenter l’Europe comme un destin géopolitique naturel, que cette Europe tronquée qui a nom Union européenne ne procède d’aucune évidence historique, culturelle, sociale. Faut-il préciser que je me sens personnellement au moins autant méditerranéen que scandinave, et plus andalou que rhénan. Autrement dit l’Europe réellement existante, celle de Maastricht et d’Amsterdam, celle du grand marché et de l’euro, est une donnée fonctionnelle de la raison, non l’objet d’un investissement affectif électif.
Cette Europe est une bonne échelle fonctionnelle pour résoudre certains problèmes d’intendance, une bonne dimension pour des investissements, pour une politique d’énergie, de transports, d’aménagement du territoire. Ça ne fait pas encore un espace politique. Encore moins un espace social. Le pari des pères fondateurs, de Monnet à Delors, est que l’économique entraînera le reste. Ils sont de ce point de vue plus déterministes et économistes que les marxistes mécaniques de la belle époque stalinienne. Qui sait ? Il fut des unifications politiques – nationales – par en haut, à faible ferveur populaire, comme l’allemande et l’italienne, lourdes de pathologies. Espérons que cette Europe balbutiante qui se veut déjà « Europe puissance », autrement dit Europe impériale, ne souffrira pas des mêmes traumatismes infantiles.
Car l’hérédité est déjà chargée. Au sortir d’une terrible guerre et d’un massacre sans précédent, où s’était fracassée une première fois l’illusion progressiste d’une humanité européenne, Valéry portait déjà un jugement désenchanté sur l’esprit européen : « Partout où l’Esprit européen domine, on voit apparaître le maximum de besoins, le maximum de travail, le maximum de capital, le maximum de rendement, le maximum d’ambition, le maximum de puissance, le maximum de modification de la nature extérieure, le maximum de relations et d’échanges. Cet ensemble de maxima est Europe, ou image de l’Europe. » Depuis, la vieille Europe a été battue à plate couture sur ce terrain par l’Amérique, mais elle n’a pas renoncé à prendre sa revanche. La grande roue du capital tourne aussi.
Car Valéry mettait le monde à l’envers. Ce n’est pas l’esprit européen qui se déchaînait dans cette quête mortifère du toujours plus mais l’esprit d’un monde sans esprit, l’esprit du capital qui hante la modernité.
L’Europe qui se fait est un bon échelon, un barreau commode dans la nouvelle échelle des espaces. Il serait illusoire d’imaginer son avenir comme l’agrandissement photographique de nations désormais trop étroites. Il serait illusoire et dangereux d’imaginer une Europe-nation prenant simplement le relais d’États-nations devenus obsolètes. Il existe un espace économique européen, mais il chevauche déjà les espaces de la mondialisation. Il existe un espace judiciaire qui ne coïncide pas avec l’espace judiciaire. Il existe d’ailleurs plusieurs espaces juridiques européens, celui de Bruxelles et celui de Strasbourg, encastrés au demeurant dans l’espace des tribunaux pénaux internationaux. Il existe une ébauche d’espace militaire européen, mais enclavé dans un espace atlantique toujours dominant. Tout cela n’annonce guère la reconstitution d’une correspondance univoque et harmonieuse entre un territoire, un marché et un État européens, mais plutôt des emboîtements et des chevauchements, avec une distribution nouvelle des compétences et des attributs de souveraineté.
Et avec une nouvelle structuration interne des espaces. La presse a salué récemment la trêve définitive annoncée par ETA en Euskadi et les accords de Lisara entre toutes les composantes du nationalisme basque. Elle en a moins clairement dégagé le sens. Aujourd’hui, la bourgeoisie basque, symbolisée par la puissante banque de Bilbao, traite 40 % de ses échanges directement avec la communauté européenne sans passer par l’État espagnol, et 20 % directement avec l’Amérique latine. Elle veut renégocier le pacte de la transition post-franquiste pour tenter directement sa chance dans la nouvelle donne européenne et internationale. La bourgeoisie catalane est sur la même longueur d’ondes. Demain l’Écosse ? Mais ces tentatives posent fortement la question de la citoyenneté. Pour le moment, s’inspirant des textes fondateurs d’ETA, les nationalistes basques définissent la citoyenneté basque revendiquée non d’un point de vue ethnique mais dans un sens politique et civique qui radicalise le droit du sol : vivre et travailler en Euskadi. Ils évitent aussi de poser la question en termes de frontières (donc de litige territorial sur la question de la Navarre) mais parlent de processus constituant volontaire. Il faut dire que la nouvelle tragédie balkanique a montré les dangers d’un nationalisme tardif à la recherche d’une légitimité originelle.
Toutes ces métamorphoses obligent donc à penser autrement l’étranger. Reste à savoir dans quel horizon et dans quelle perspective. Je me rallierai pour ma part à celle d’une Europe comme l’évoque Derrida, non d’une Europe-fermeture mais d’une Europe-cap, fendue et ouverte à des échanges, à des métissages, à des combinaisons d’appartenances. Ce n’est pas, comme on pourrait trop facilement le croire, seulement un choix du cœur. C’est aussi un choix de la raison politique.
Revue semestrielle Villa Gillet, cahier n° 8, avril 1999